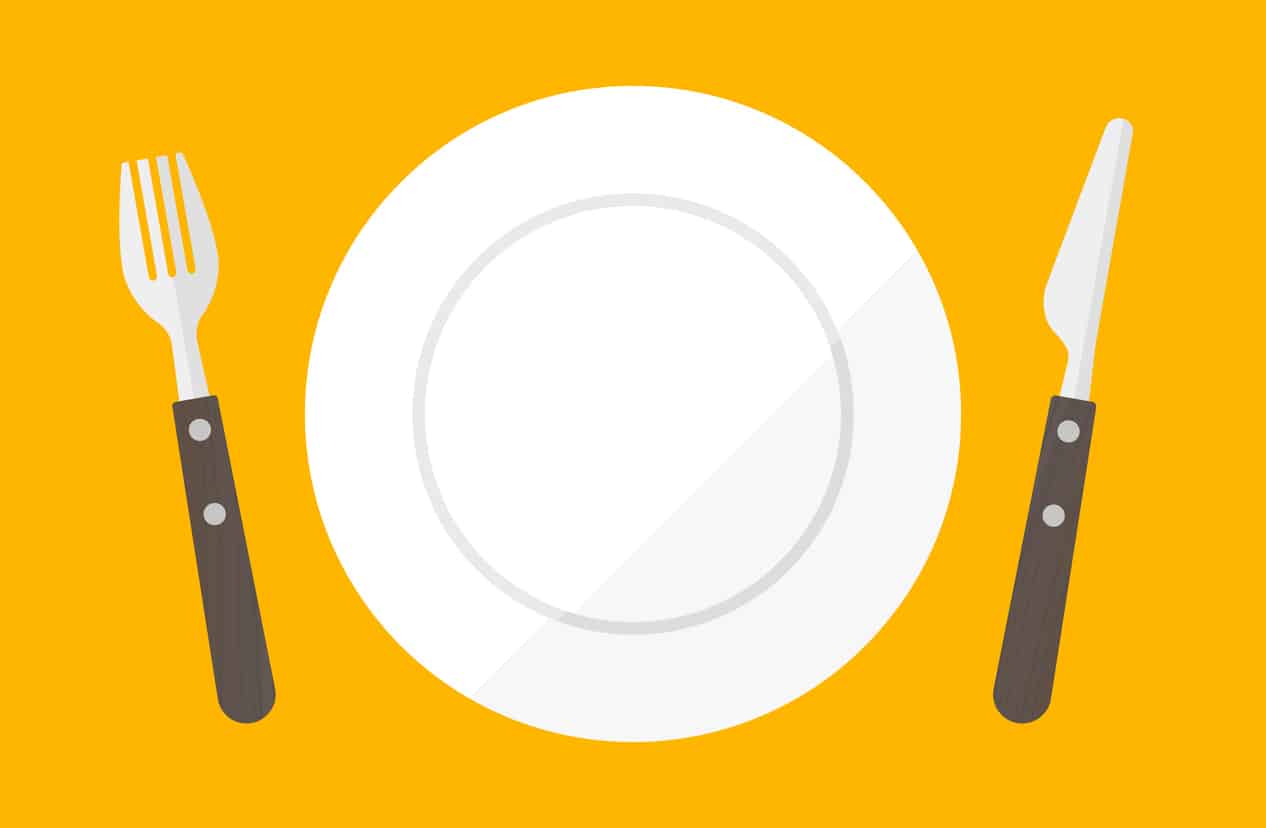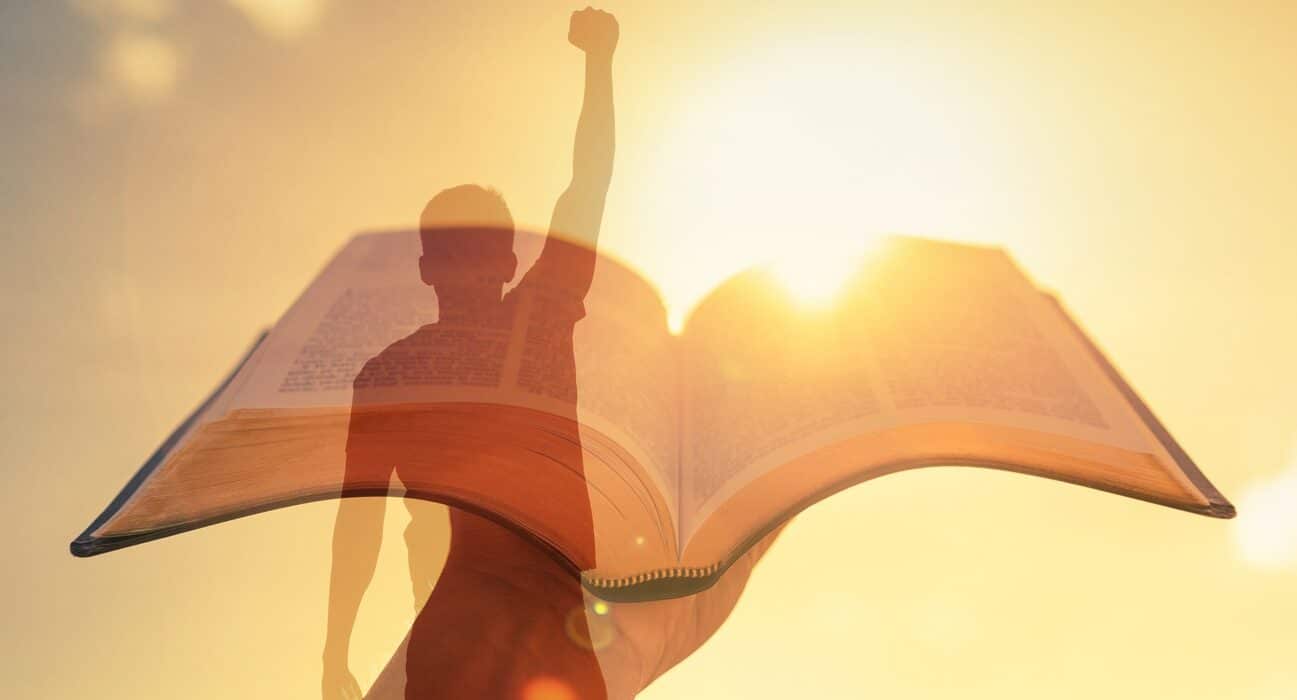Le contexte français est à la fois suspicieux par rapport au religieux et en recherche de lieux où le besoin de transcendance est assumé. L’accompagnement spirituel prend une place certaine dans la vie des quarante-deux établissements et services de la Fondation John Bost. La présence d’un pasteur offre des espaces de sens ouverts à toutes les personnes accueillies et soignées, quelle que soit leur religion – ou leur absence de religion. Mais comment mesurer concrètement les bénéfices d’un tel accompagnement ? Peut-on se limiter à des chiffres ou faut-il chercher ailleurs ?
Des bénéfices au quotidien
L’impact de l’accompagnement spirituel se révèle dans la formulation du projet personnalisé du patient ou résident lorsqu’il y fait figurer son choix d’assister aux débats et discussions animés par les pasteurs. Bien sûr, un contact régulier existe entre les pasteurs et les professionnels qui accompagnent les patients ou résidents, et il n’est pas rare d’entendre de la bouche de ces derniers : « C’est plus calme et apaisé, les jours où vous êtes là, les pasteurs. »
Dans le domaine du handicap, soignants et éducateurs, au cours de leur carrière professionnelle, vont tantôt travailler dans des établissements publics, tantôt dans des établissements privés, et devoir s’adapter à des modes différents de l’expression possible du religieux. Dans les établissements de la Fondation John Bost, le résident est accompagné dans sa démarche, qu’il souhaite pratiquer sa religion lors des moments de célébration ou de prière organisés dans son établissement ou qu’il préfère se déplacer dans un lieu de culte de proximité.
Un rapprochement avec les Églises locales
Le contact régulier qu’entretiennent les pasteurs de la Fondation John Bost avec les Églises locales contribue à faire changer le regard de la société sur le handicap. Souvent, les paroissiens constatent que l’accueil d’une personne aux besoins spécifiques est un enrichissement pour l’Église. Après avoir sollicité un pasteur de la Fondation, nombre d’entre elles entreprennent des démarches pour devenir des communautés inclusives et pratiquer un accueil inconditionnel, y compris donc de personnes en situation de handicap.
L’impact spirituel se mesure également lors des accompagnements de fin de vie, et au moment du processus de deuil qui fait suite à un décès dans l’établissement. Des temps de l’au revoir sont animés en hommage à la personne elle-même mais aussi pour les autres résidents de son foyer.
La présence des pasteurs au sein de l’institution peut paraître facultative au premier abord mais elle offre la possibilité d’une « parole autre », une parole invitée dans les groupes de réflexion et convoquée dans les comités d’éthique. Elle est précieuse dès lors qu’une décision concernant les soins doit être prise, et contribue à la fidélisation des professionnels en quête de sens.
Même si l’impact spirituel n’est pas toujours mesurable sur le plan quantitatif, son apport qualitatif indéniable justifie l’engagement des pasteurs aumôniers dans l’institution de référence protestante.