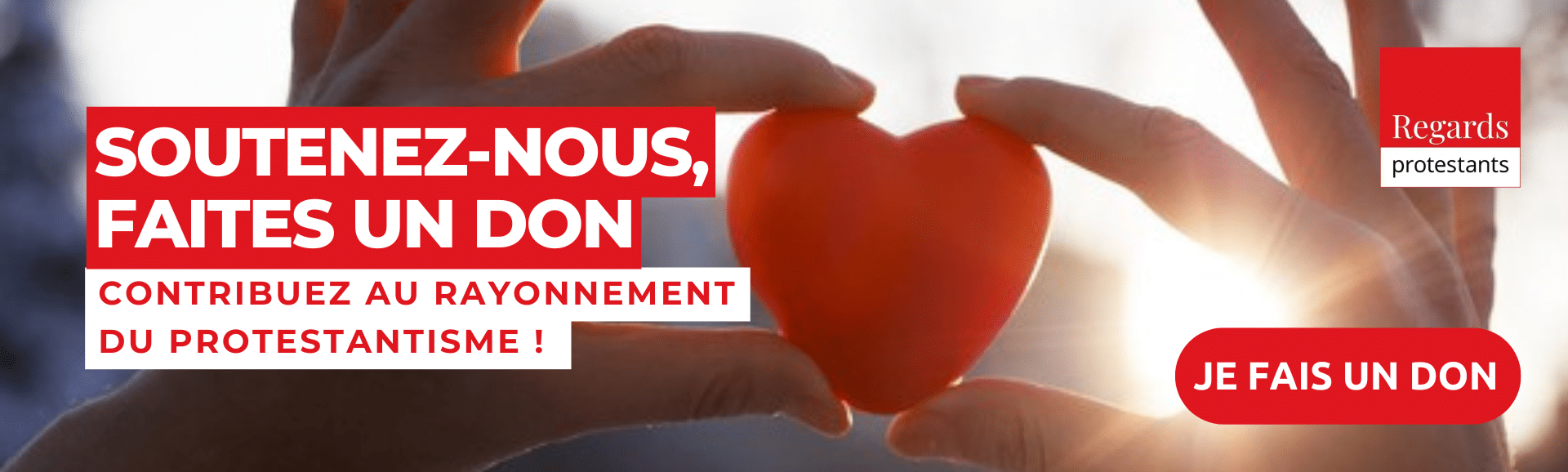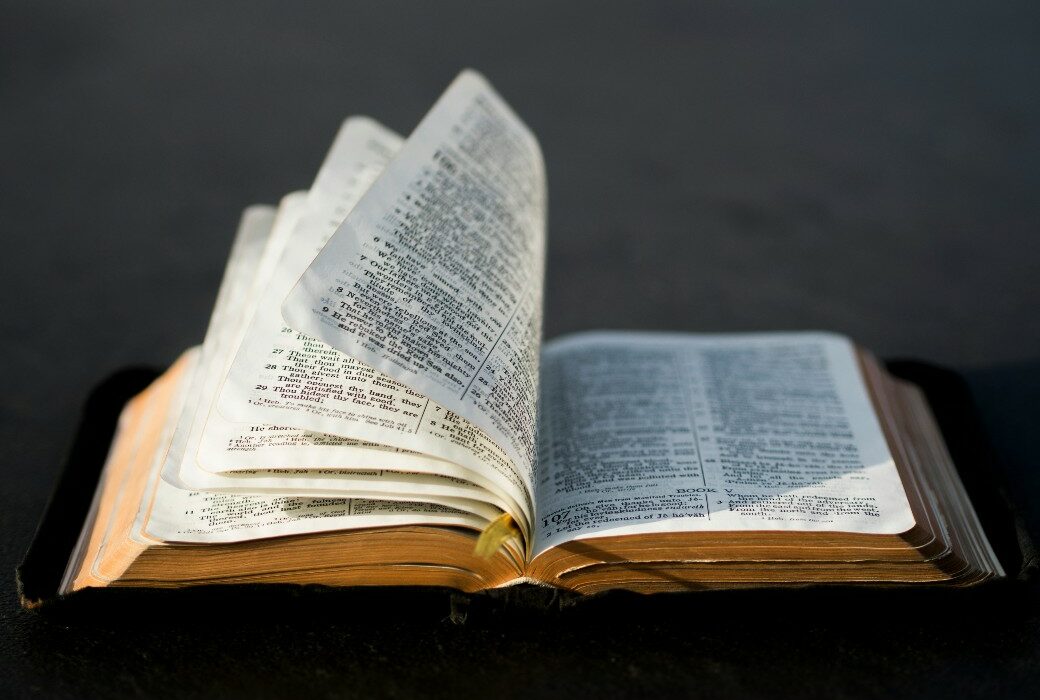Comment définir l’impact social ?
Le terme apparaît pour la première fois dans les années 1970 aux États-Unis et se développe à partir des années 1990 dans le monde anglo-saxon. En France, le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire propose, dès 2011, une définition : « L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences des activités d’une organisation tant sur ses parties prenantes et internes que sur la société en général dans le secteur de l’économie sociale et solidaire ; il est issu de la capacité de l’organisation à anticiper des besoins pas ou mal satisfaits et à y répondre via ses missions de prévention, réparation ou compensation. »
La recherche d’impact social est au cœur du projet des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Elle englobe tous les changements, positifs ou négatifs, attendus ou inattendus, engendrés par les activités. Elle cherche à comprendre, mesurer, valoriser les effets produits et répertorier leurs conséquences sociales.
L’impact n’est donc pas seulement financier ?
Non, la performance ne se réduit pas à des résultats financiers mais s’incarne dans les incidences générées par les actions. Sur un plan opérationnel, l’impact social peut être visualisé sur une chaîne de valeur. On distingue ce qu’on fait – les ressources humaines et financières mobilisées, les activités menées, les formations, les accompagnements… ; ce qu’on produit – les réalisations, le nombre d’événements ou de formations assurées, de bénéficiaires accompagnés, d’emplois créés… ; et la contribution du projet – ses conséquences, le changement généré.
Pourquoi lancer une mesure d’impact ?
Pour apporter la preuve de la valeur sociale créée et de la pertinence du projet, mais aussi pour améliorer la pratique interne, la recherche de solutions innovantes et alimenter une activité de plaidoyer externe. Ce faisant, on pérennise ses financements ou on en suscite de nouveaux. Le travail des salariés et bénévoles est reconnu, valorisé, les équipes sont motivées, de nouvelles instances de dialogue sont créées.
La mesure d’impact peut être programmée à toute étape de la vie d’un projet ou d’une organisation et, dans l’idéal, dès sa création. Avant de se lancer, et en fonction des moyens humains et financiers dont on dispose, il faut décider si elle se fera en interne ou si tout ou partie sera externalisé. Il n’est pas simple d’identifier les coûts financiers ni la contribution des équipes et la mobilisation des partenaires. L’évaluation est un processus à long terme (entre six mois et deux ans) qui devrait perdurer et être intégré au fonctionnement de la structure.
Quelles sont les étapes de la mesure d’impact ?
Sa mise en œuvre se fait en trois étapes : la phase de cadrage (définition de la question évaluative) ; la phase de la preuve (données à collecter et actions de collecte) ; la phase d’analyse et de capitalisation des résultats : l’action évaluée atteint-elle ses objectifs ? Entraîne-t-elle d’autres impacts ? Les moyens déployés sont-ils suffisants ? Un meilleur pilotage des activités est-il recommandé ? Nous avons élaboré un guide de la mesure d’impact social. Il propose des outils pratiques et des cas concrets à chaque étape. Il répertorie les acteurs et dispositifs de formation, d’accompagnement et de financement.