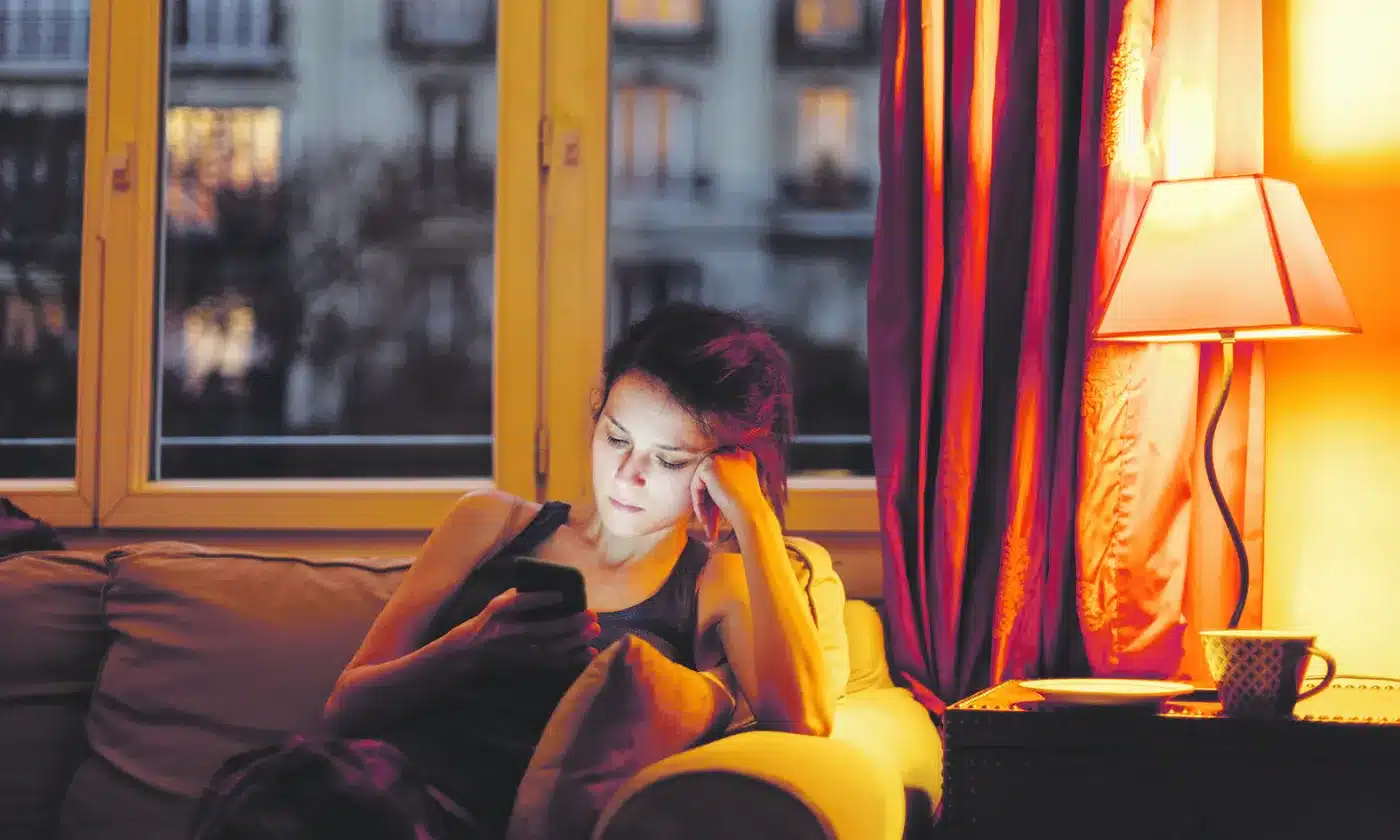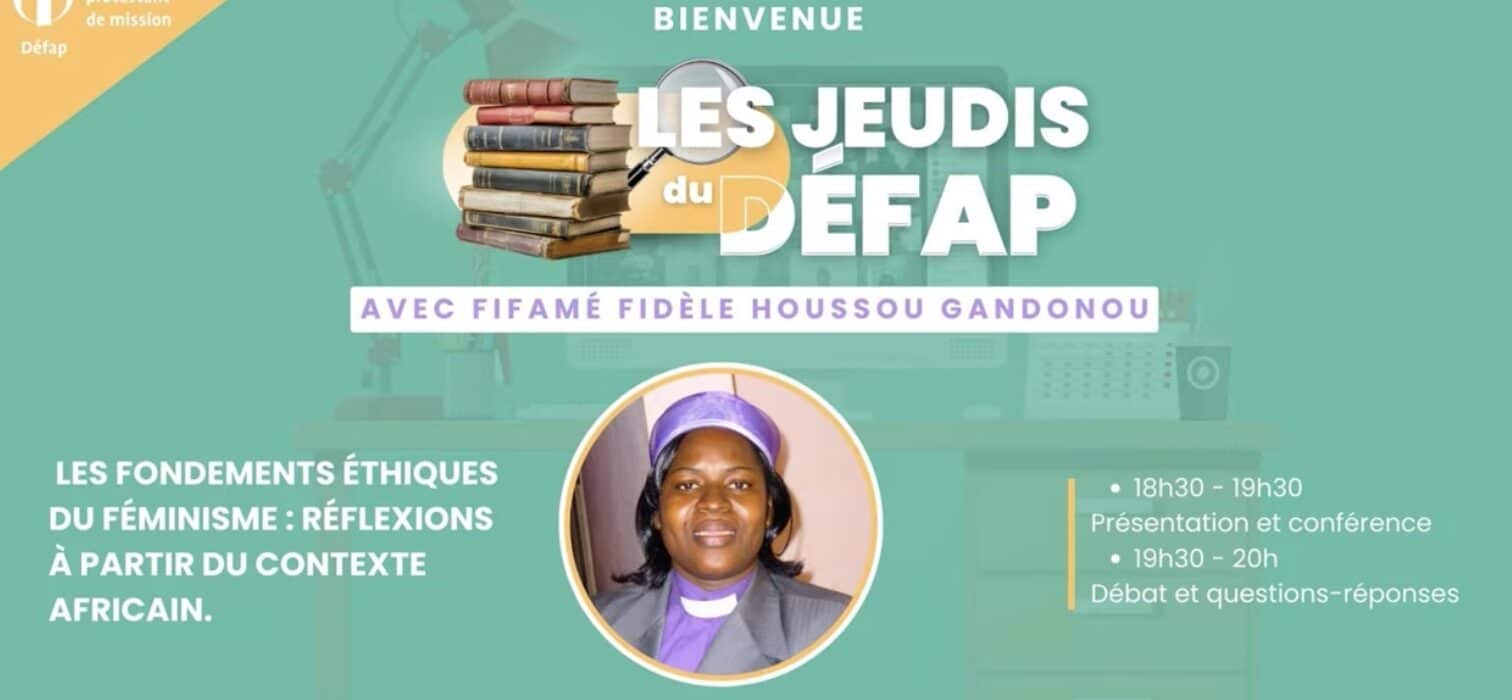C’était un ado expansif et bavard, et l’adulte de 44 ans qu’il est aujourd’hui est extraverti et ouvert. Mais lorsqu’il est arrivé d’Équateur en Suisse à 15 ans, mineur étranger et isolé, Luis Ludena a basculé dans un mutisme sombre. «Je suis devenu introverti, car je n’osais pas parler français, j’essuyais des remarques sur mon accent. J’étais hyper-triste… Mon identité, ma personnalité ont changé du tout au tout. Ça m’a abîmé, j’ai fait une longue dépression, mais je ne le comprenais pas.» Une phase difficile que le jeune homme a traversée sans aide spécifique et sans repères, avant de retrouver une stabilité intérieure et d’étudier, jusqu’à devenir éducateur spécialisé.
La question de la santé mentale des personnes migrantes reste un impensé collectif. Les personnes requérantes d’asile souffriraient pour 60 à 80% d’entre elles de troubles psychologiques. «Venant d’un pays en guerre ou instable, elles ont presque par définition vécu des traumatismes», explique Saskia von Overbeck Ottino, psychiatre et pédopsychiatre. Trauma? «C’est un événement psychique qui déborde nos capacités à lier les choses. Il fait effraction lorsqu’on est exposé à quelque chose de traumatique: un événement réel qui s’est passé, accident de voiture ou bombardements permanents», explique celle qui est aussi médecin consultante aux Hôpitaux universitaires de Genève.
Un trauma comporte plusieurs dimensions. D’abord quantitatives: quitter sa famille, ses repères, son existence, vivre des violences dans son pays, engendre des souffrances psychiques, sans compter les agressions, séquestrations et dangers multiples qu’impliquent les routes migratoires. Enfin, à l’arrivée, l’insécurité des foyers, la déshumanisation des procédures administratives, le manque d’accès à des soins médicaux adaptés peuvent provoquer des traumas encore plus «pénétrants» en raison de leurs dimensions qualitatives. D’une manière générale, «quand le traumatisme est infligé par un humain qui vous veut du mal, voire votre mort, cela active […]