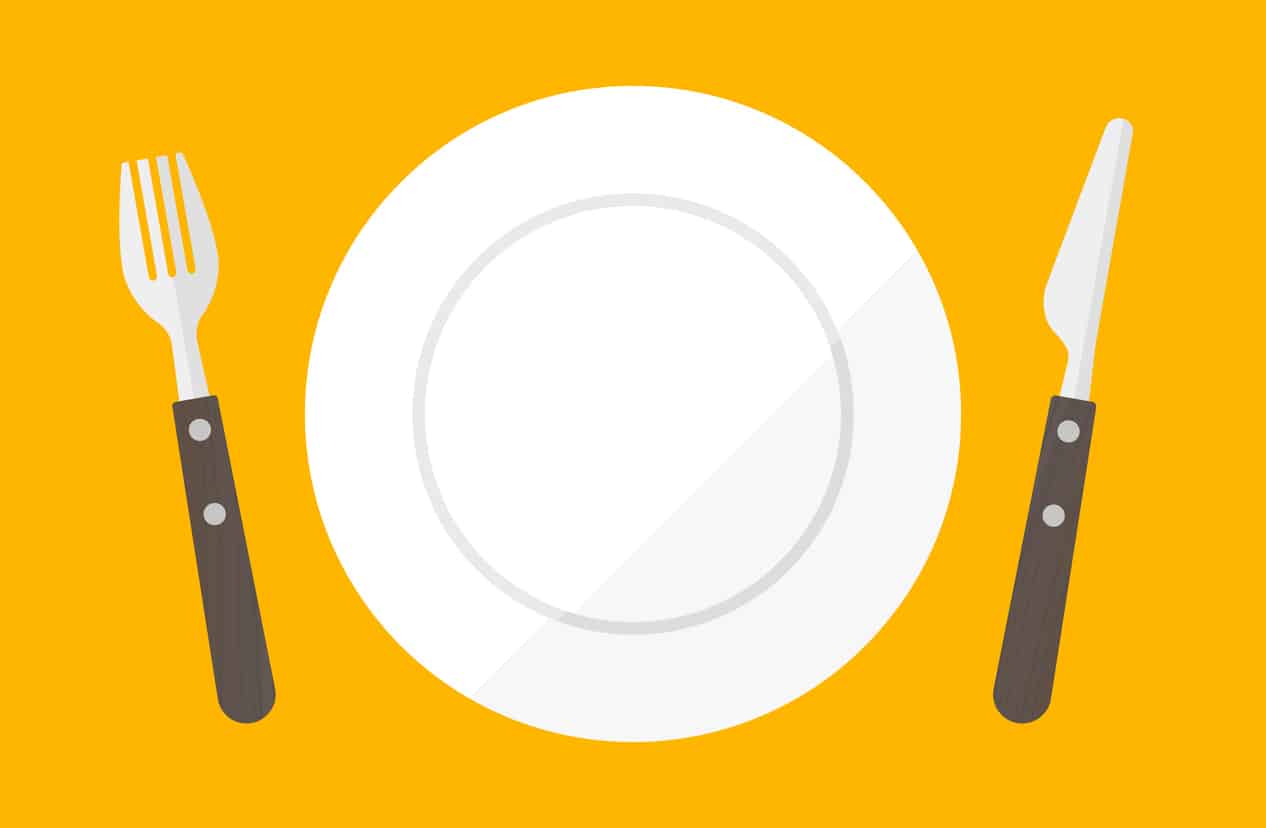C’est dans le joli salon rouge de son bureau de la villa Oppenheimer, à Strasbourg, que Pap Ndiaye m’accueille. Costume anthracite et cravate émeraude, l’ambassadeur est souriant et courtois. Pap Ndiaye est né à Antony en 1965 d’une mère française, enseignante, et d’un père sénégalais, ingénieur. Après un parcours scolaire sans faute, il a intégré l’École normale supérieure de Saint-Cloud.
À l’école maternelle déjà, Pap Ndiaye a conscience d’être « un peu différent ». Plus tard, il comprend qu’il éveille la curiosité : « Vous venez d’où ? » ; puis souvent, avec insistance : « Mais vous venez d’où, vraiment ? » Pap Ndiaye ne se formalise pas, au contraire, « ça m’a plutôt donné de la force et l’envie de me battre pour atteindre mes objectifs ». Pas question toutefois de considérer ces intrusions comme normales, d’autres personnes dans des situations moins confortables pourraient évidemment en pâtir. « Je ne suis pas représentatif ; si j’étais chauffeur-livreur, ce serait différent », reconnaît-il.
Lorsqu’il est nommé à l’Éducation nationale et la Jeunesse, les commentaires désobligeants fusent. Le ministre les ignore. Les Français n’hésitent plus à exprimer ouvertement leurs opinions racistes, les conversations de bistrot s’exportent dans la rue, légitimées par les médias. Plus insidieux, difficile à caractériser et à combattre, le racisme structurel, explique Pap Ndiaye, barre l’accès aux écoles prestigieuses et à certains emplois à toute une frange de la population. Il aveugle les élites politiques et les bonnes volontés. La prise de conscience passe par des formes de visibilité dans l’espace public, il faut des pionniers courageux prêts à rompre le silence, dénoncer les stratégies d’exclusion et entraîner dans leur sillage une multitude de témoins.
La condition noire évoquée par Pap Ndiaye en 2009, une condition « qui s’impose aux personnes considérées comme noires, indépendamment de leur volonté », reste d’actualité. S’il est vrai que la lutte contre les discriminations est désormais plus institutionnelle, portée par le Défenseur des droits, on parle beaucoup moins de diversité aujourd’hui, au gouvernement comme dans les entreprises, remarque l’ambassadeur. C’est parce qu’il est très sensible à l’injustice faites aux personnes – femmes, LGBT et « non blancs » confondus – qu’il lutte pour les minorités, « l’injustice m’est insupportable, en cela je suis un bon républicain ».
Pap Ndiaye prône la mixité scolaire et sociale. Elle est garante de progrès. Plus elle est grande, meilleurs sont les résultats des élèves, en témoignent les expérimentations probantes menées à Toulouse et à Paris avec la redistribution de la carte scolaire pour les lycées. L’ancien ministre considère que la laïcité est mal comprise. La loi de 2004 est claire qui interdit le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse. Le dispositif ne doit pas être étendu à d’autres espaces publics. « Les débats sur la laïcité ne datent pas d’hier. La question de l’islam occupe davantage l’opinion que la lutte contre les inégalités
scolaires ! »
Pap Ndiaye invite ceux qui considèrent l’autre comme une menace à se rapprocher de lui pour le connaître. L’ignorance est le premier carburant de la peur. L’autre avec qui je suis en contact, à l’école, sur mon lieu de travail, dans une association, à l’Église… n’est pas si autre que ça en réalité. Il est très proche de moi et me ressemble étrangement. « Les points de différence qui apparaissaient si marquants s’éclipsent. La connaissance mène à l’universalité. On est fondamentalement les mêmes. »