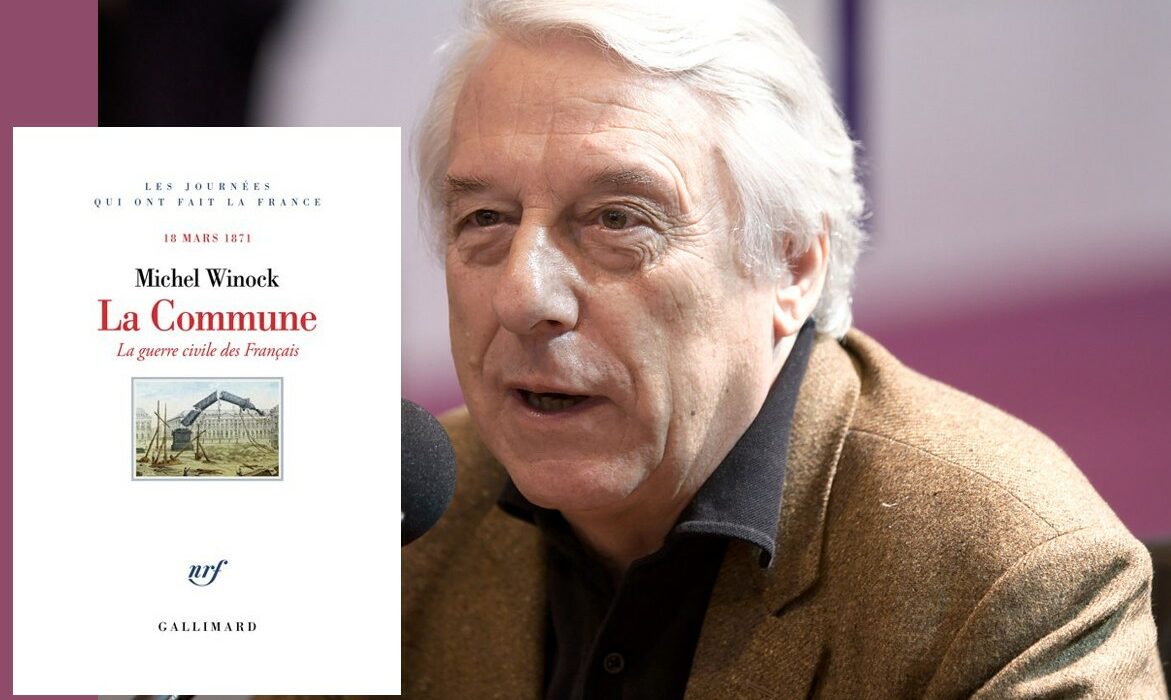«Semaine après semaine, l’extrême droite impose sa volonté à l’Assemblée, dont les bancs restent désespérément vides»: le «Parlement déserté» est l’un des signes d’une crise de la démocratie qui n’est pas spécifiquement française mais «liée à une irréversible mutation anthropologique». Les «grands « systèmes de légitimation » (religions, idéologies politiques…) qui «structuraient nos existences individuelles et collectives» se sont progressivement effacés, créant «un vide symbolique». Plutôt qu’être «les victimes (consentantes ?) de dynamiques systémiques qui nous dépassent», il est plus que jamais temps de comprendre que la (toujours fragile) démocratie est notre identité et la seule chance d’éviter de finir en «rouage» d’une «immense machine de plus en plus impersonnelle».
«…On peut s’interroger sur l’état des démocraties, trente-cinq ans après la chute du Mur de Berlin, qui semblait annoncer sinon la ‘fin de l’histoire’ (Francis Fukuyama), du moins le renforcement de la légitimité du régime démocratico- libéral» (Philippe Raynaud (1)).
« La démocratie est le pire des régimes… à l’exception de tous les autres » (Winston Churchill).
L’usure démocratique
On ne cesse de s’interroger avec inquiétude sur l’état des démocraties et de la nôtre en particulier. Il faut le reconnaître: il y a un malaise très profond au cœur de nos institutions. L’Hémicycle est de plus en plus déserté, ce qui fragilise notre démocratie. L’absence des députés, notamment du bloc central, explique l’«adoption surprise» d’un amendement du Rassemblement National le 27 juin dernier lors de l’examen du projet de loi sur la refondation de Mayotte. 26 voix contre 20, 23 des 26 voix en faveur de cet amendement provenant du RN. Conséquences limitées à court terme, puisque les textes sont désormais quasi systématiquement «corrigés» au Sénat ou en Commission mixte paritaire ! Mais ce n’est pas un cas isolé. Semaine après semaine, l’extrême droite impose sa volonté à l’Assemblée, dont les bancs restent désespérément vides. Et la scène se répète sur des textes essentiels: avenir énergétique, audiovisuel public, etc. Désertant le débat parlementaire, des représentants du peuple choisissent de ne pas honorer leurs mandats nationaux et de céder la place aux extrêmes. Provoquant l’effritement du socle majoritaire (2) censé porter les lois de la République, ce sont ces députés, par leur absentéisme, qui font eux-mêmes vaciller la démocratie ! Ce qui paradoxalement contribue à nourrir les discours sur «l’impuissance de la démocratie». Ce qui semblerait, certes pour des raisons différentes, donner raison aux 41% des français qui pensent qu’«en démocratie, rien n’avance, il vaudrait mieux moins de démocratie et plus d’efficacité» (sondage du Cevipof de 2020). Que le Parlement débatte ou non, que l’Hémicycle soit fréquenté ou déserté, qu’il y ait plus ou moins de démocratie, celle-ci finit toujours par être décriée !
Le pays traverse une crise de confiance accentuée par la dissolution de l’Assemblée, et, sans majorité (ni absolue ni relative), le président de la République s’est auto-délégitimé. De motion de censure en motion de censure, «la séquence post-législative a (…) démultiplié la méfiance des citoyens en défiance (3): les Français ne parviennent plus à s’identifier à leurs institutions» (4). Sans cap clair, sans vision à long terme, l’actuel premier ministre joue prudemment la montre et donne, à l’instar du Parlement déserté, l’impression de s’installer dans l’impasse de l’inertie, du «présentisme» selon le mot de Marcel Gauchet, ou dans la «routine accommodante» que Marc Bloch dénonçait dans L’étrange défaite. Tout cela donne, pour le moins, un sentiment d’usure démocratique.
La démocratie en crise(s)
En élargissant le champ de la réflexion, il semble, à vrai dire, que toutes les démocraties libérales occidentales traversent une période de fragilité. L’analyse de leurs dysfonctionnements n’est certes pas nouvelle. Des penseurs tels que Marcel Gauchet (5) ou Pierre Rosanvallon (6) inscrivent leurs réflexions dans le sillage d’un Tocqueville, d’un Marx ou d’un Weber, qui restent tous d’une étonnante actualité. Dans une tradition critique de la modernité, la démocratie, qui demeure un idéal, est interrogée dans ses formes actuelles, ses dérives, ses faiblesses et ses apories. Tocqueville a montré la fragilité intrinsèque de la démocratie dont les ambitions s’inscrivent constamment dans des tensions difficiles à surmonter, particulièrement dans l’articulation à sans cesse réinventer entre pluralisme, participation, légitimité et efficacité. Les critiques de la démocratie portent essentiellement sur ses pratiques, oubliant souvent cette fragilité qui lui est inhérente. Elle est liée à un régime fondé sur la souveraineté populaire, l’égalité politique et les libertés individuelles. Or le peuple souverain, censé avoir le pouvoir, ne se sent plus représenté, ou s’estime mal représenté. Ce qui explique l’abstention, la défiance envers les partis, la désaffection des corps intermédiaires et la recherche de nouvelles formes de participation citoyennes. Pierre Rosanvallon parle d’«un peuple introuvable» ou «infigurable» pour montrer la difficulté de représenter tout le monde de manière juste. Le citoyen se sent à juste titre de plus en plus éloigné des institutions représentatives.
Les logiques partisanes confisquent la démocratie au sein des partis. Le sentiment qu’une «caste» politique ou technocratique s’autonomiserait dans le mépris des dynamiques démocratiques (7) est de plus en plus partagé. La dérive vers une démocratie d’opinion, guidée par l’émotion immédiate et la réaction impulsive hors de tout débat rationnel, qui s’accentue; une démocratie dite «compassionnelle» qui substitue à l’analyse structurelle des causes une forme de gestion morale des situations, dictée par une émotivité politique, mauvaise conseillère de décisions précipitées de l’ordre du symbolique: telle est, nous semble-t-il, cette pluralité de crises qui nourrissent en chacun de nous une impression de dépossession démocratique et accentuent une fracture entre gouvernants et gouvernés.
La spirale de l’essoufflement
Notre société contemporaine traverse des crises qui semblent nous priver d’avenir. Crise climatique, économique, sociale, politique, culturelle… sur fond de conflits, de montée des impérialismes et des totalitarismes. Terribles ismes qui accentuent ce que nous savions déjà, mais que nous réalisons désormais avec inquiétude, à savoir la vulnérabilité de nos démocraties. «Les individus modernes, c’est là que le bât blesse, ne se passionnent pas», dit Cornelius Castoriadis en s’interrogeant à propos de la démocratie et de la «subjectivité moderne». On peut penser que cette impression de dépossession démocratique est en partie à l’origine d’un détachement, d’une indifférence, voire d’une apathie de nos contemporains pour la vie politique (et collective). Peut-être est-ce là la difficulté majeure de la démocratie. Pour Castoriadis […]