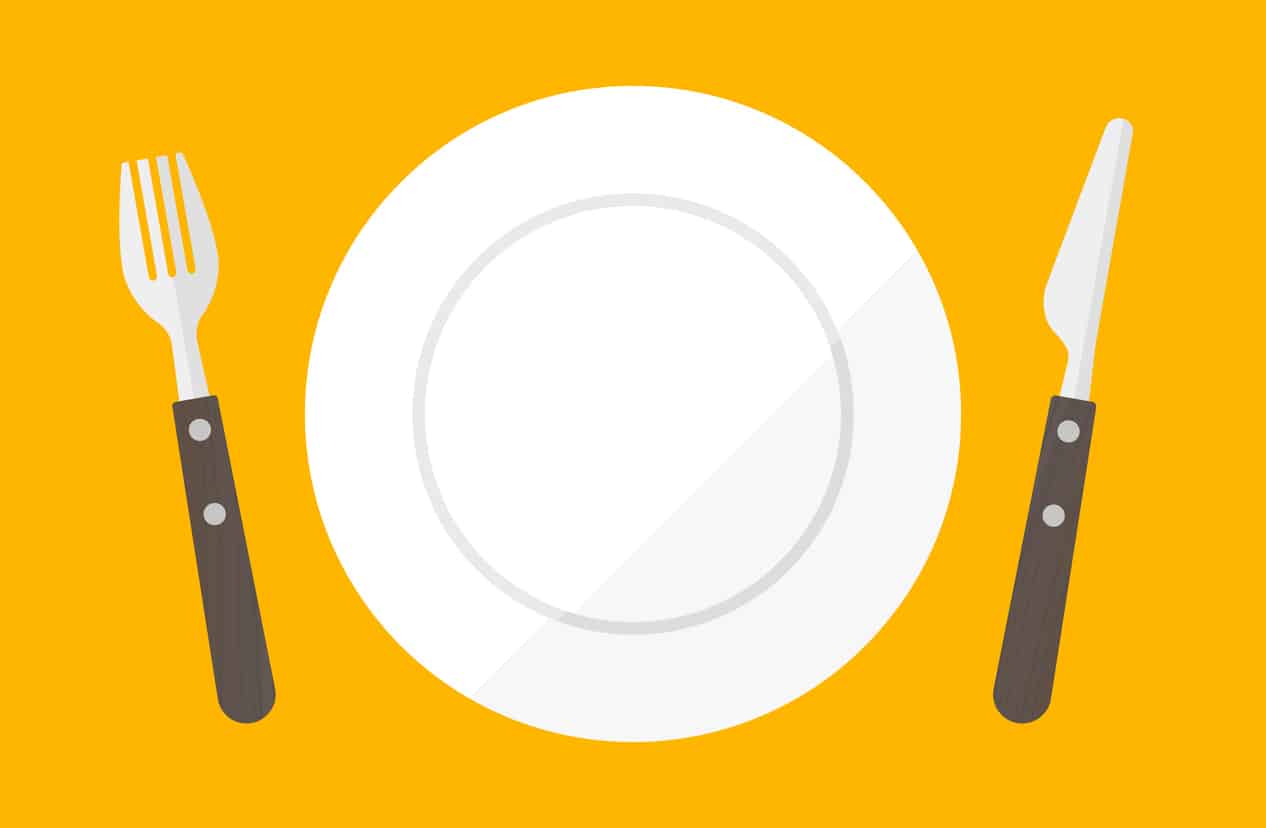Je ne pense pas qu’il y ait de lien direct entre développement durable et justice sociale. Ce sont deux objectifs importants, mais qui ne découlent pas mécaniquement l’un de l’autre. En revanche, il existe de nombreuses questions où ces deux projets se rejoignent.
Une chose à souligner, en particulier, est que la croissance économique, laissée à elle-même, conduit à un isolement des personnes. La monnaie, déjà, est un outil qui permet d’éviter les discussions interminables de l’économie de troc. Et c’est tout l’outillage technique qui nous permet « d’économiser » nos contacts sociaux en nous « débrouillant » par nous-mêmes.
Des liens sociaux mis à mal
Il est possible, aujourd’hui, d’acheter en ligne quelque chose et de ne même pas apercevoir la personne qui, finalement, vient déposer le produit dans notre boîte aux lettres normalisée. Depuis plusieurs années, pour couronner le tout, la facilité des transports a conduit à éloigner les sites de production des lieux de consommation et, même, à éloigner les sites de production les uns des autres. Une automobile, par exemple, est le résultat de chaînes d’approvisionnement qui s’étalent sur plusieurs pays.
Les conséquences sociales de ces évolutions sont majeures : isolement et détresse des individus, perte de maîtrise sur sa destinée, difficulté à percevoir le sens de son travail, fragilisation des couches sociales (employés et ouvriers qualifiés) dont le métier est englouti par les innovations technologiques.
Or, travailler à la transition écologique permet d’aller à rebours de ces évolutions. D’une manière évidente, et pour commencer, la diminution de l’énergie grise, consommée pendant la phase de production d’un bien, passe par une production plus locale. Mais il y a d’autres phénomènes auxquels on pense moins.
Aller au plus près
Tous les mouvements « slow », ou les associations qui se préoccupent de transition écologique, se sont rendu compte que les exigences environnementales supposaient une mobilisation renouvelée des liens sociaux de proximité. Faire réparer un vêtement ou un objet est considérablement plus facile si on porte le bien à réparer chez quelqu’un à qui on peut expliquer ce qui ne va pas. De même, le recyclage est d’autant plus pertinent qu’il s’insère dans un cycle court, dans un voisinage pas trop éloigné. Et si on veut éviter d’avoir recours à une prestation formatée, et coûteuse en carbone, on a tout intérêt à être au courant des compétences (bénévoles ou marchandes) qui existent près de chez soi. Au passage, tout cela permet de trouver un nouveau créneau pour les employés et ouvriers disqualifiés par la production hautement technologisée.
Par ailleurs, et pour tout ce qui concerne les changements de comportement, rendus nécessaires par les exigences écologiques, l’apprentissage collectif est un des meilleurs moyens pour y parvenir sans culpabilité, découragement ou sentiment d’impuissance. Dans ce domaine aussi, la solidarité et l’éducation populaire sont et seront des ressources indispensables, et les membres de la FEP auront un rôle à y jouer.
En résumé, et alors que, depuis des dizaines d’années, la proximité est apparue aux investisseurs, et aux bureaux d’études qui conçoivent de nouveaux services, comme une entrave et une complication gênante, on pourrait redécouvrir qu’elle est une ressource indispensable pour inventer un mode de développement qui ne nous précipite pas dans l’abîme. C’est une occasion de redécouvrir que la solidarité est plus que l’équité : elle est ce que l’on décide de faire ensemble en se soutenant les uns les autres.