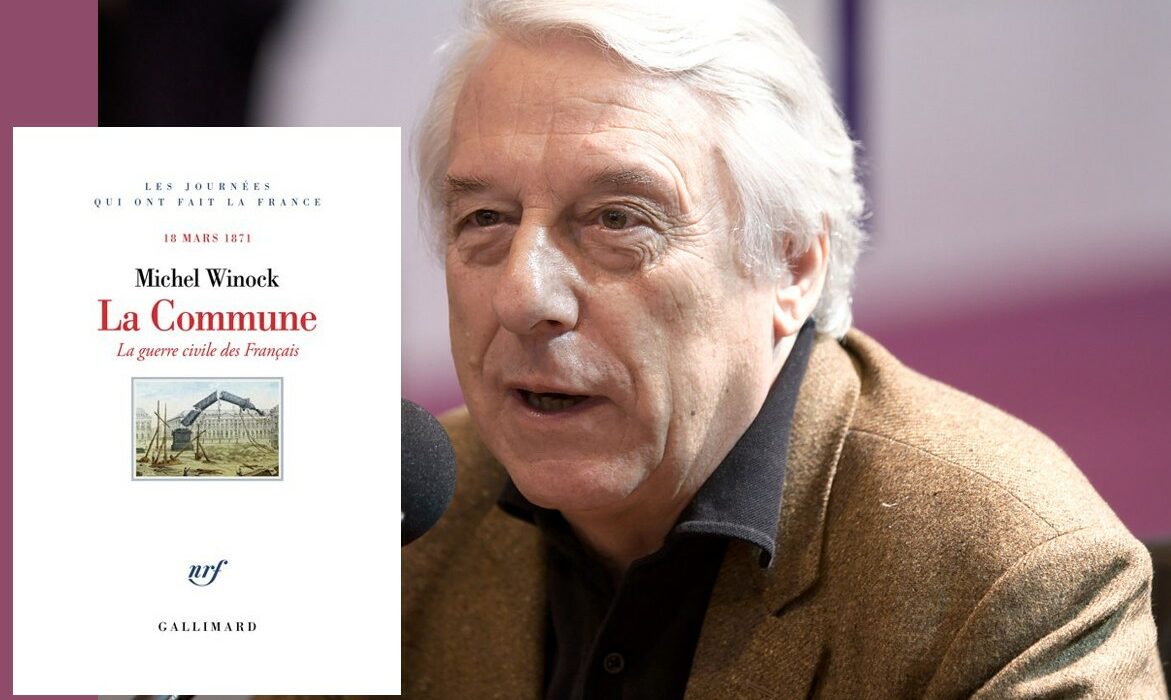La crise de la dette se mêlant à celle de la représentation, une sorte de populisme émerge à bas bruit. Ce que nous étions en droit d’analyser jusqu’alors comme un symptôme semble devenir une possible et redoutable alternative ! Nous sommes dès lors en droit de nous interroger: que reste-t-il du contrat social et du principe républicain de souveraineté partagée ?
L’apparente dépolitisation des choix économiques
Les chiffres saturent le débat politique et les esprits. La dette publique (115% du PIB), le déficit à 5,1%, l’incertitude quant à la note souveraine: voilà que ces données, quotidiennement rappelées par la presse, informent le discours gouvernemental et s’imposent comme des priorités politiques. La France est sur le fil: elle doit maîtriser ses finances, au risque de perdre la confiance des marchés, voire d’exposer l’euro à une nouvelle crise, selon certains économistes. Ils n’ont pas tort. Mais ce discours n’est pas nouveau; il s’est radicalisé depuis 2024. On se souvient des alertes des agences de notation. L’Assemblée devra se prononcer le 8 septembre sur le projet de loi de finances 2026. Les coupes dans les dépenses sociales, le gel des recrutements publics, les réformes structurelles différées, etc., ne laissent guère de doute quant au résultat du vote. Loin de nous l’intention de minimiser la crise économique que traverse la France ou de nier, comme certains, l’importance de la dette. Mais, en y réfléchissant bien, il apparaît qu’en s’autonomisant, le cadre économique dicte désormais ses normes au politique. Les règles, les logiques, les impératifs économiques semblent de plus en plus fonctionner indépendamment du contrôle politique, dont les décisions sont largement, sinon exclusivement, influencées par les institutions comme le FMI, la BCE, la Commission Européenne. Il faut donc respecter des règles économiques strictes (compétitivité, ouverture à la concurrence…), s’aligner sur des exigences économiques au détriment de choix politiques dits souverains. Là encore, il ne faut pas voir dans ces lignes une position souverainiste, mais le constat que les choix sociaux, démocratiques, sont invariablement soumis à des logiques de rentabilité et d’efficacité économiques. Quelles que soient leurs orientations politiques (de droite comme de gauche), tous les gouvernements disposent de peu de marge de manœuvre puisque tous doivent «rassurer les marchés» ou ne pas faire fuir les investisseurs. Si des décisions, au lieu de relever d’un débat démocratique, sont d’abord des nécessités techniques dictées par un système économique globalisé et apparemment impossible à remettre en cause, il est permis de comprendre que de nombreux citoyens aient le sentiment que leur vote ne changera rien. N’est-ce pas là la cause profonde de la crise politique, sociale et démocratique que notre pays traverse aujourd’hui ?
Une colère sans débouché
Le coût démocratique de cette gouvernance par la dette est indéniable. En se faisant au nom de la soutenabilité, les choix budgétaires sont perçus comme profondément injustes. Les sacrifices font concurrence aux réformes, les responsabilités individuelles (et générationnelles !) effacent la solidarité. Et les classes populaires et moyennes, interrogées lors de micro-trottoir, interprètent cette rigueur comme une forme de déclassement programmé. Comme la rupture du pacte républicain. C’est dans ce sentiment de vide que le populisme prospère. Il faut le constater : les partis traditionnels ne sont plus porteurs d’espérance collective. Le centre ne se renouvelle pas, la gauche est durablement divisée, la droite classique est marginalisée. Alors le Rassemblement National avance avec méthode, discipline et patience. Non que son propre discours le rende crédible. Il se construit sur la faiblesse des discours de ceux qui s’en tiennent systématiquement, sans nuances ni esprit de compromis à d’inlassables injonctions d’efficacité ou de réformisme strictement budgétaires. La réalité sociale passe au second plan, lorsqu’elle n’est pas ignorée. Celle de la précarité énergétique, celle des conséquences de la désindustrialisation, celle de l’abandon de territoires entiers. Tous les appels à la responsabilité sont vains, sans écho. Ne nous méprenons pas: le vote populiste, celui de gauche comme de droite, n’est pas uniquement protestataire. Il est perçu, à tort, comme un moyen de réintroduire une conflictualité, sinon un consensus, dans un espace politique vécu comme verrouillé. Il nourrit de nouvelles illusions: l’ordre, la volonté de rendre la parole au peuple, d’éliminer les intermédiaires inutiles (sans vraiment les identifier clairement). Promesses chimériques mais qui deviennent crédibles dans une démocratie où le Parlement apparaît paralysé, où l’exécutif se perd dans sa verticalité.
Un cercle vicieux
Depuis les élections de 2022, après les multiples recompositions de 2024, l’Assemblée nationale ne fonctionne qu’en mode […]