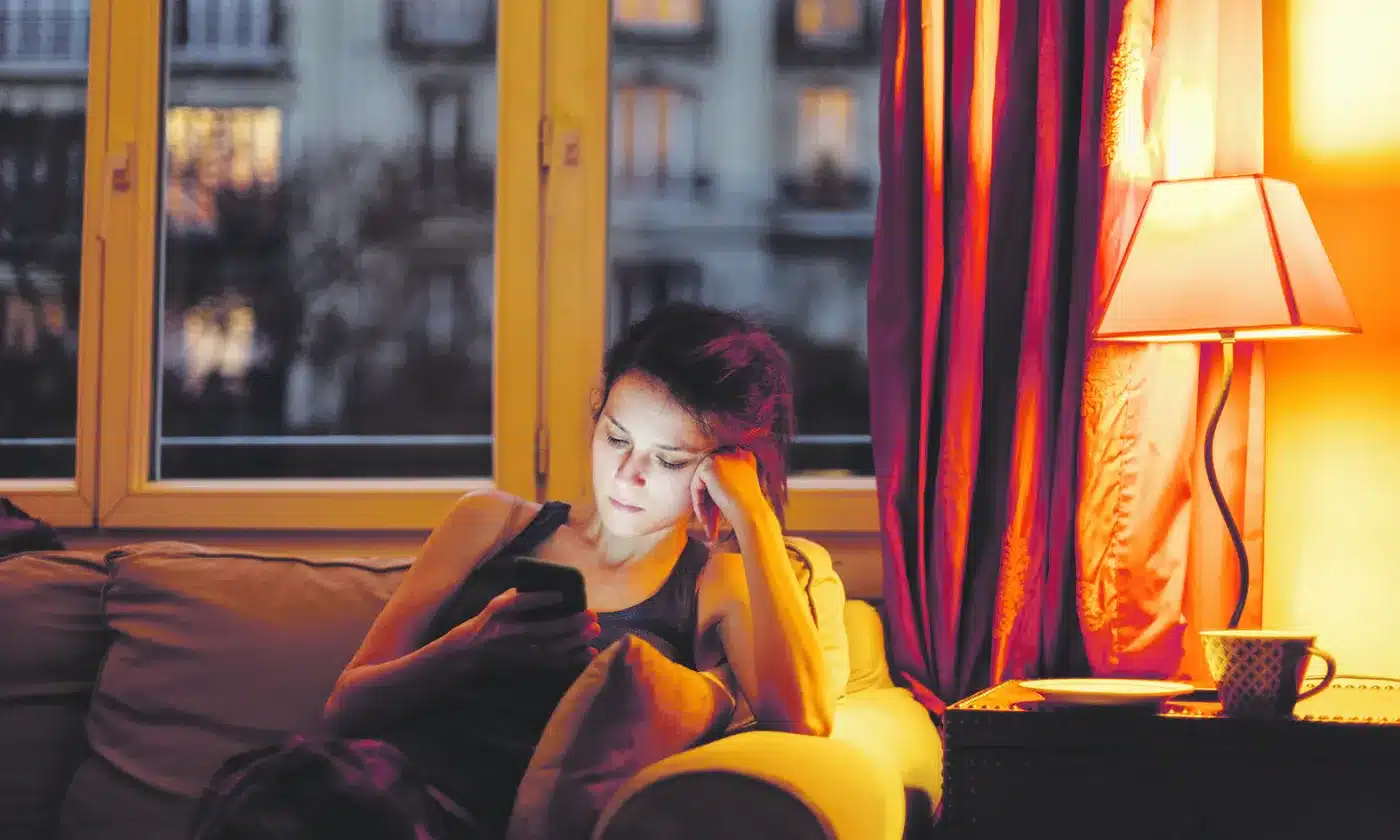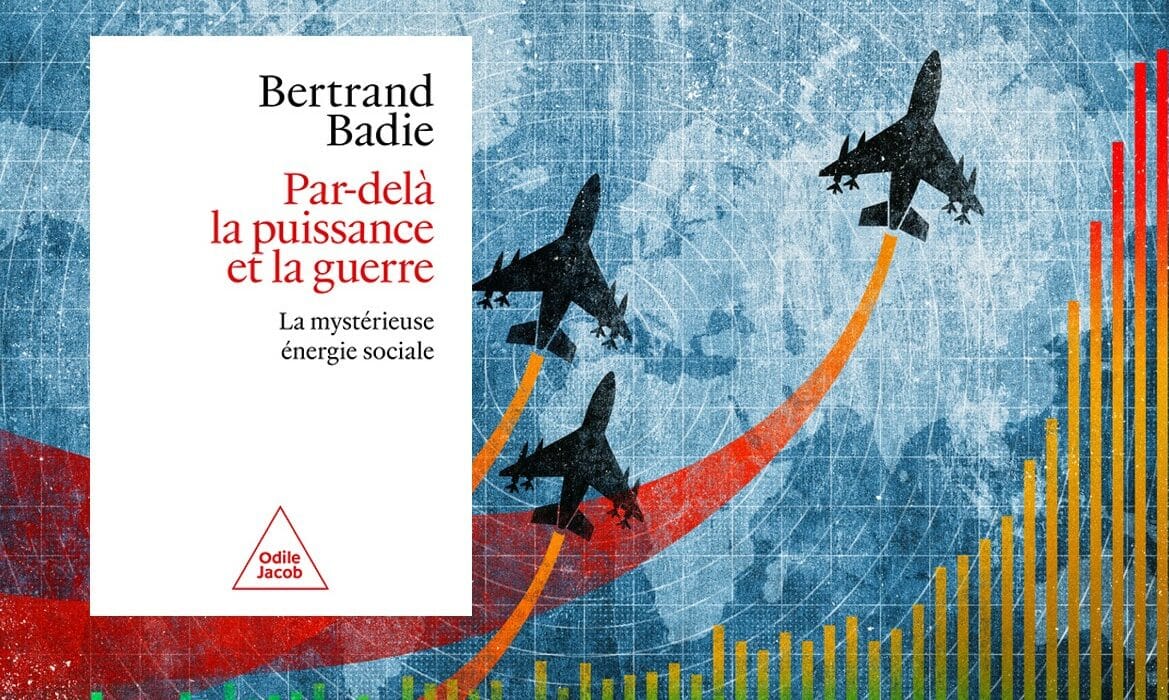Les chiffres, il les connaît par cœur. « En dix ans, on a perdu 40 000 membres. » Directeur du Département théologie et éthique de l’Église protestante de Suisse (EERS), Stephan Jütte – qui est comme nos trois autres interlocuteurs invité d’un colloque consacré à ce sujet – est ultra-conscient de la situation difficile de l’Église, de l’image négative que traînent l’institution et ses paroisses. « Ennuyeuse, bureaucratique, pensée pour les personnes âgées… » Il reconnaît que les Églises protestantes affrontent de sérieux défis.
La formation des pasteurs ? À repenser, selon lui, pour être « plus orientée sur les compétences comme l’accompagnement spirituel, la résolution de problèmes, que sur le savoir, les langues anciennes ». Par ailleurs, « toutes les compétences ne doivent pas reposer sur le ou la pasteur•e, les communautés doivent être plus outillées ».
Stephan Jütte constate aussi qu’alors que les protestants sont très actifs – actions caritatives, travail d’aumônerie, de jeunesse… –, ils sont peu doués pour le partager, donner envie. « On a une offre intéressante. On aide les gens à surmonter leurs deuils, à répondre à leurs questionnements avant un mariage, à relever des défis personnels… Mais on est incapables de rendre ce travail lisible et attractif. » Autre autocritique: l’organisation interne. « Chacune de nos 24 Églises a son logo, ses couleurs, son instance dirigeante, son community manager, son programme… C’est illisible pour le grand public. »
Une question de posture
Bruce Gordon, enseignant-chercheur à la Yale Divinity School (États-Unis) et spécialiste de la Réforme suisse, relativise. « Au XVIe siècle, les réformateurs avaient […]