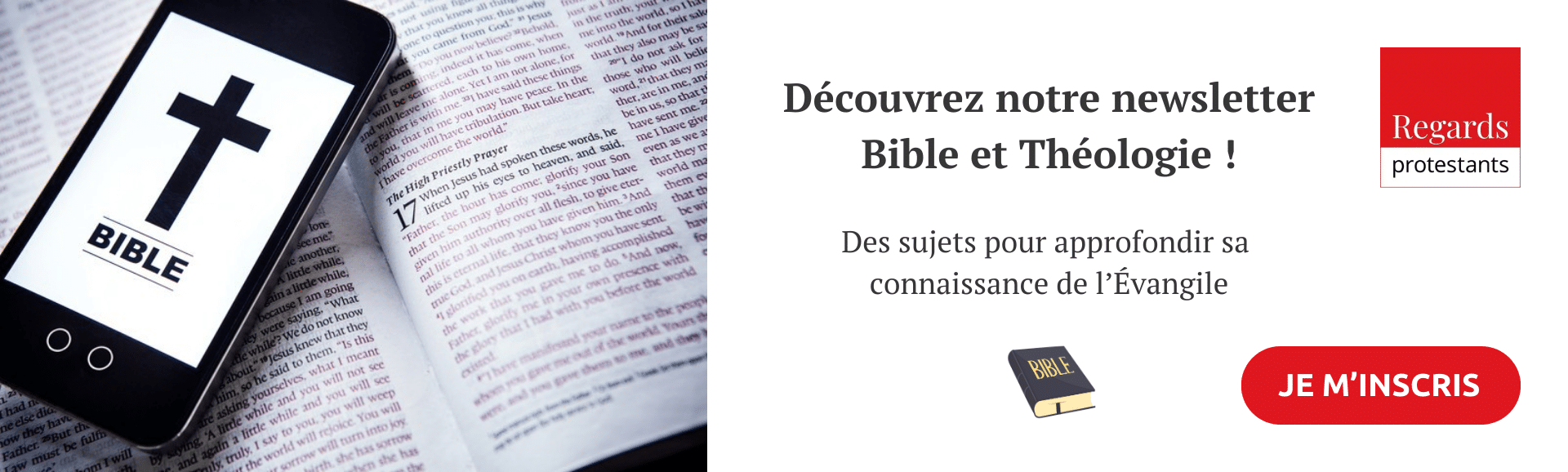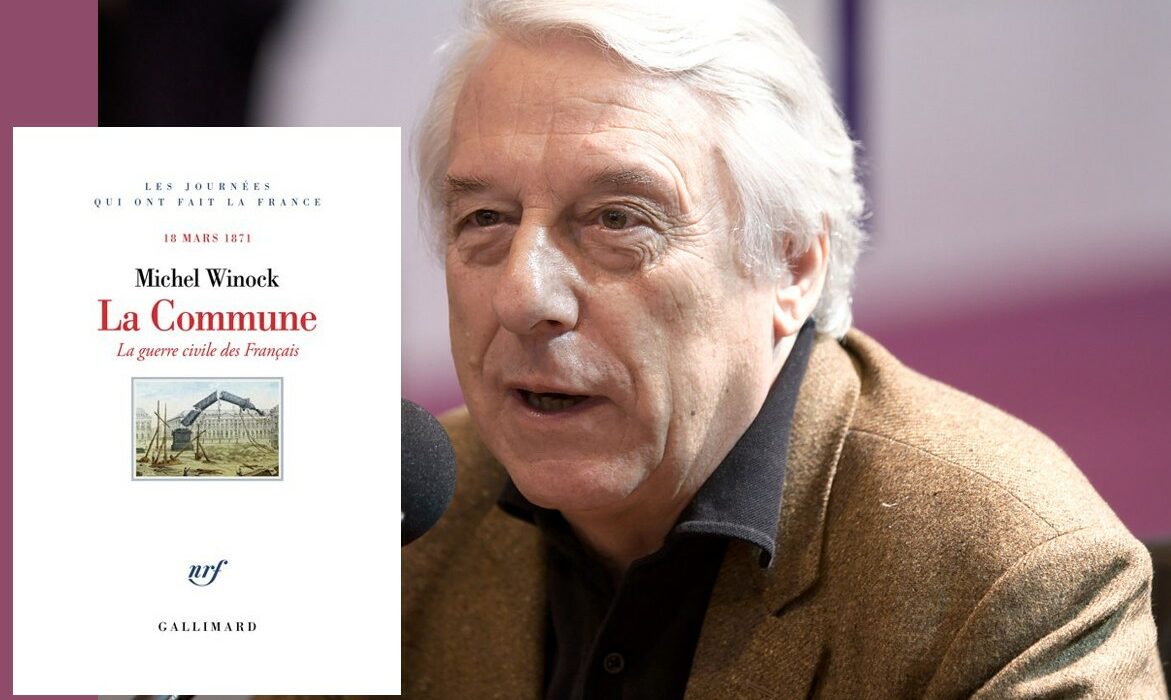Un juriste demande à Jésus ce qu’il faut faire pour avoir la vie éternelle. Ce spécialiste a évidemment une idée de la réponse mais il espère mettre au jour la transgression de Jésus sur des points fondamentaux de doctrine. Jésus ne se laisse pas piéger et renvoie son interlocuteur aux deux principaux commandements de la loi, aimer Dieu et aimer son prochain, conformes à la doxa juive. Il suffit d’une mise en pratique. Fin de la discussion pour Jésus.
Qui est mon prochain ?
Mais le juriste n’en reste pas là et demande : « Qui est mon prochain ? » Jésus raconte alors l’histoire d’un homme que des brigands ont laissé à moitié mort sur la route reliant Jérusalem à Jéricho. Un lévite et un prêtre passent par là mais n’ont pas un geste pour le blessé alors qu’un Samaritain, qui emprunte la même route, prend soin de la victime. Ce n’est pas Jésus qui conclut cette histoire puisqu’il retourne sa question à l’homme de loi : « Lequel des trois s’est montré le prochain de l’homme qui était tombé sur les bandits ? » Le juriste est bien obligé de reconnaître que c’est le Samaritain qui s’est montré le prochain de l’homme blessé.
Le prêtre et le lévite sont mentionnés dans le récit car, par vocation, ils sont consacrés à Dieu et à leurs prochains. L’histoire oppose donc des gens à la vie supposée sainte, dont on attend qu’ils viennent en aide à autrui, à un Samaritain, étranger haï par les Juifs pieux. Pourtant, le prêtre et le lévite décident – estiment ? – qu’ils n’ont pas besoin d’aimer cet anonyme blessé et passent leur chemin.
La loi de l’amour l’emporte
Jésus, en racontant cette histoire, sait que le juriste voudra mettre des limites à la pratique de l’amour du prochain. Il voudra se sentir justifié par une interprétation traditionnelle, procédant « par restriction légale plutôt que par amplification d’amour », selon les mots de Paul Ricœur (Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990). Le juriste admet finalement que c’est le Samaritain qui a accompli la loi et il ne prend pas la défense du prêtre et du lévite.
Jésus souligne, dans ce cas, ce que le philosophe Emmanuel Kant appelle une maxime subjective de la volonté, une manière d’agir qui ne répond pas simplement à une obligation légale mais une libre adhésion au devoir. Pour le dire autrement, la loi ne connaît pas les visages et elle ignore les larmes. Emmanuel Kant écrit : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité en ta personne comme en celle d’autrui, toujours en même temps comme une fin, jamais comme un moyen » (Fondement de la métaphysique des mœurs, Paris, Livre de Poche, 1993).
Dans cette perspective, le Samaritain agit moralement car il reconnaît dans l’homme blessé un être de dignité. Il ne répond pas simplement à une règle rationnelle, il dépasse la froideur du devoir pour rejoindre une proximité plus incarnée. Le prêtre et le lévite incarnent une certaine institution : ils croient obéir à un cadre mais ils en fixent eux-mêmes les limites et font fi de la réalité du prochain. Ils n’entrevoient pas combien sa présence est provocation.
Le message de Jésus est clair : peu importe que le blessé soit juif ou non, digne ou indigne, mort ou vivant, pur ou impur, parent ou étranger ou même ennemi. Il est quelqu’un qui a besoin d’un prochain. Pour Jésus, le Samaritain relève l’essence de la loi et si la loi est faite pour l’homme, elle ne peut jamais suffire à dire ce qu’est l’homme. C’est cet élan intérieur que l’on nomme foi, charité, responsabilité, sollicitude qui compte. Il rend l’action humaine pleinement vivante.