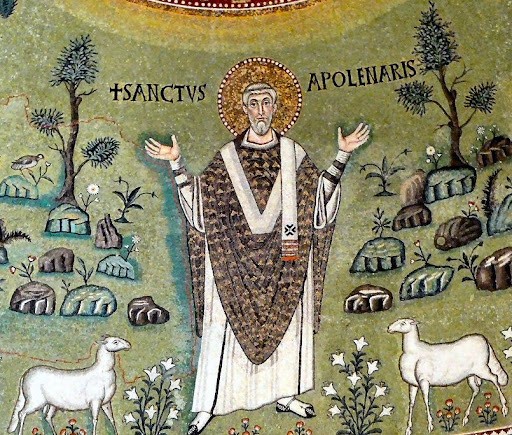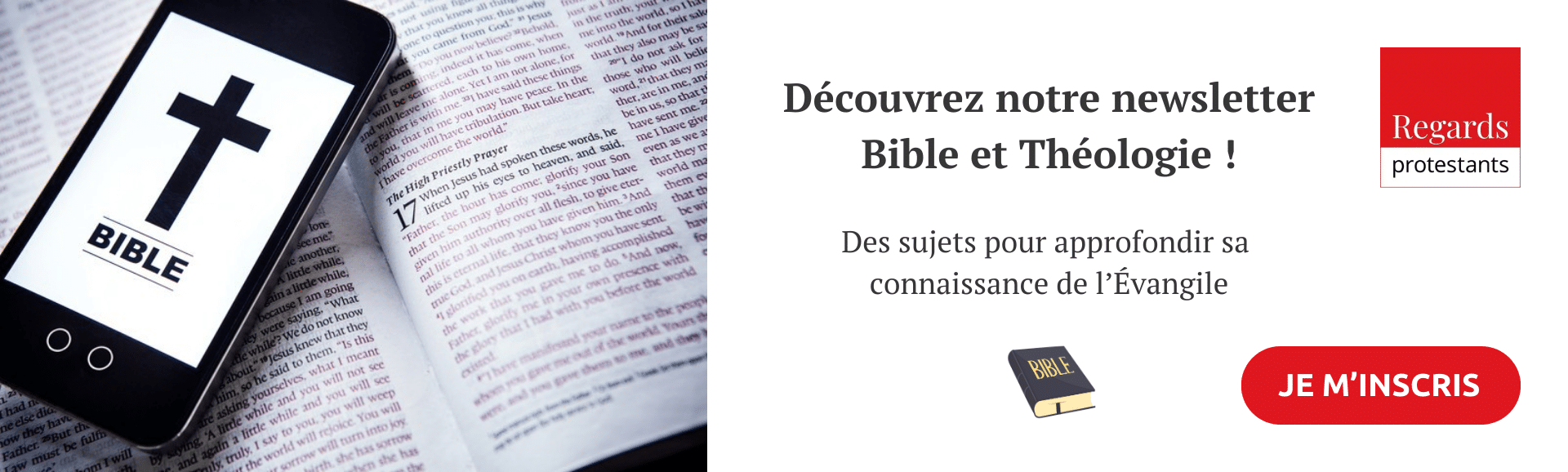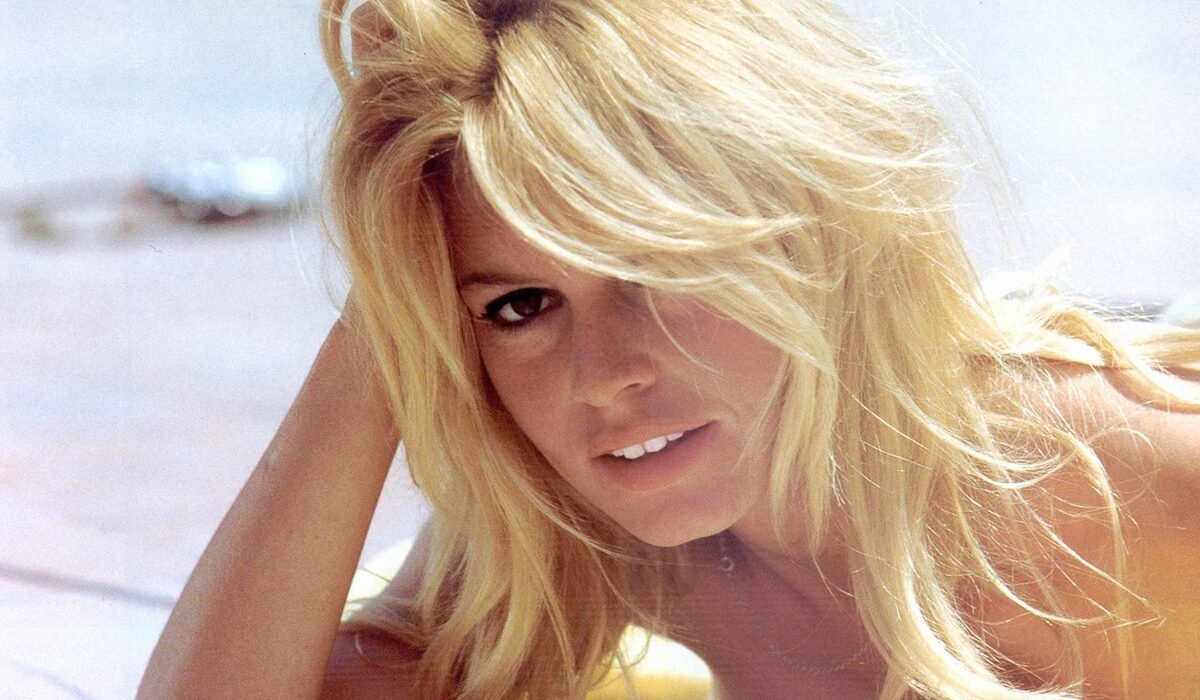Les proches de Jésus sont souvent déroutés par ses prises de position sur quantité de sujets. Jésus demande que l’on aime ses ennemis, que l’on parte chercher la brebis perdue en abandonnant les quatre-vingt-dix-neuf autres, il affirme qu’il y a « plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance » et prétend que les collecteurs d’impôts et les prostituées précéderont les bons croyants dans le royaume de Dieu (Luc 6.27, 15.4, 15.7 et Matthieu 21.31). Les apôtres qui suivent Jésus doivent sans cesse remettre en question leurs certitudes dogmatiques sur des questions quotidiennes.
Ni performance ni prouesse
Le monde n’est donc pas partagé entre le pur et l’impur, les bons et les mauvais, le sacré et le profane. Avec Jésus, les frontières tracées de tout temps entre ces réalités deviennent poreuses. Si les apôtres ne peuvent pas intégrer ces évolutions, c’est que leur foi n’est pas assez forte, d’où cette demande adressée à Jésus. Comme si la foi était une grandeur mesurable et pouvait être dopée par quelqu’un d’extérieur. Comme si la foi avait pour fonction première de rassurer l’homme sur le monde.
Jésus répond aux disciples par l’absurde en mettant en parallèle la taille modeste d’un grain de moutarde, symbolisant l’intensité de la foi, et un mouvement aussi inutile (et spectaculaire) qu’un sycomore se plantant dans la mer. Mesurer la foi, c’est l’assimiler à une performance, une prouesse, une conformité extérieure dans un acte ostensible. Ce qui était vrai du temps de Jésus l’est a fortiori aujourd’hui tant nos sociétés sont marquées par l’idéal scientifique et le désir d’objectiver toute chose. La foi elle-même peut être tentée de se justifier, de se démontrer, de se traduire en comportement mesurable.
Une libre adhésion
La foi est d’abord un consentement à ce qui ne se laisse ni posséder ni prouver. La foi ne s’étalonne pas, elle se vit dans l’instant, dans la solitude d’un rapport avec le divin que le philosophe danois Kierkegaard appelle « la subjectivité passionnée ». La foi n’est pas l’opposé de la raison mais surgit là où le raisonnement s’arrête. Le savoir se fonde sur des preuves, des démonstrations, une objectivité partagée. La foi, au contraire, suppose un saut, un engagement sans garantie, une décision intérieure en réponse à un appel qui dépasse la raison.
Toutes les preuves prétendument scientifiques de la foi ne reposeront jamais que sur un malentendu. La foi est une libre décision de notre subjectivité et n’a que faire d’une objectivité, à la manière de la requête des apôtres, qui tenterait de l’arracher à la douleur de l’engagement. C’est en cela que consiste la vérité de la foi : on s’y engage, on marche sur le chemin mais on ne possède pas cette vérité qui est toujours devant nous.
Reste un point essentiel à notre propos : s’il est entendu qu’elle est incommensurable et non objectivable, la foi doit se reconnaître à l’amour. L’amour est la manifestation nécessaire et extérieure de la foi intérieure. L’apôtre Jean fait dire à Jésus dans son Évangile : « À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jean 13.35). Il existe incontestablement un rapport étroit entre foi et charité. On pourrait l’envisager comme un élément de réponse à la question des apôtres.