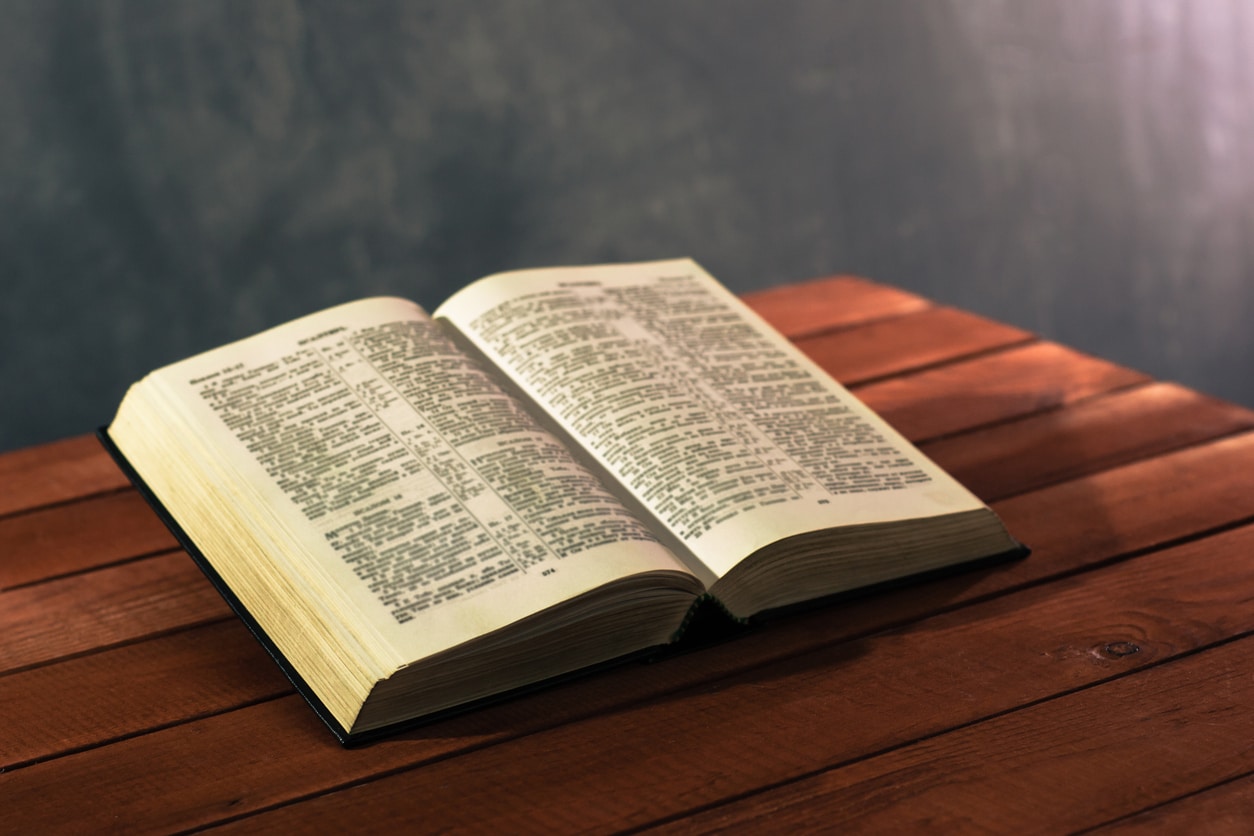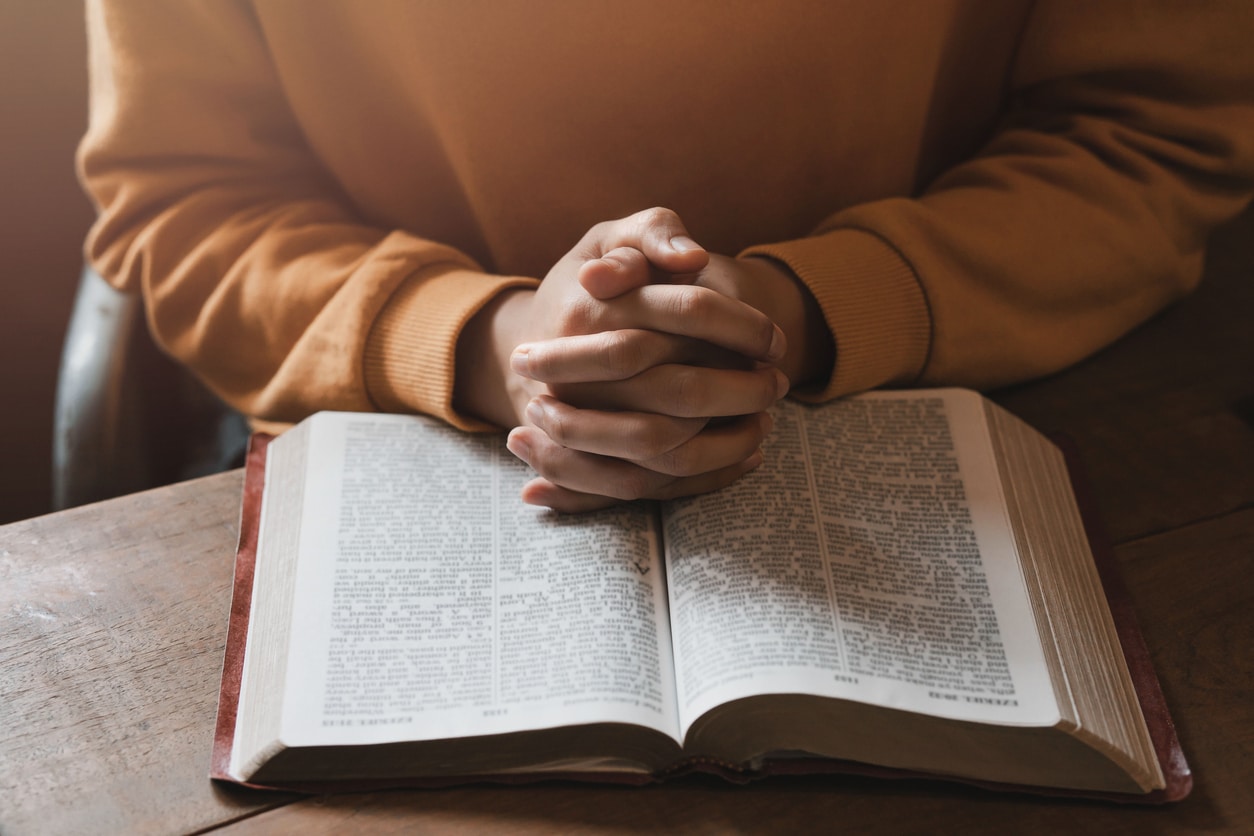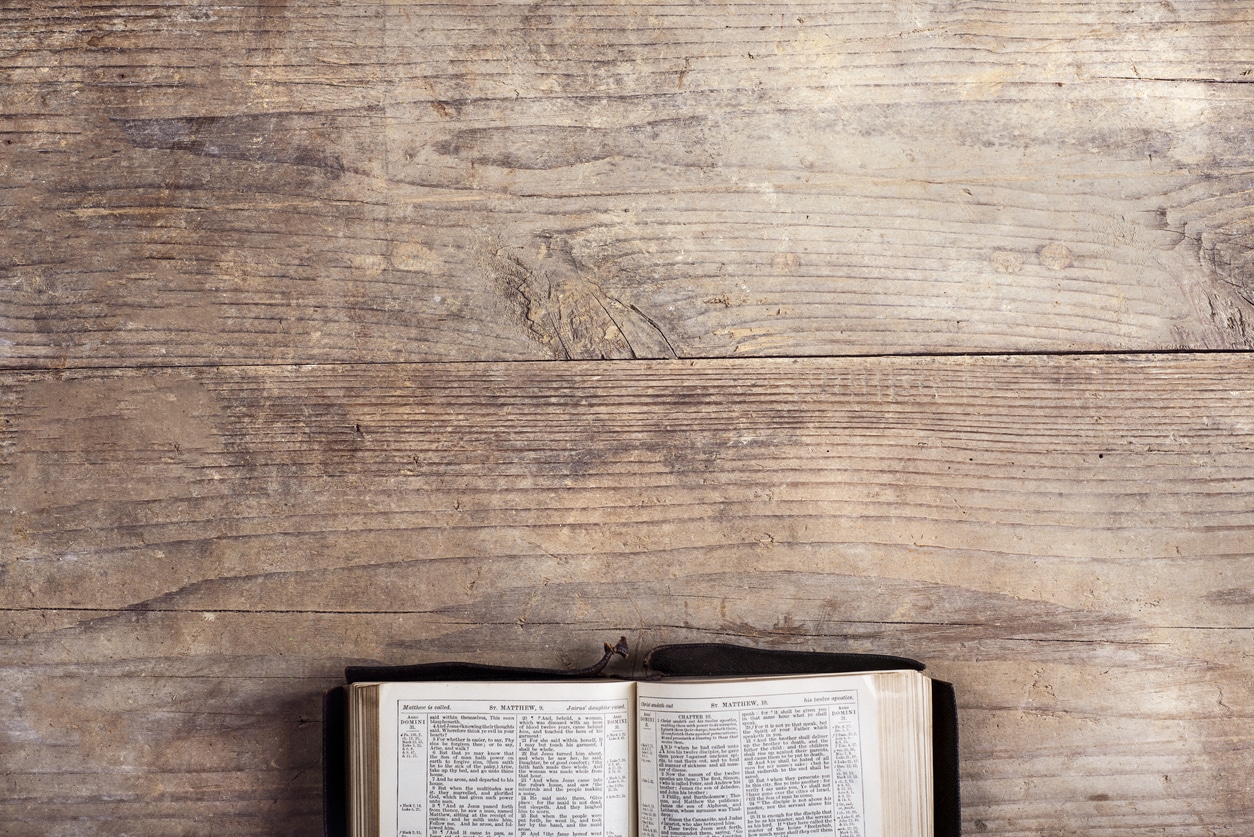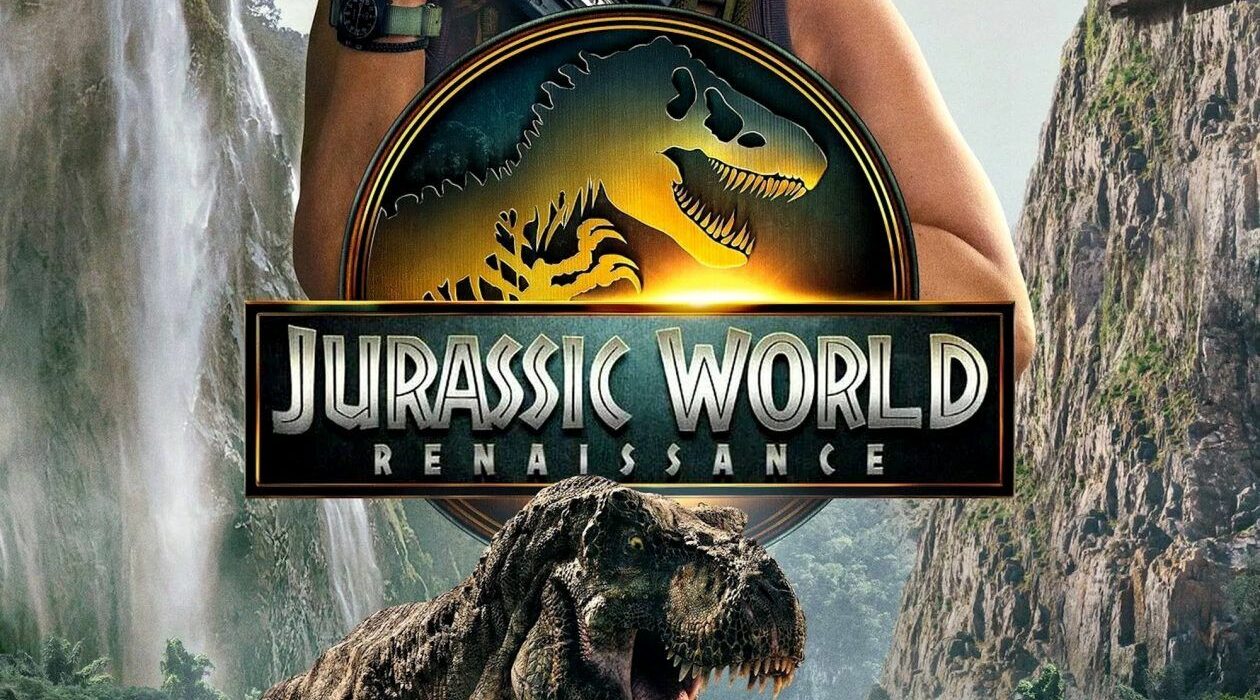Il y a une question qui m’a toujours intrigué. Pourquoi, alors qu’on n’a en soi-même, qu’un sens du « divin » tout à fait imprécis et évanescent, en vient on à croire aux articles de foi tout à fait spécifiques et quelquefois déconcertants d’une religion donnée, ceux du christianisme par exemple ? Autrement dit, pourquoi et comment, alors que spontanément et naturellement nous n’avons en nous, au mieux, qu’une forme de « spiritualité » et de « religiosité », nous en venons néanmoins à devenir « chrétien », avec tout ce que cela implique.
De fait, être chrétien, qu’on le veuille ou non, et même si on est « libéral », c’est se reconnaître dans un certain nombre d’articles de foi enseignés par la Bible, l’Eglise et la tradition chrétienne. C’est adhérer, d’une manière ou d’une autre, à un ensemble de doctrines spécifiques et quelque peu surprenantes (n’ayons pas peur des mots) et de pratiques qui le sont autant (le baptême, l’eucharistie…). Et celles-ci n’ont guère de rapport, a priori, avec notre « spiritualité » et notre « religiosité » quelle qu’en soit la forme.
Le sentiment religieux est psychique et peut-être inné. En revanche, les énoncés des religions, et en particulier ceux du christianisme, relèvent de l’acquis, c’est-à-dire de la culture, des conventions et des modes d’expression propres à une société donnée. On voit la différence. Et, de fait, on peut se le demander: Comment et pourquoi passe t-on de l’un à l’autre? Cela ne va pas de soi. Il y a en effet un « saut qualitatif », un décalage et même une cassure, entre le sentiment religieux (qu’il soit panthéiste, superstitieux, mystique, New Age etc. ) et l’adhésion au catéchisme du christianisme.
D’où la question : Comment se fait ce saut ? Et pourquoi se fait-il ?
L’escargot et le bernard-l’hermite
Pour tenter de répondre à cette question, je voudrais user de métaphores animalières.
Et d’abord celle de l’escargot et du bernard l’hermite. Il y a une différence entre ces deux sympathiques créatures. L’escargot secrète lui-même sa coquille. En revanche, le bernard l’hermite cherche à trouver une coquille vide. Et quand il en trouve une, il s’y loge. S’il n’en trouve pas, il meurt.
On pourrait supposer que la foi chrétienne est du type escargot. Le sentiment religieux sécréterait de lui-même sa coquille, c’est-à-dire le système théologique (le Credo) et les pratiques cultuelles (les rituels, les liturgies, les sacrements) de la religion chrétienne. Les articles de foi du christianisme seraient l’expression, sous la forme d’un discours doctrinal ou symbolique, de l’expérience intérieure des chrétiens (besoin d’être secouru, besoin d’un père idéalisé, expérience du sacré et du mystérieux, sentiment de dépendance etc.). Ils auraient pour fonction de développer et de conceptualiser le sentiment religieux inhérent à la psyché humaine. Ils seraient une expression parmi d’autres de la « religion naturelle » de l’être humain. C’est cette position qui a été développée en son temps par le symbolo-fidéisme du protestantisme libéral de la fin du XIXème siècle.
Mais en fait, me semble t-il, il n’en est rien. A la métaphore de l’escargot, je préfère celle du bernard-l’hermite. Et ce pour plusieurs raisons. Le chrétien ne forme pas de lui-même sa foi chrétienne. Sa foi chrétienne n’est pas, comme la coquille de l’escargot, une excroissance de sa « religion naturelle ». Il faut plutôt dire que, comme le bernard-l’hermite, le chrétien a rencontré la coquille du christianisme et qu’il s’y est logé. Il a rencontré cette coquille par hasard parce qu’il est né dans une famille chrétienne ou parce que, par exemple, étant en recherche, il est entré dans une église. Et de ce fait, il est devenu chrétien. Il a découvert un enseignement, une pratique, une communauté ; et il s’y est « logé ». Mais, en tout état de cause, le Christianisme, en tant que religion constituée, était déjà là avant qu’il n’y fasse sa demeure. Comme la coquille pour le bernard-l’hermite, le christianisme constituait une structure préexistante et préformée; et elle était indépendante de sa quête spirituelle et de sa religiosité.
De fait, il faut le reconnaître, le contenu doctrinal du christianisme n’a pas son assise et sa source dans la vie spirituelle, intime et psychique des fidèles. Il s’enracine dans la prédication d’un Prophète (Jésus-Christ) qui va à l’encontre des attentes de son peuple. Puis, siècle après siècle, l’enseignement des Eglises s’est développé, transformé et reconstruit sur un mode purement théologique. De fait, reconnaissons-le, le christianisme consiste en un système d’axiomes et d’affirmations a priori. On pourrait dire qu’il constitue un « château en l’air » qui ne se fonde que sur lui-même.
Et pourtant c’est dans ce « château » que le chrétien, comme le bernard-l’hermite, fait sa demeure. En fait, le chrétien ne croit pas de lui-même au Dieu du christianisme. Il adhère à ce que l’Eglise enseigne à son sujet. Ce n’est pas la même chose. Il « se fait » à cette « coquille ». ll se moule à elle. Il s’y conforme. Il y prend ses habitudes.
Le scarabée et sa carapace
Et dès lors, (peut-être « par l’opération de Saint Esprit » !), le « croyant bernard-l’hermite » se métamorphose en « croyant scarabée » ! Ce qui caractérise le scarabée, c’est que, si on lui enlève sa carapace, il meurt. A la différence de la coquille dans la quelle se loge le bernard-l’hermite, sa carapace est partie intégrante de lui-même et de son processus vital. Elle fait partie de lui.
De la même manière, pour le « croyant » (usons de ce mot, faute de mieux) qui adhère à la structure d’une religion donnée, le christianisme par exemple, on ne peut plus distinguer, dans l’expression de sa foi, ce qui est de lui (sa religiosité) et ce qui est de nature culturelle et qu’il a acquis par le milieu social dans lequel il est intégré. Pour lui, comme pour le scarabée, c’est tout un; c’est un tout indissociable.
Certes, les doctrines théologiques véhiculées par le christianisme n’ont rien à voir avec nos croyances spontanées. Certes, elles peuvent être vues comme une carapace qui se superpose à l’ « essence » du christianisme et de la foi chrétienne, si tant est qu’il y en ait une. Mais, il n’en reste pas moins que ces articles de foi forment, transforment et suscitent notre expérience spirituelle elle-même. Ainsi pour beaucoup de catholiques, l’eucharistie est devenue un viatique. Pour les protestants, c’est (ou c’était) le lecture de la Bible et le chant des psaumes. Et pour les orthodoxes, c’est la certitude que le « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ».
Certes, la plupart des articles de foi du christianisme peuvent être considérés comme des « fictions » propres à une culture spécifique (au même titre que le totémisme, par exemple). Mais ces fictions sont devenues partie prenante de la vie spirituelle du chrétien. Celui-ci les « internalise » dans sa psyché et sa vie spirituelle. Elles « performent » en lui non seulement des pratiques, mais aussi des sentiments, des élans et des convictions intenses.
Et c’est pour cela que toutes les entreprises de démythologisation et de dé-dogmatisation du christianisme me paraissent vouées à l’échec. Il est néfaste et contreproductif de retirer à la foi chrétienne la carapace des articles de foi de son Credo. Cela le ferait mourir, ou du moins s’étioler.
De fait, le renouveau du christianisme, qu’il soit catholique ou protestant se fait par le renouveau du dogmatisme, du ritualisme et du communautarisme. On peut le regretter. Mais c’est comme ça.
Le poussin et son ballon
Mais je terminerai par une autre métaphore animalière.
Un oisillon, une fois l’œuf éclos, suit le premier animal qu’il rencontre, que ce soit sa mère ou un autre animal (cf. le conte d’Andersen du vilain petit canard). Bien plus, un poussin qui, à sa naissance, et fortuitement, s’est collé à un ballon de caoutchouc l’adopte comme sa mère. Le ballon laisse une « empreinte » sur le poussin qui va dès lors établir avec cet objet des liens d’attachement personnels, d’adhérence et de fixation. La prédisposition à l’empreinte est innée, mais l’objet (le ballon) sur lequel elle se porte relève de l’acquis.
On peut voir la prédisposition du sujet religieux à adhérer à la religion qu’il rencontre d’une manière ou d’une autre comme relevant d’un phénomène d’empreinte. De fait, puisque le sentiment religieux est, en particulier, désir, manque, angoisse d’être abandonné, appel à une protection, il suscite une prédisposition à s’attacher.
Tout comme le poussin s’attache au ballon, le sujet religieux, poussé par la « semen religiosis » (la semence de religion) qui est en lui, adhère à la religion avec laquelle il est fortuitement mis en contact. Il s’attache, au sens le plus fort, et se greffe sur une culture religieuse donnée et spécifique. Il y fait sa demeure; il se l’approprie; et en l’habitant, il lui donne un fondement et une vérité (cf. A. Houziaux, Christianisme et besoin de dogmatisme, Berg International, 2015).
Pour le dire autrement, le croyant a peut-être conscience que ce qu’il croit est une croyance culturelle, mais il le croit quand même de tout son être. Certes, ce à quoi il croit peut être vu comme une illusion, tout comme le ballon en est une pour le poussin. Mais cela n’empêche pas que le lien qu’il a avec elle est tout à fait authentique et même viscéral. Comme le poussin, le chrétien adhère au « ballon » du christianisme par un phénomène d’adhérence plus encore que d’adhésion.
Ainsi la foi pourrait n’être qu’une « foi d’animal », pour reprendre l’expression de La Fontaine dans la fable La cigale et la fourmi.
Ce texte a précédemment paru dans la revue Golias Magazine