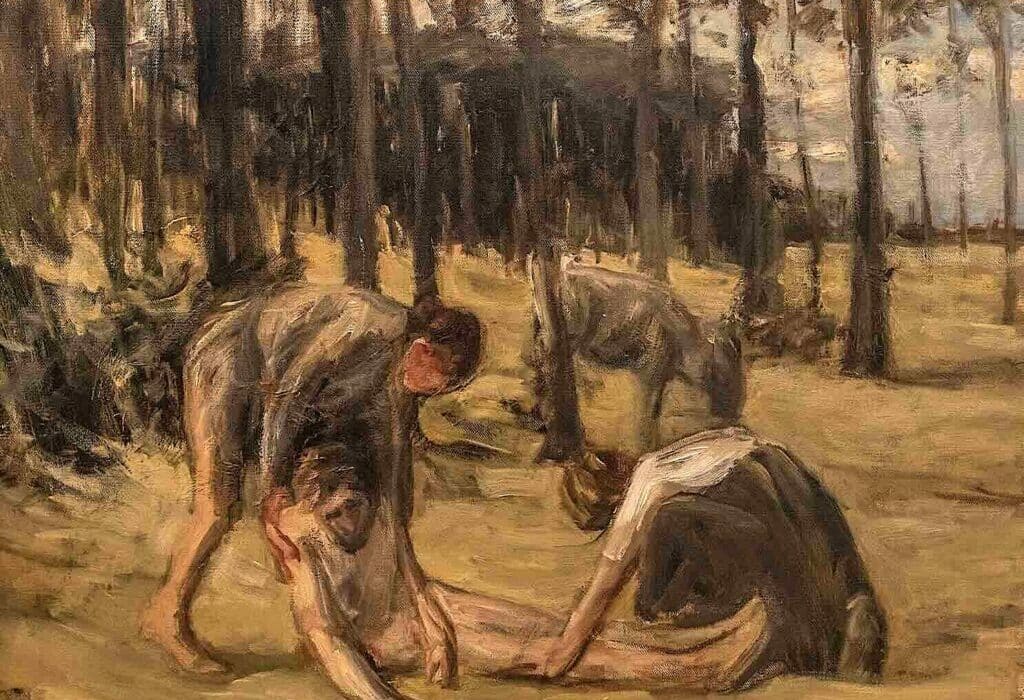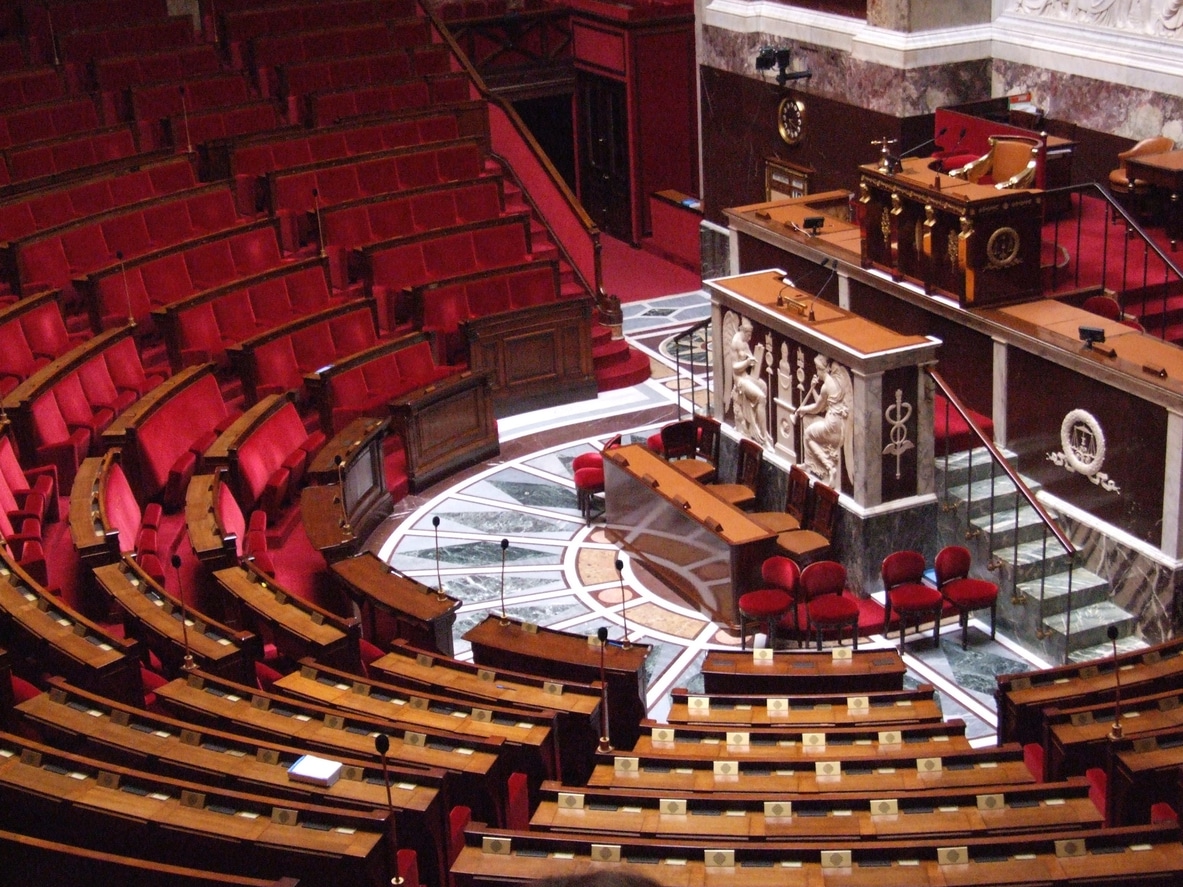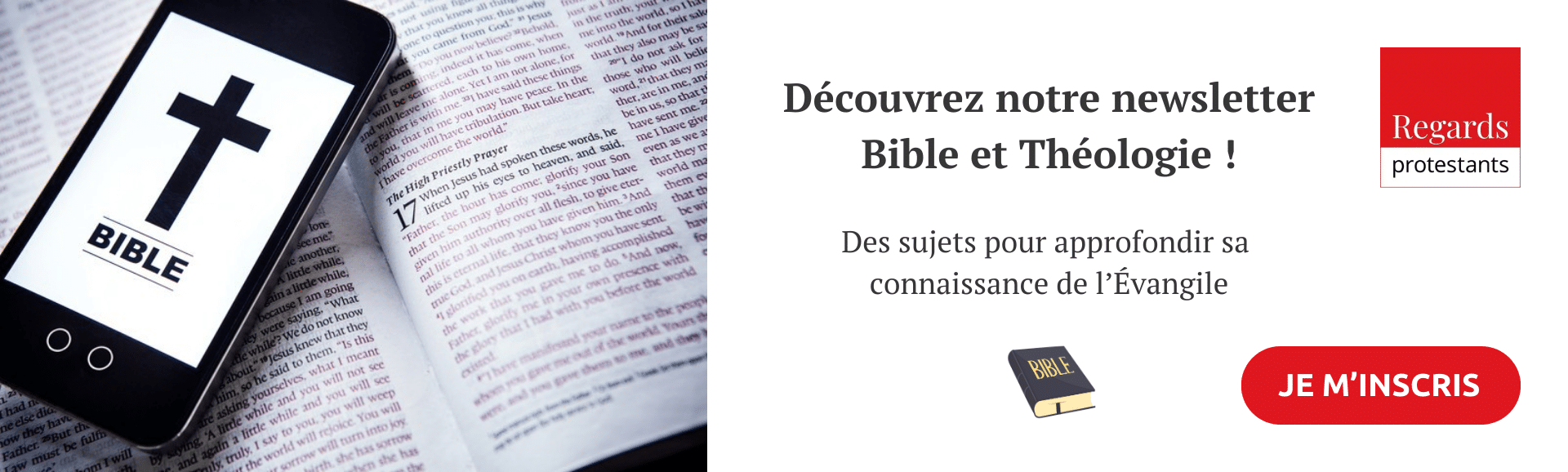«Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique, 19,18).
« L’autre devient vraiment ‘toi’ quand il n’est pas un motif ou un obstacle à mes décisions, mais lorsqu’il m’enfante par le foyer même de ma décision, m’inspire par le cœur de ma liberté » (Paul Ricœur (1))
« Je ne peux pas voir vers quelqu’un ‘les mains vides’. L’appel à l’aide qui émane d’autrui exige que je renonce à mon existence égoïste et me sacrifie pour lui » (Emmanuel Levinas (2)).
Un commandement toujours actuel ?
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il semble que le commandement biblique que nous portons tous en nous, du moins dans nos mémoires, ne résonne plus, ou sonne creux, dans notre société. Il n’illumine peut-être plus autant qu’on le souhaiterait nos vies. Aimer son prochain comme soi-même… Précepte central de la Thorah, répété à l’envie, y compris sur un mode négatif emprunté au rabbin Hillel («Ce que tu n’aimes pas qu’on te fasse, ne le fais pas aux autres» (3)) ou rappelé à plus ou moins bon escient en guise de remontrance, mais si souvent ignoré, piétiné, où mal interprété. Même s’il n’est pas toujours totalement compris, chacun, croyant ou incroyant, comprend d’abord que c’est un appel à la bienveillance, à l’empathie – ce mot si fréquemment utilisé (se substituant au mot fort sympathie) au point d’être vidé de son sens –, au respect de l’autre et de soi-même (4). Commandement qui porte en nous l’écho de ces formules qui créent de la joie et de l’espoir, redonne de la confiance, mais qui réveillent aussi la douleur d’une faute, et d’un remord. Ai-je toujours répondu en mon âme et conscience au commandement divin: «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» ? L’ai-je bien compris ? Ai-je bien compris aussi la parabole du bon Samaritain, la réponse narrative de Jésus à la question de l’identité de «mon prochain» ? Parabole si souvent relue, si souvent réinterprétée (5), porteuse d’un sens si profond qu’on éprouve toujours le sentiment qu’il nous échappe un peu. Mais peut-être, contrastant avec nos vies, avec nos actes, craint-on de trop bien la comprendre ?
Comment notre société qui exacerbe la culture de la primauté du moi et de l’individualisme, de la réussite personnelle aux dépens de l’autre, qui laisse perdurer les inégalités économiques et sociales, pourrait-elle encourager ou réaffirmer notre fidélité à l’un des fondements éthiques de la tradition judéo-chrétienne qui en réalité devrait la structurer (6) ? Nos nouveaux modes d’information et de communication semblent au contraire fructifier sur l’hostilité des échanges, le mépris de l’autre, l’indifférence à sa souffrance. Brisant l’unité profonde entre le rapport à soi et le rapport à l’autre. Affirmant presque – ou tout au moins laissant penser – que l’amour de soi et l’amour de l’autre s’opposent dans une sourde et vaine rivalité factice alors qu’ils se répondent ! Pièges de l’identitarisme et du communautarisme. Comme si l’anthropologie post-moderne s’élaborait à contre-pied de la vérité anthropologique et éthique de ce qui est beaucoup plus qu’un simple impératif moral ! Car aimer autrui, c’est se découvrir capable d’aimer véritablement. Donc d’être libre. Non de cette liberté si couramment confondue avec l’autonomie, mais puissance d’être inspirée par l’autre. C’est ce que nous voudrions analyser et réaffirmer en convoquant ici deux philosophes, Paul Ricœur et Emmanuel Levinas, dans la perspective philosophique contemporaine, peut-être pour mieux nous en convaincre nous-même…
Un éclairage phénoménologique
En affirmant que la liberté naît du rapport à l’autre, Paul Ricoeur entre ici en dialogue avec Emmanuel Levinas dont il s’inspire, mais dont il se distingue […]