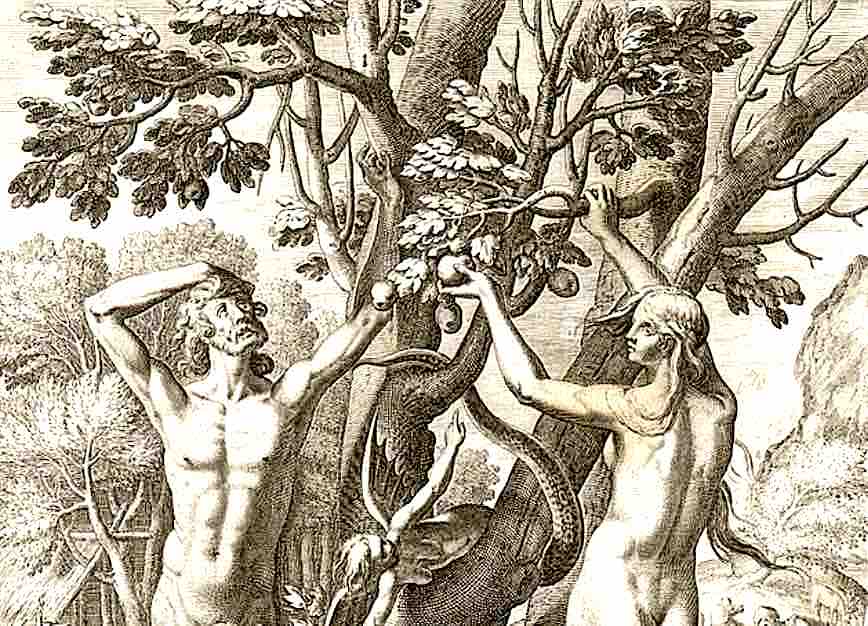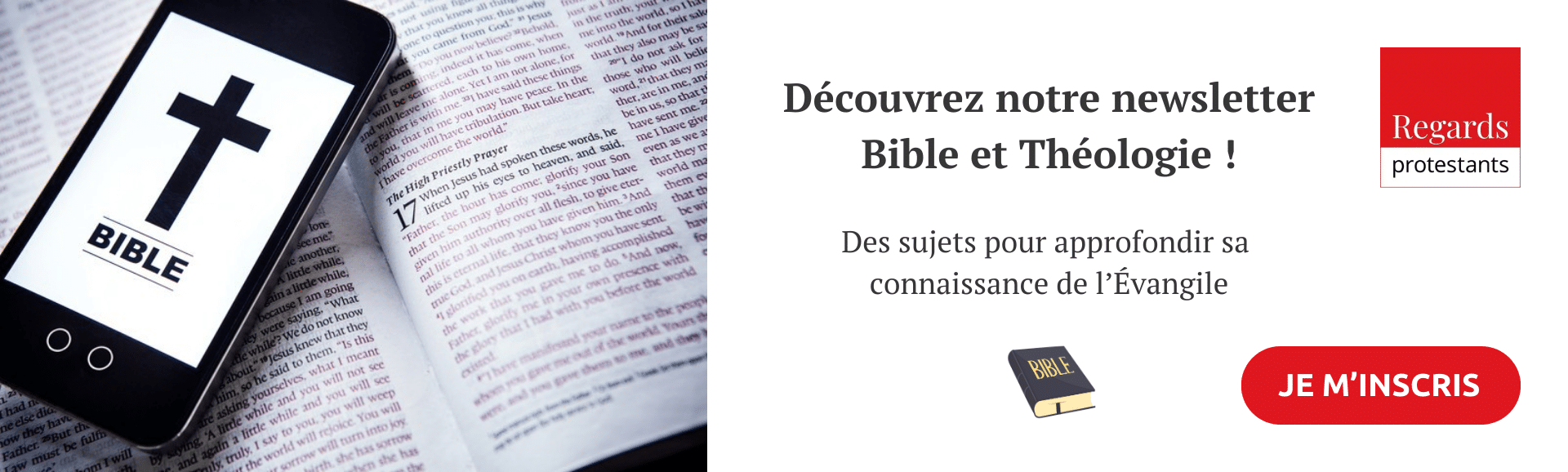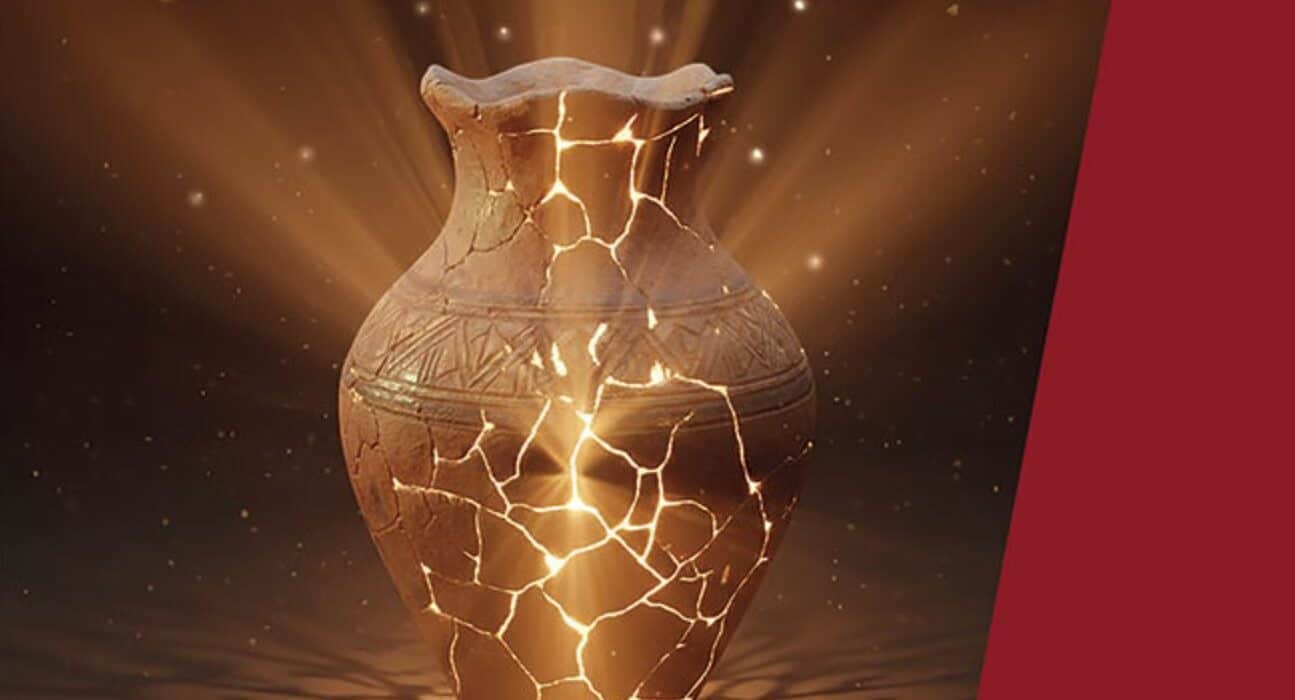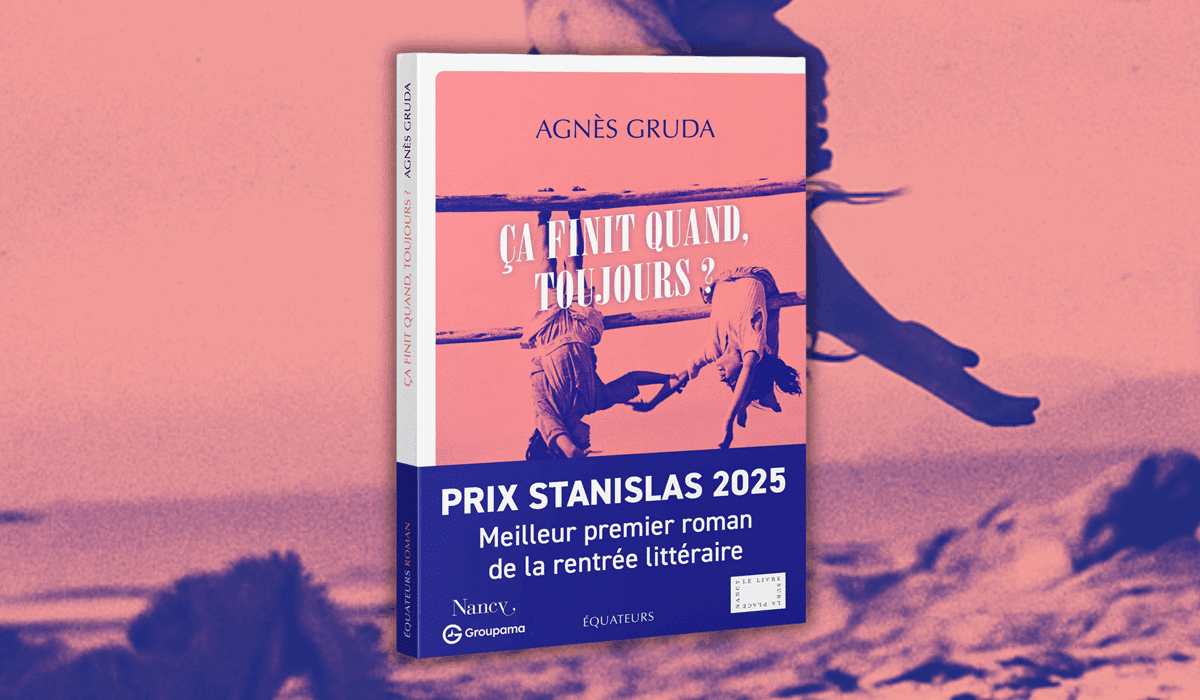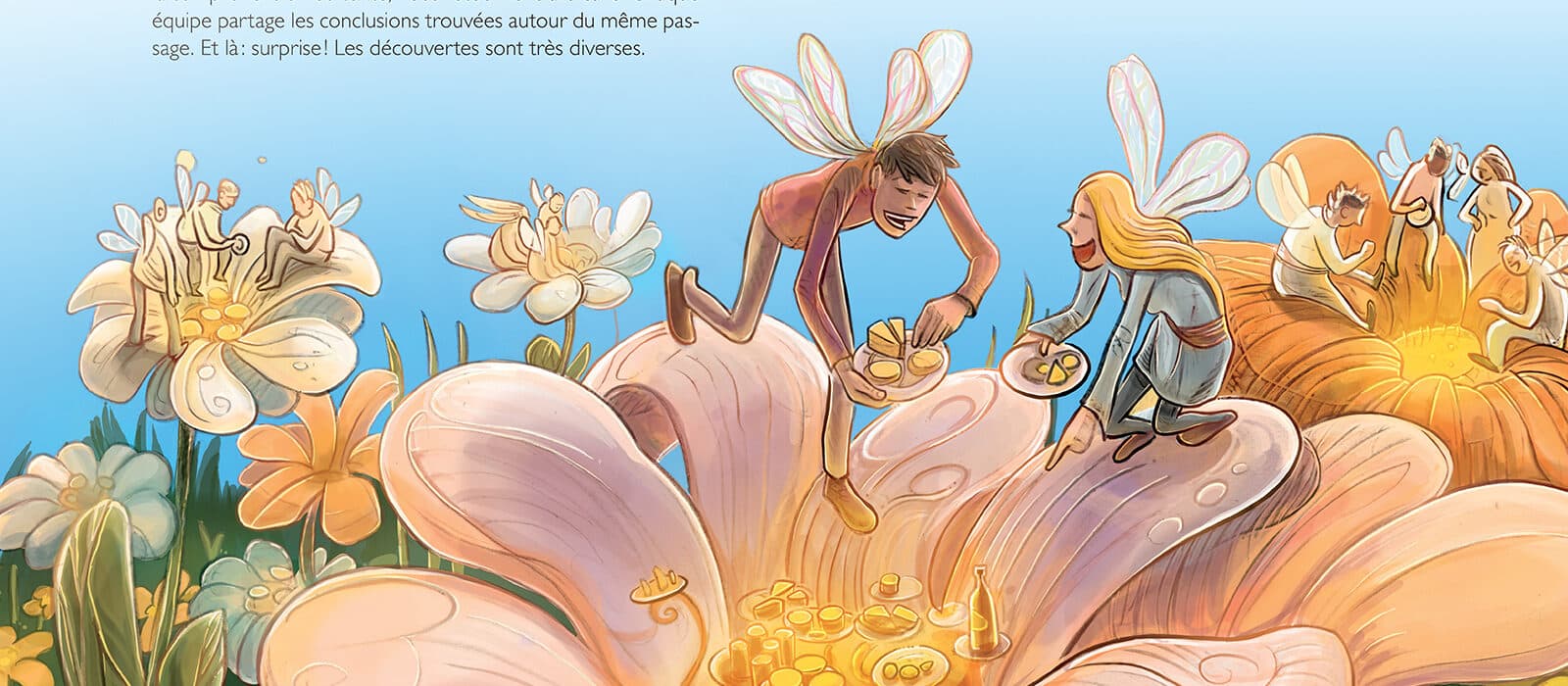« Cette idée folle que l’autre qui est le plus loin de moi est aussi le plus près » : dans cette conférence de la fin 1981, France Quéré relit « l’aventure chrétienne » sous l’angle du couple et de ses faux-semblants (vus d’ici). Après avoir examiné ce que l’on en peut savoir dans la Bible où « homme et femme représentent deux mondes, étroitement séparés, qui incarnent les deux modalités de la vie », elle ébauche à partir de la dualité différence/similitude posée par Jésus une « éthique du vis-à-vis » dont les « trois articles » sont «l’équité, la responsabilité, le mystère. L’amour ne joint-il pas ces trois exigences?».
- Conférence prononcée au temple d’Auteuil lors du cycle L’aventure chrétienne organisé en novembre-décembre 1981 par Michel Leplay et publié dans Foi&Vie 1983/1 (et avec aussi des conférences d’André Mandouze, André Dumas et Jean Delumeau).
Le couple, comme les grands événements qui rythment ou brisent le cours des civilisations, traverse l’histoire sur le mode d’une aventure perpétuelle. Il n’est pas seulement l’humble refuge nous maintenant à l’abri des tempêtes qui fouettent la grand rue. Il ne représente pas l’éternelle paix de la vie privée et l’unique amour de l’homme et de la femme.
Il est le reflet de la vie publique, qui lui impose ses codes, ses mœurs et jusqu’à ses conflits. Il est, en un sens, la miniaturisation de la société entière et regarder le couple d’Isaac et Rebecca c’est considérer la nation juive elle-même. Regarder Tristan et Iseut c’est apercevoir l’exigence et la foi du Moyen Age. Aujourd’hui, comment se nommerait le couple symbolique de notre société ? La plupart sont des couples si éphémères que les deux prénoms ne restent pas longtemps accolés ensemble. J’en forge donc un qui me semble expressif des revendications de notre temps; cela n’évoque en rien Roméo et Juliette. Ce serait le couple formé par Chirac et Laguiller. Rien, en somme, qui suggère un art poussé de la galanterie.
Or je voudrais montrer ici qu’il y a en réalité deux histoires du couple et qui ne sont pas, quoi qu’elles s’opposent fort, sans connexions souterraines, sans se rejoindre par d’épais filaments. Il y a la tradition visible, sociologique qui fait qu’une famille du 4e siècle ne ressemble pas à une du 18e et puis en dessous il y a une autre logique qui court et qui plonge dans une réalité différente, touchant à l’être lui-même, entendez qu’elle se déroule sur le mode philosophique et spirituel, qu’elle échappe ainsi partiellement aux influences circonstancielles de l’histoire et poursuit un autre récit que nous essaierons d’élucider.
Injustice et tradition du couple
Mais revenons à la surface, et fixons deux points dans le temps: l’époque du Christ et la nôtre. Peu de ressemblances.
Le couple du 1er siècle nous apparaît comme fort peu enviable. Historiens et exégètes nous décrivent dans la cellule familiale un chef d’œuvre d’injustices. L’homme détient tous les pouvoirs. La femme n’en dispose pratiquement d’aucun. Lui règne dans la cité, où il est seul acteur; dans la religion, dont il est seul gestionnaire, et même dans la vie privée, où l’intégralité des droits lui revient (se marier, divorcer pour n’importe quel motif, avoir des enfants, prendre des concubines, pratiquer la polygamie). La femme est exclue de toute vie publique. Le récit de la Genèse voit en elle une créature seconde, faite pour servir l’homme et une nature coupable, dont découle le malheur de l’humanité. Deux raisons de la dispenser de toute autorité. Sa dépendance est totale, et son humiliation se poursuit jusque sur les bancs de la synagogue, où elle est tenue à l’écart de plusieurs commandements. Dans son foyer, elle n’est qu’une servante soumise, recluse, séparée des appartements de son mari; du reste mariée à qui son père a voulu, sans possibilité de choix ou de connaissance préalable.
Son mari attend d’elle des fils en abondance. La stérilité est un opprobre, l’enfantement des filles une insuffisance. Elle ne sort pas, sinon dûment voilée et accompagnée et n’a bien entendu aucun rôle dans la vie politique de sa nation.
Telle est la situation de […]