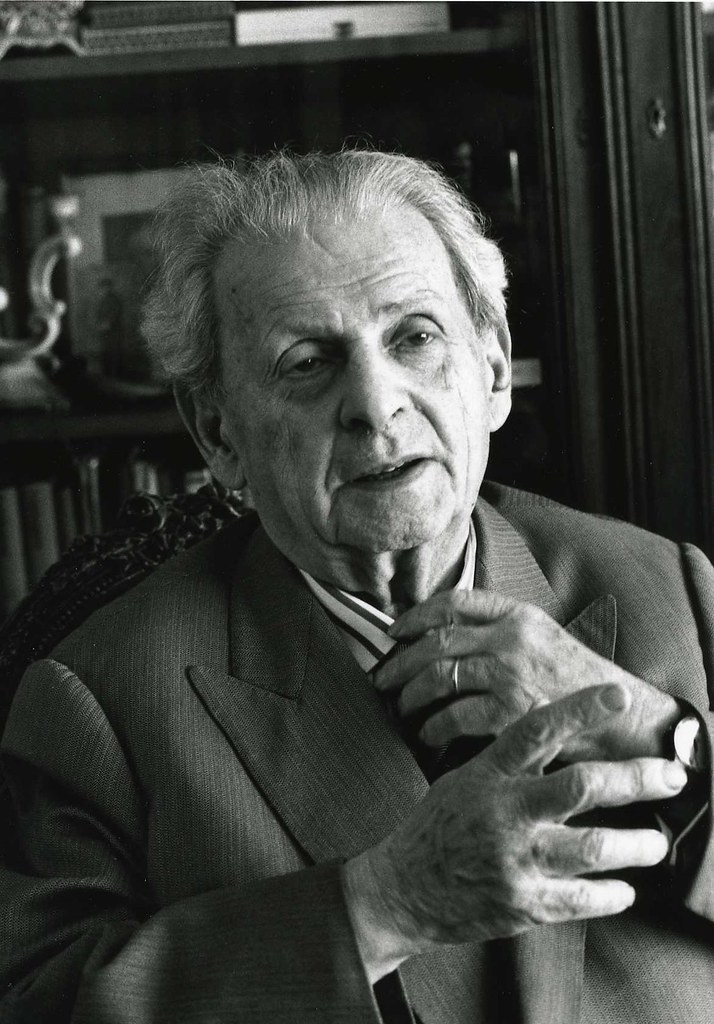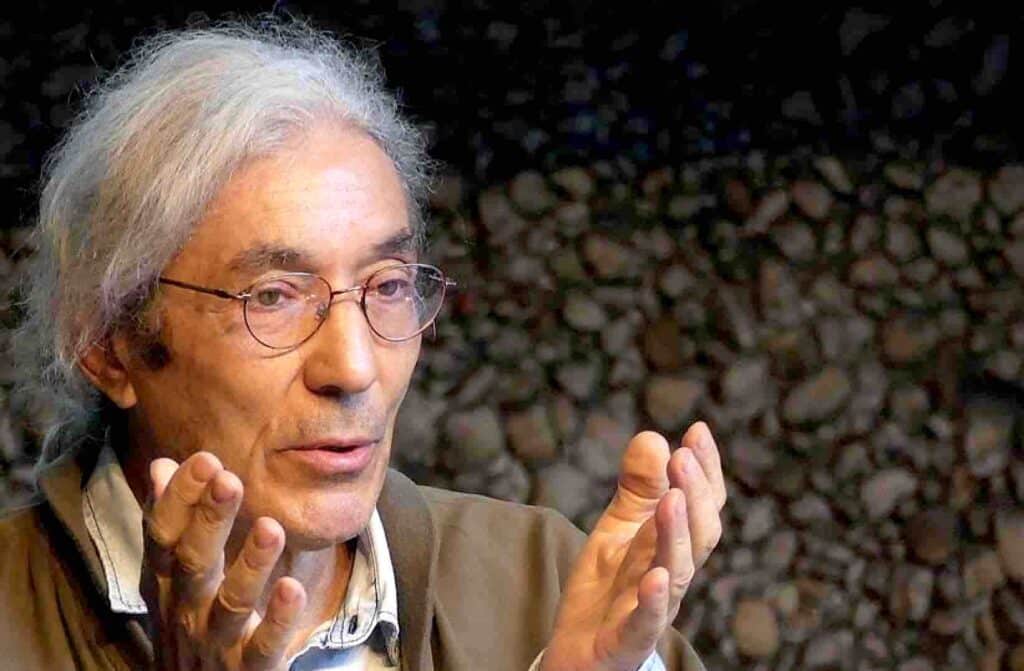Vous dénoncez l’hypersécurisation, de quoi s’agit-il ?
Pour la construction de l’enfant, le besoin de sécurité est essentiel. On le sait au travers de la psychologie humaniste. Mais depuis quelques décennies, la dérive est manifeste vers une hypersécurité dans le rapport sociétal aux enfants. On est en train de fabriquer des adultes qui ne seront pas adultes. Les parents veulent mettre à l’abri leurs enfants de tout ce qu’ils perçoivent comme une menace, souvent d’ordre physique, du petit bobo à l’accident mais pas seulement : on pourrait citer la mort, ou la maladie, dont les enfants sont aujourd’hui tenus à l’écart dans notre société.
D’un point de vue sociologique, cette surprotection parentale va de pair avec une surprotection institutionnelle. Les règles juridiques se sont multipliées en matière scolaire, éducative, sanitaire. La loi de 2019 votée sur les violences éducatives, les innombrables normes techniques sur les jouets, les crash-tests subis par les poussettes… confirment que l’hypersécurisation n’est pas seulement familiale mais sociétale.
Les parents protègent-ils trop leurs enfants ?
La fonction de veille des parents est primordiale dans l’éducation mais il faut trouver un juste milieu entre le défaut, le laxisme (laisser les enfants livrés à eux-mêmes), et l’excès, la surprotection (mettre l’enfant dans un cocon). Les adultes devraient aussi être cohérents, car, dans cette surprotection parentale, il y a des zones aveugles. Certains parents sont par exemple surprotecteurs sur le plan physique et négligents sur le plan numérique, alors que pédiatres et enseignants multiplient les avertissements sur les effets néfastes de la surconsommation numérique.
Existe-t-il aussi des paradoxes sur le plan institutionnel ?
Oui, notre société prétend qu’elle protège les enfants mais abaisse la responsabilité pénale à treize ans et octroie des budgets hyper serrés à la protection de l’enfance. Les inégalités sont criantes. Les chiffres de l’INSEE montrent qu’en Outre-mer, la mortalité infantile est quatre fois supérieure à la moyenne nationale. Côté enseignement, l’Éducation nationale est défaillante. La situation n’est pas homogène selon les lieux et les milieux, et certains enfants ne sont pas assez protégés. La surprotection côtoie la sous protection. La France fait des investissements de forme dans des grands principes et des lois, plus qu’elle n’apporte des réponses de terrain.
Quels sont les enjeux de l’hypersécurisation ?
Sur le plan psychoéducatif, l’arbitrage est entre la liberté et le risque. Tout est question de confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas ; ça se construit dans l’expérience et la relation. L’hyperprotection révèle un déficit de confiance. Comment élever un enfant si on ne cherche pas à s’élever soi-même ? Élever, c’est éduquer, mais c’est aussi prendre de la hauteur. La surprotection pervertit le sens d’« élever ». Elle projette sur l’enfant des mesures qui sont censées le protéger mais qui, en réalité, ne contribuent pas à l’élever. Sur le plan socio-institutionnel, l’ultra-modernité a favorisé l’individualisme. L’obsession sécuritaire produit une formalisation juridique contrôlante, avec son fétichisme de lois, ses règlements, ses dispositifs, ses évaluations, ses sanctions… Ce principe d’anxiété a des effets inhibiteurs. Quel est alors le sens de la responsabilité parentale ? institutionnelle ? La question est éthique.
Comment redresser la barre ?
La surprotection est dangereuse car elle ne favorise pas la confiance, en soi, en l’autre. Le rapport que l’on essaie de construire entre l’enfant et le monde est un enjeu de fraternité humaine, et notre peur de l’incertitude devrait faire place à plus de confiance et d’espérance.
Propos recueillis par Brigitte Martin