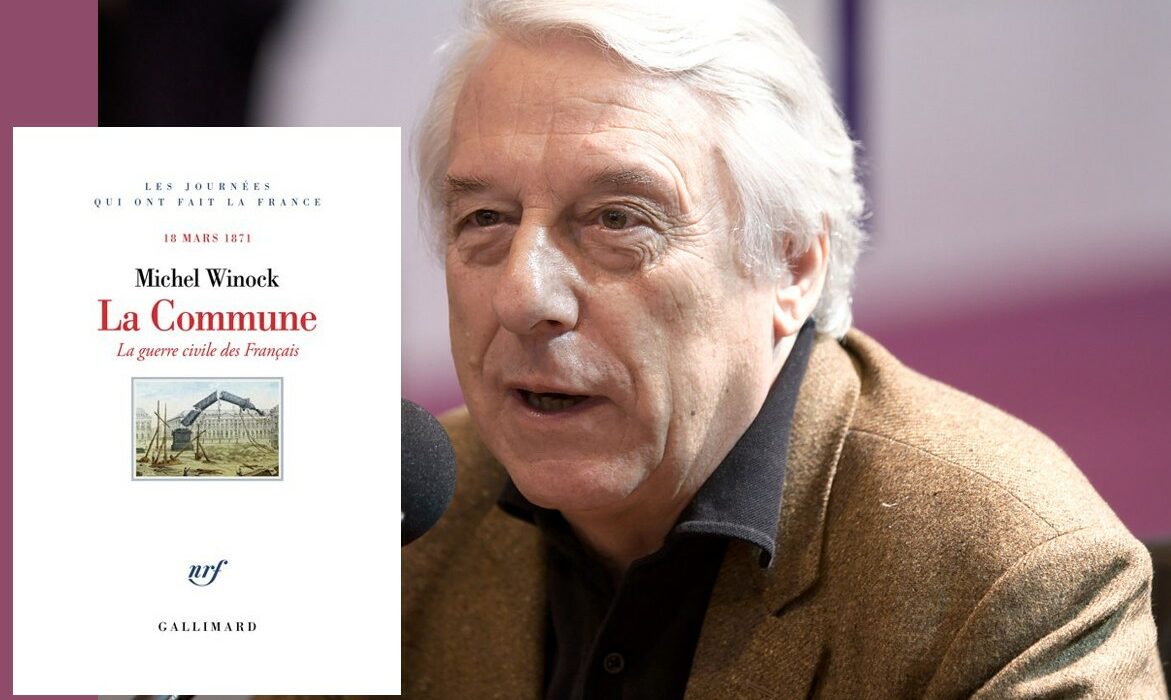Parmi celles qui ont osé, Blanche Peyron naît un 8 mars, en 1867. Le 8 mars n’est pas encore la Journée des droits des femmes. Son œuvre est néanmoins programmatique : officière à l’Armée du Salut, elle porte ce projet audacieux qu’est le Palais de la femme, mue par une détermination que partagent d’autres de ses contemporaines.
Un engagement social inédit
Au milieu du XIXe siècle, quelques cercles de femmes s’engagent dans des actions sociales novatrices. Caroline Malvesin, en quête d’une vie communautaire pour des femmes de dénominations différentes – une vie de foi est pour elle inséparable d’un engagement concret –, accueille des personnes en difficulté, soigne des malades… Cet enracinement des Diaconesses de Reuilly ne nous étonne peut-être pas (assez) aujourd’hui, il est pourtant doublement courageux. D’une part, une vie communautaire est en rupture avec les convictions de la Réforme qui assignait les femmes au couple et au foyer. D’autre part, et le sujet est tabou, si enseigner est une occupation convenable pour une femme, soigner suppose de toucher le corps de l’autre et ne peut être considéré comme une vocation.
Des protestantes comme Valérie de Gasparin imposent, à la même époque, un projet de formation professionnelle pour des femmes dans le domaine des soins infirmiers. Anna Hamilton, qui obtient de haute lutte son diplôme de médecin, fonde au début du XXe siècle, dans la ligne directe de Florence Nightingale, une école d’infirmières à Bordeaux : la maison de santé Bagatelle. Les infirmières y sont formées pour diriger des services d’hôpitaux et autres œuvres. Et, comme il ne suffit pas de soigner les corps, une école d’assistantes sociales se greffe sur ce lieu de formation.
L’engagement pour des conditions dignes sur les lieux de travail émerge entre les deux guerres. Les noms d’assistantes sociales sont intimement liés aux actes de résistance contre le fascisme. Activistes de l’ombre, elles ont un très grand sens des réseaux.
Des travailleuses de l’ombre
Des plaques à leurs noms ? Celui de Marie Dentière, théologienne contemporaine de Calvin, militante pour les droits des femmes, n’est gravé sur le mur des Réformateurs à Genève qu’en 2002. Celui de Sarah Monod, présidente du Conseil national des femmes françaises au début du XXe siècle, qui soutient notamment les diaconesses, n’apparaît sur une plaque parisienne qu’en 2024 !
Qui sont-elles, ces femmes protestantes investies dans l’engagement social ? Elles viennent de tous milieux et vont partout : écoles, prisons, champs de bataille, lieux de prostitution… Certaines, de la bourgeoisie, mènent des luttes remarquables, à l’instar de Marion Cormier, une des premières avocates, engagée au service des plus démunis.
Si elles ont eu parfois le vent en poupe, ces femmes ont rencontré bien souvent de l’opposition : animatrices des « tricotins » – elles formaient des enfants pauvres au tricot –, Sara Banzet et Louise Scheppler se sont fait caillasser dans les hameaux alsaciens parce qu’on leur contestait le droit de s’occuper des enfants des autres ; son mari banquier a retiré ses subsides à Berty Albrecht parce qu’elle s’occupait des ouvriers dans les usines. Mais toutes ont osé. Et continué d’oser.
A voir :