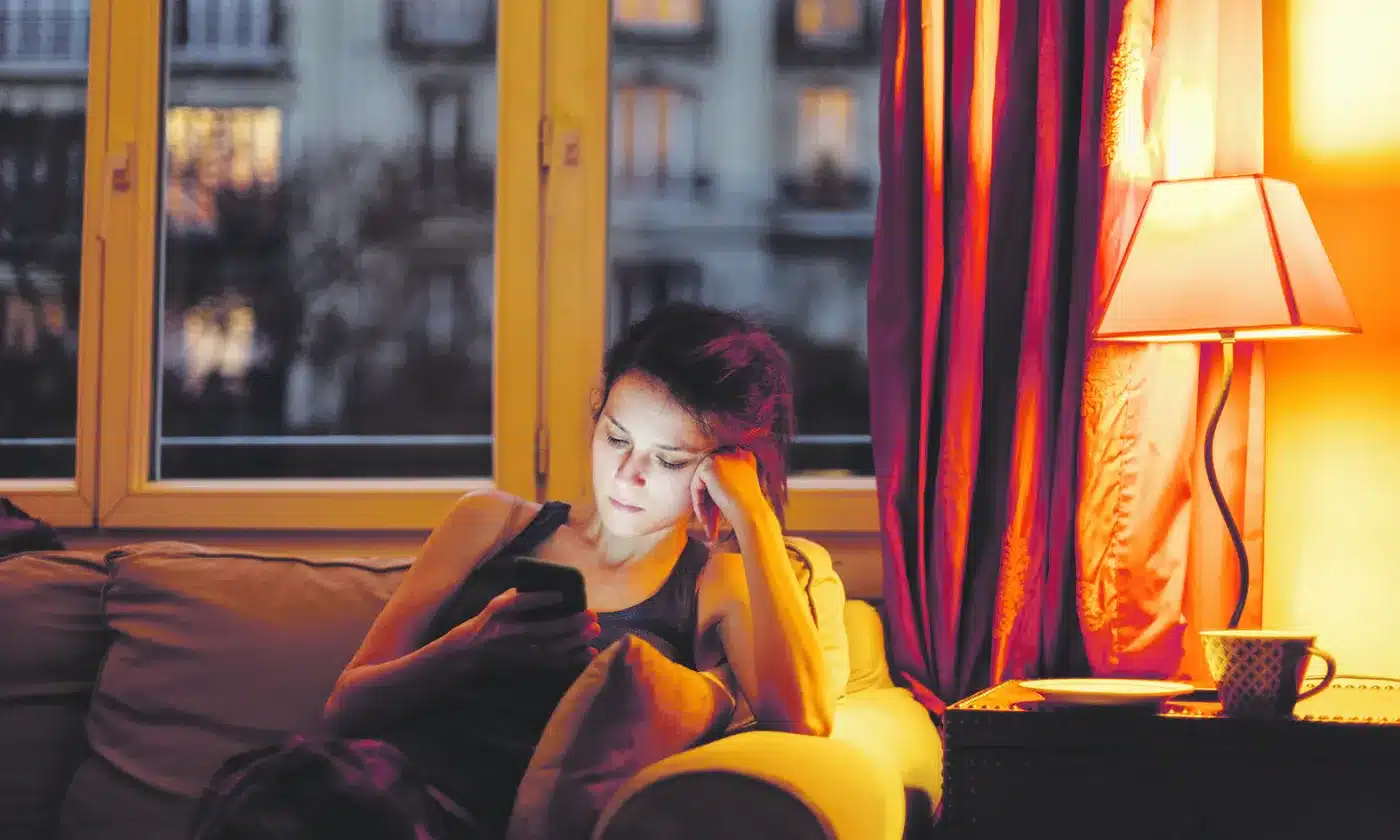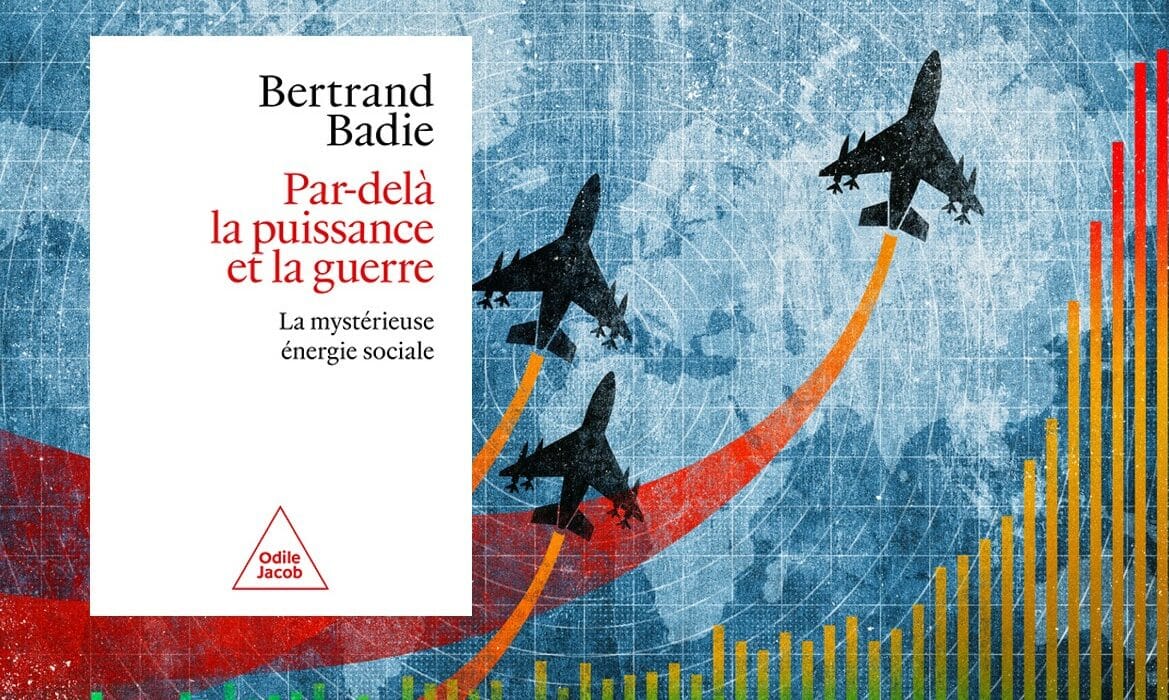Il y a cinq cents ans, en janvier 1525, à Zurich, un petit groupe d’anciens compagnons du réformateur Ulrich Zwingli pratiquait un acte symbolique: le baptême d’un adulte confessant sa foi. Ce geste fondateur marquait la naissance du mouvement anabaptiste suisse. Refusant le baptême des nourrissons, les anabaptistes revendiquent une Église fondée sur l’engagement personnel. Rapidement considérés comme des fauteurs de trouble par les autorités tant protestantes que catholiques, ils furent pourchassés, emprisonnés, exécutés. Cette page d’histoire revient aujourd’hui au cœur de l’actualité. À l’occasion des 500 ans de la Réforme radicale – mouvement réformateur composé de nombreux courants protestants hétérogènes qui se sont développés en marge de la Réforme protestante luthérienne et calviniste –, une série d’événements propose de redécouvrir l’empreinte laissée par les anabaptistes dans le Jura et le Jura bernois. «C’est une histoire encore largement méconnue», regrette Nicolas Gerber, vice-président de la Fondation Héritage anabaptiste (FHA).
Jugés radicaux
Inspirés d’abord par des figures comme Thomas Müntzer et Andreas Karlstadt, les anabaptistes rompent progressivement avec les positions de Luther et Zwingli. Leur radicalité ne tient pas tant à des innovations théologiques qu’à […]