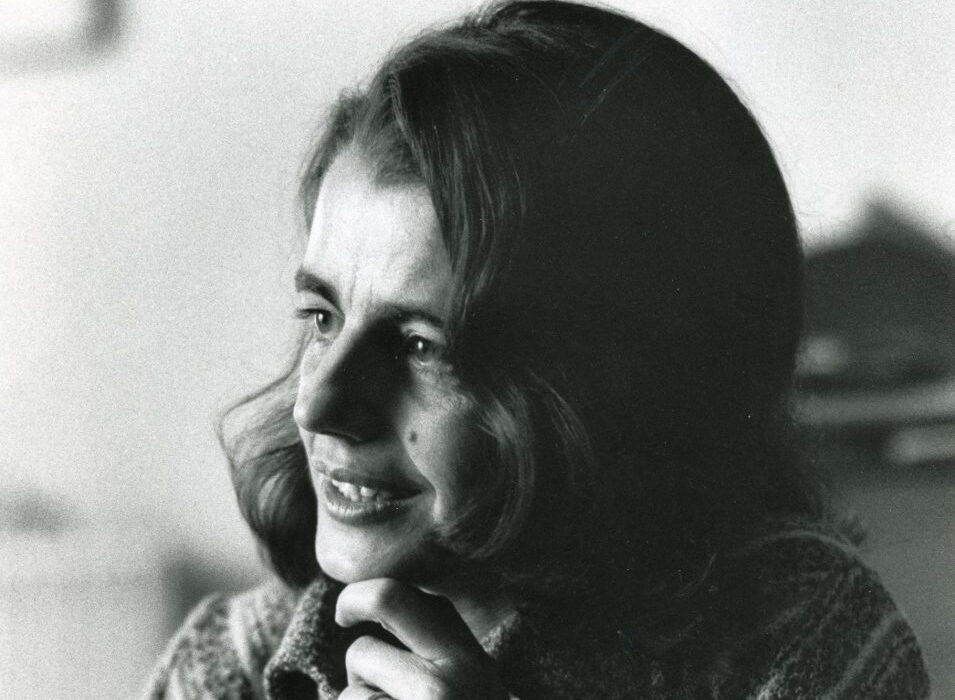Quelle pertinence lui a permis une telle longévité au Comité consultatif national d’éthique ? Et tant d’hommages respectueux sur la profondeur de sa pensée, après sa mort ? Ces questions nous habitent trente ans après sa mort. Elles sont à l’origine de notre engagement pour la constitution de ce dossier. Non pour s’accrocher à un passé révolu, mais dans le but de dégager les traits toujours pérennes de sa pensée, susceptibles de nourrir nos éthiques d’aujourd’hui. Un programme de travail s’ouvre pour les années à venir. Car ses écrits sont divers et éclatés, pour beaucoup plus journalistiques que systématiques. Volontiers elle laisse éclater la vivacité du trait d’inspiration. Elle questionne, remet en cause ce qu’elle décèle comme des enfermements dans des systèmes clos, à courte vue. Souvent elle puise dans un parcours historique le souffle qui fera éclater les cadres. Elle ouvre des champs et déplace les problématiques, les soumet au souffle de l’Évangile. Chaque thème traité est un parcours de questionnement cherchant à redire et à redéfinir nos réelles libertés et responsabilités.
À travers tous ces parcours, il y a plus qu’une cohérence de méthode. Son éthique est articulée sur des convictions qu’elle a rarement présentées sous forme systématique. Parmi celles-ci, une m’a toujours séduite: c’est l’amour comme motivation éthique, et peut-être même davantage comme fondement anthropologique. Le thème apparaît dans tous ses livres. N’ayant pas connu France Quéré, c’est par la lecture de quelques-uns de ses ouvrages que je l’ai découverte. L’amour est présent de façon constante, mais multiforme dans ses démonstrations. Il n’est pas seulement une raison d’agir, il est un socle pour ordonner ses choix, pour saisir le sens de sa vie. Quels autres auteurs permettent d’articuler une éthique rigoureuse sur le caractère originaire, fondateur, et créateur de l’amour, tout en conservant à l’amour son mystère, son caractère inclassable et insaisissable, et sa fragilité ?
Peut-être vais-je trop vite à une conclusion. Modestement, ce travail tente d’en dresser un premier tableau. Il est incomplet. Il s’appuie sur quelques ouvrages choisis parce que fondateurs pour une éthique universaliste : c’est une forte limite. Car si l’amour est partout chez France Quéré, il prend une place considérable dans son éthique familiale, dans son exégèse, dans sa lecture des Pères. L’angle ici privilégié est le rapport anthropologique à l’amour et ses implications pour l’élaboration de principes éthiques. Dans un travail ultérieur, il faudra encore laisser parler l’amour maternel, il a beaucoup à dire pour notre auteure. Et l’amour du Christ, bien sûr…
Dans son premier ouvrage, Le dénuement de l’espérance, publié en 1972, elle en appelle, à la suite d’un examen critique de la société de l’époque, à la définition d’une nouvelle anthropologie, et à une reformulation des raisons d’agir. L’amour y apparaît comme une condition de possibilité de la liberté. Nous commençons par une synthèse de son raisonnement.
Dans Au fil de l’autre, publié en 1979, elle définit l’amour dans les relations sociales ordinaires. Elle y développe l’impact fondateur de la reconnaissance de l’altérité. Ce sera notre seconde partie.
Enfin nous pourrons restituer la construction plus systématique d’une éthique aimante à laquelle elle aboutit au moment de ses travaux au CCNE. Trois ouvrages en rendent compte : L’éthique et la vie (1991), et deux recueils posthumes rassemblant diverses contributions : Conscience et Neurosciences et L’homme maître de l’homme, publiés en 2001.
La crise anthropologique: le dénuement de l’espérance, et le renouement de l’amour
L’objet du livre Le dénuement de l’espérance est d’analyser la crise de foi que traverse la société des années 1970 et d’interroger la corrélation avec ce que l’opinion nomme généralement , selon France Quéré, une «crise de civilisation».
Or cette crise est avant tout anthropologique pour notre auteure. Bien sûr la société a été transformée par l’avancée extraordinaire des sciences et des techniques. La donne en est changée. Le politique s’en saisit pour réduire l’indépendance des scientifiques. Ces nouveaux pouvoirs suscitent des peurs : […]