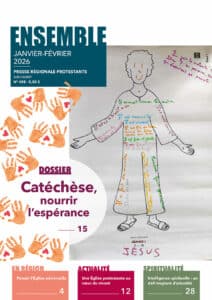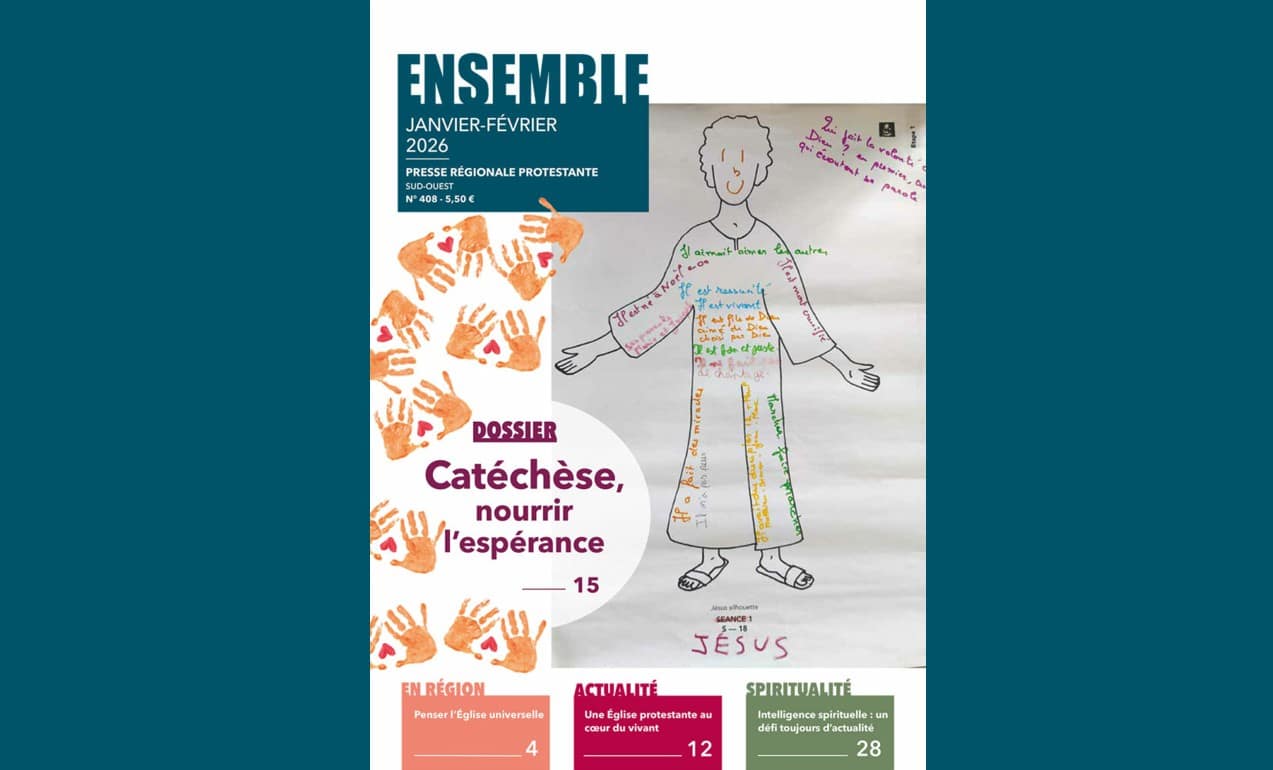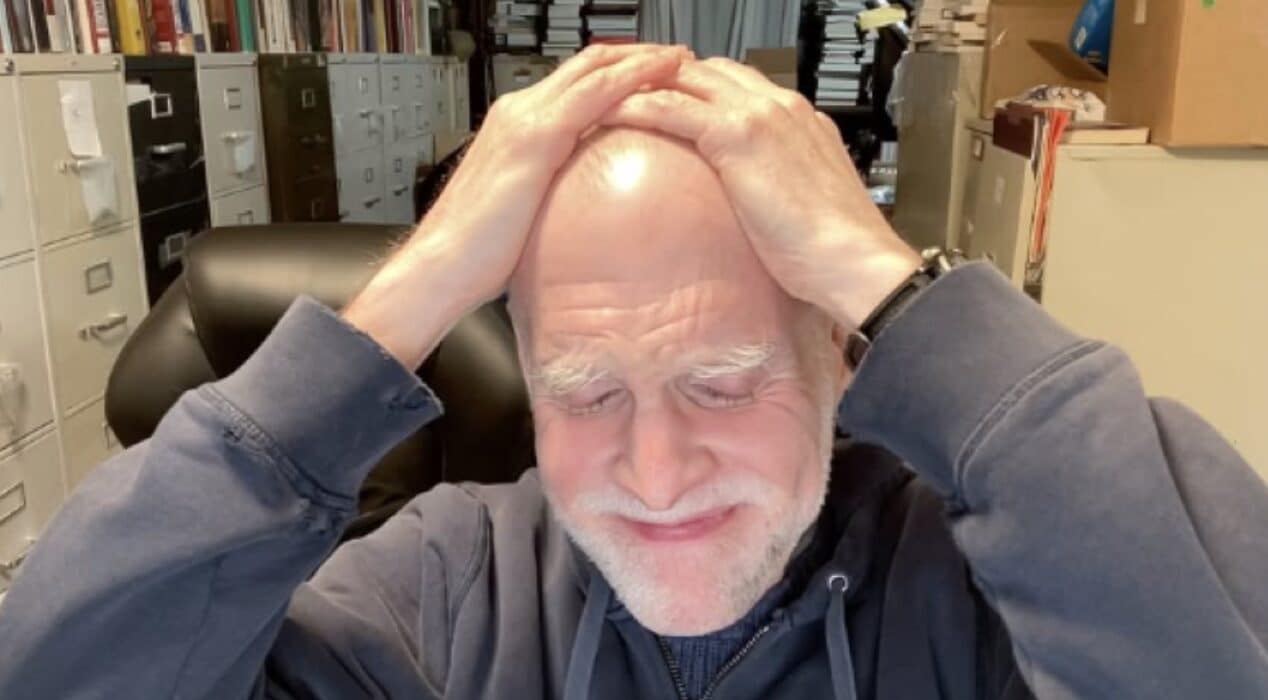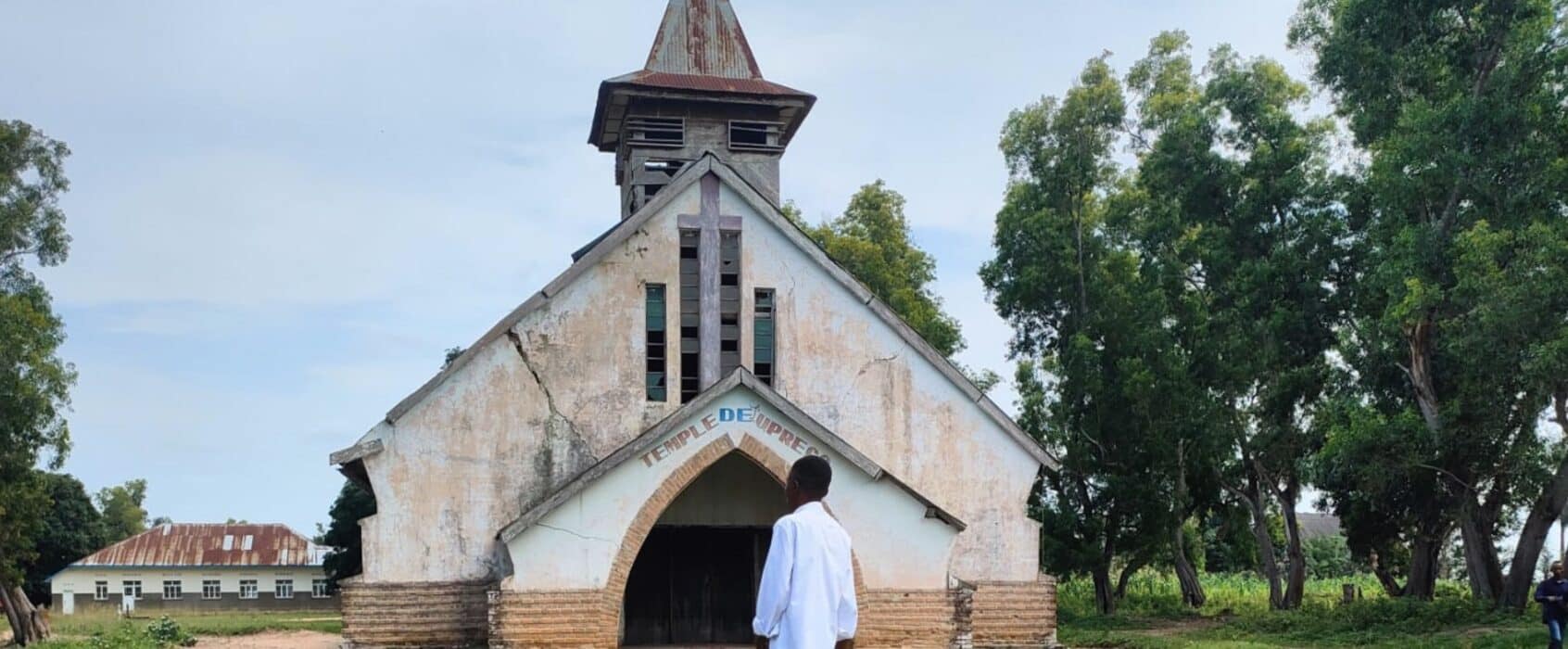En 2017, nous avons célébré les 500 ans de l’affichage des 95 thèses de Luther, un événement plus ou moins mythique, qu’il est convenu de considérer comme le point de départ de la Réforme du XVIe siècle. Cette année, nous pourrions marquer les 500 ans des douze articles de la paysannerie rédigés à Memmingen, en Souabe, par des bandes paysannes révoltées – au nom de leur lecture de l’Évangile – contre leurs conditions d’oppression par les seigneurs protestants et catholiques du Saint Empire romain germanique. Douze articles très intéressants. Ils traitent de la liberté et de l’autonomie religieuses, et revendiquent pour les communautés de pouvoir élire/nommer leur pasteur et aussi de le démettre en cas de mauvaise conduite. Mais ils demandent aussi l’abolition du servage, l’accès égal aux produits de la nature (donnés par Dieu pour tous), des impôts et des corvées plus justes, en justifiant ces demandes par des citations bibliques. Les interprétations de ces années-là sont multiples. Elles marquent en tout cas une conviction : l’Évangile porte une exigence d’égale dignité et doit donc susciter des transformations sociales pour se rapprocher du règne annoncé par le Christ. C’est une espérance forte, parfois millénariste, qui traverse l’époque et touche les groupes – artisans, paysans, intellectuels – qui mettent en cause l’oppression de la noblesse et de l’Église.
Écrasement et survivances Face à ces revendications, la réponse va être radicale. Les princes catholiques et protestants mobilisent leurs troupes mercenaires, et finissent par massacrer les différentes bandes paysannes et celui qui avait donné un souffle théologique brûlant à cette révolte, Thomas Müntzer. Mais ce qui marquera plus encore les esprits, ce sont les justifications et le soutien que les princes recevront de la part de Luther. Plus encore, ce sont les insultes et les condamnations ordurières dont « frère Martin » abreuva les « pauvres » et leurs alliés théologiens. On interprète cette prise de parti pour les princes par son désir […]