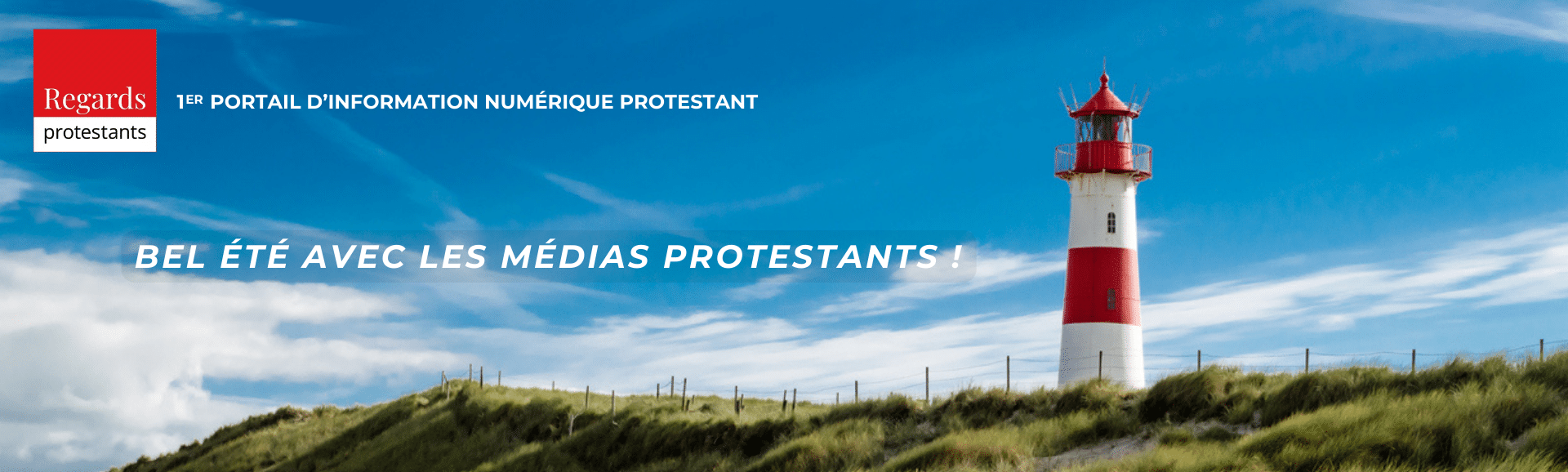Depuis trois ans et demi, Raed Tawil vit à Genève, dans le quartier populaire des Eaux Vives. A 40 ans, cet infirmier a travaillé une vingtaine d’années pour le Croissant-Rouge, à Damas (Syrie) en tant que responsable des secours d’urgence. En novembre 2012, sa vie bascule : Raed est enlevé par les forces gouvernementales dans les locaux du Croissant-Rouge. On l’accuse de soutenir les rebelles en convoyant dans les zones assiégées médicaments et secours. Torturé durant 69 jours, Raed est laissé pour mort. C’est grâce à la mobilisation d’Amnesty qu’il quitte la Syrie début 2013.
Son état est inquiétant. La torture endurée nécessite une opération. Concours de circonstances ? Raed, qui connaît un médecin syrien employé aux Hôpitaux genevois, opte pour la Suisse plutôt que l’Allemagne. « J’ai pu venir avec mon épouse et notre fils âgé de quatre ans, c’est ce qui m’importait le plus. » Vingt jours d’hospitalisation, six mois de rééducation et un suivi psychologique pour choc post-traumatique, Raeda retrouvé son énergie habituelle et s’active à trouver un emploi. Pas évident, « mes diplômes ne sont pas reconnus ici et mon français n’est pas suffisamment bon pour travailler dans le domaine médical en Suisse. »
Pas de « Mama Merkel »
En Suisse, le nombre de réfugiés syriens est relativement faible. « Une des explications de ces chiffres, si on les compare avec ceux de l’Allemagne, tient au fait que nous n’avons pas de « Mama Merkel », résume Stephan Frey, porte-parole de l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés). Autrement dit, en déposant une demande d’asile en Suisse, les Syriens ont un risque bien plus élevé de faire l’objet d’une décision Dublin que ceux qui vont en Allemagne. De plus, la Suisse n’accorde qu’à un tiers l’asile alors qu’en Allemagne, ils obtiennent quasi tous, à juste titre, cette protection. » Si l’asile est peu accordé en Suisse, ce pays a été, aux premières heures du conflit syrien, l’un des premiers à mettre sur pied des projets d’intégration pour les Syriens déplacés, au Liban comme en Jordanie et en Turquie. Reste que pour les réfugiés arrivés en Suisse, comme Raed, trouver un emploi répondant à leurs qualifications tient de la mission impossible au contraire de certains pays où l’intégration professionnelle des réfugiés s’adapte aux besoins du marché du travail local.

Raed Tawil soupire. « C’est sûr, aujourd’hui je regrette de ne pas être parti pour l’Allemagne. Mais je ne peux pas me plaindre de ma situation quand ma famille – mon père, ma mère, mon frère et mes deux sœurs – vit un cauchemar à Damas. Mon père, qui a 85 ans, n’a jamais voulu partir. Sauf en début d’année où il m’a dit qu’il ferait n’importe quoi pour quitter la Syrie…» Au pays, les conditions de vie, à commencer par le simple fait de se nourrir, sont devenues insupportables. «Les matières premières sont excessivement chères, raconte Yazan Savoy, un Genevois d’origine syrienne. Le prix du pétrole a pris l’ascenseur et tous les transports, alimentaires notamment, en subissent le contrecoup. Le prix d’une salade peut être de 40 euros… »
C’est pour soutenir une soixantaine de familles syriennes chaque année que Yazan Savoy a créé l’association Coup de Pouce en 2013 [www.coupdepouce. info]. Un montant relativement élevé (de 450 à 900€) leur est octroyé pour vivre, se chauffer, se soigner. « Les personnes relativement aisées ont commencé par quitter le pays. C’est au tour, aujourd’hui, de gens qui n’ont plus rien du tout», raconte Yazan, qui vit en Suisse depuis dix ans.
A Genève, Yazan a accueilli sa mère, sa sœur et son frère, grâce au regroupement familial. Seule sa mère – qu’il assume financièrement – a obtenu un titre de séjour qui lui permet de voir grandir ses deux petits-enfants et de pouvoir quitter la Suisse en tout temps. « Mon frère a trouvé un bon emploi, raconte Yazan. Cela dit, si le conflit prenait fin, il quitterait la Suisse demain. Quant à ma sœur, elle vient d’obtenir un permis provisoire. »