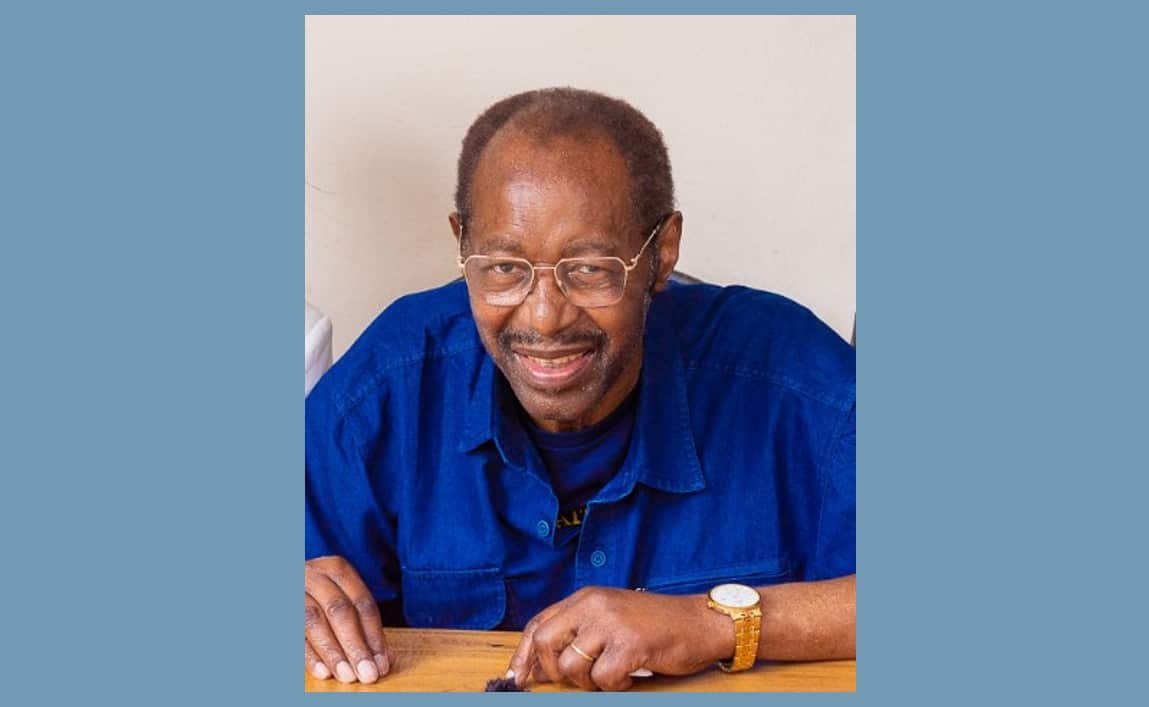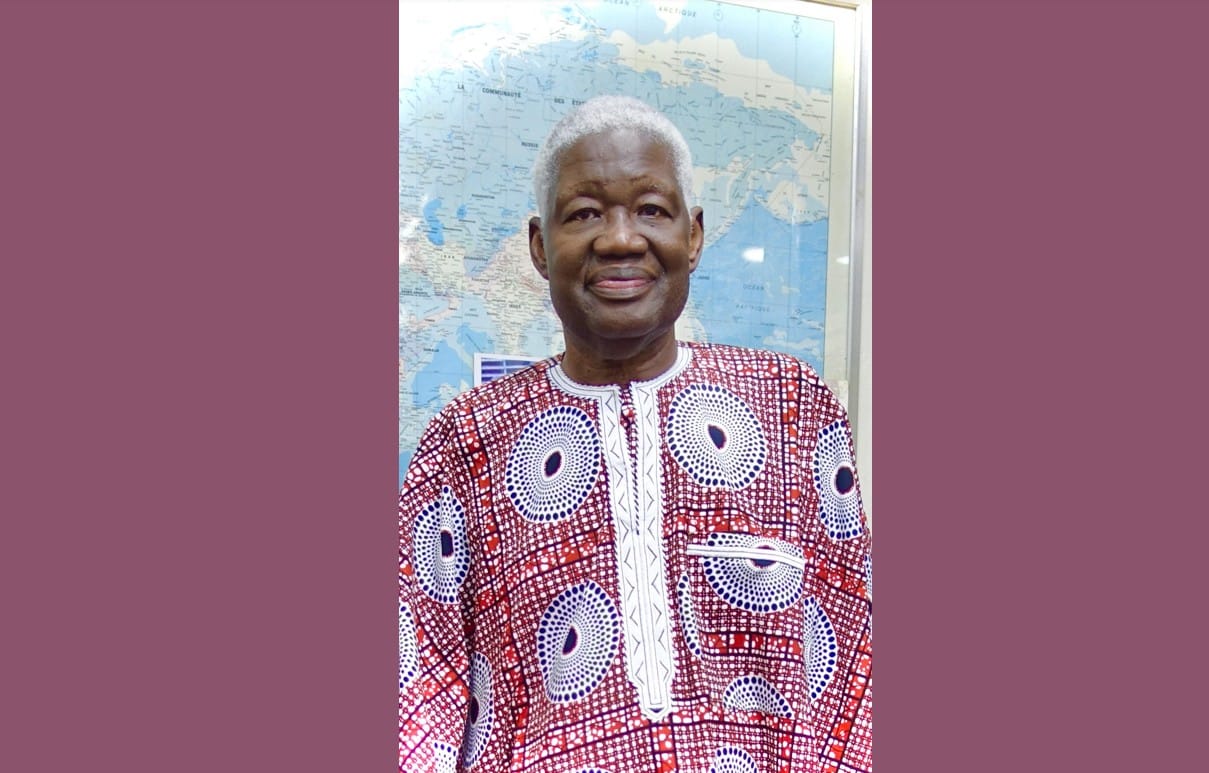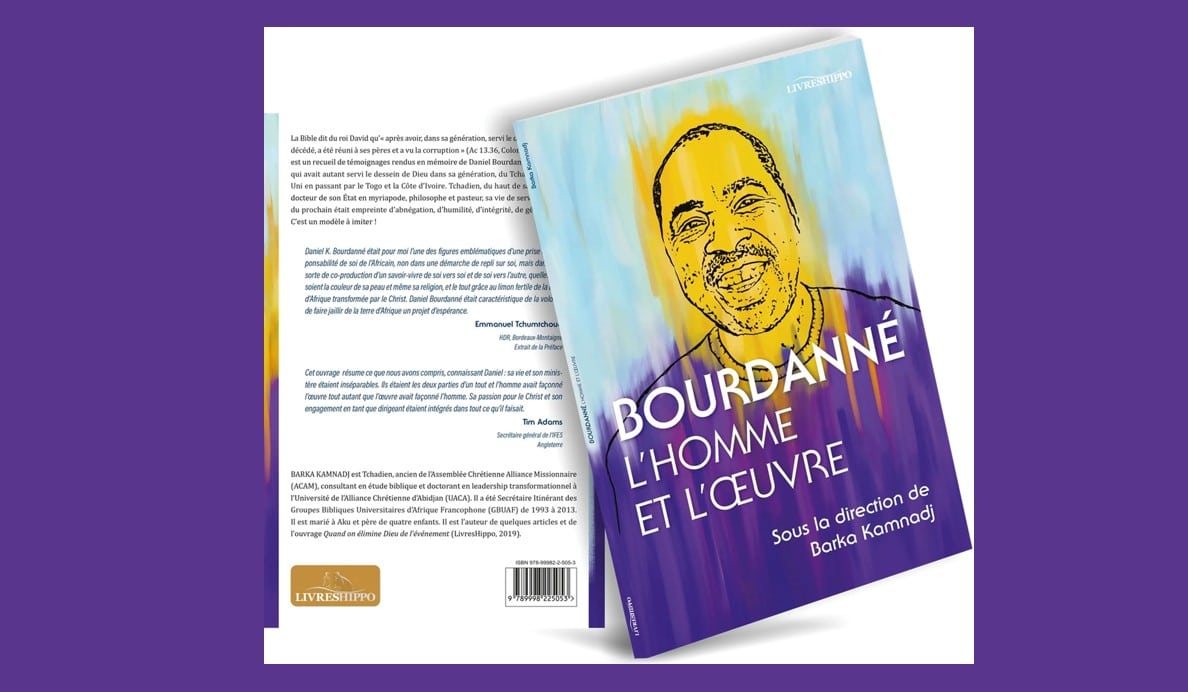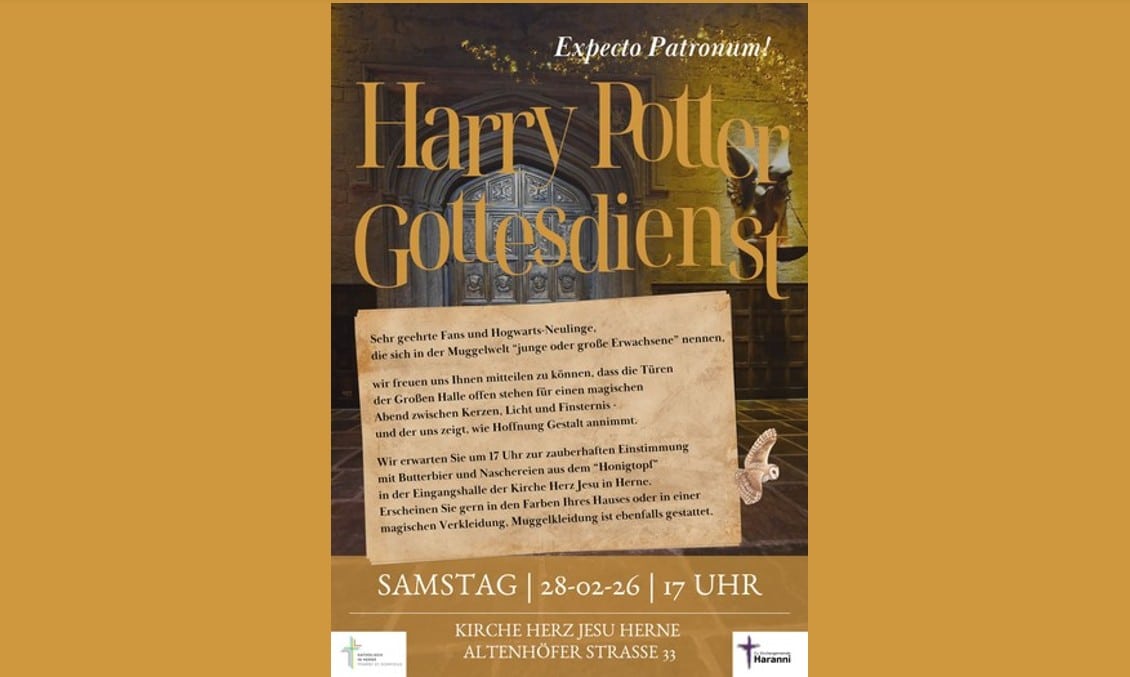Initiée en 2004, l’Eglise qui est devenue l’espace MLK Grand Paris, à Créteil, a changé de statut depuis 2017, lorsqu’elle s’est résolument affirmée comme une megachurch (plus de 2000 fidèles, et une offre de multi-activité). Après avoir initié au printemps 2025 une enquête quantitative auprès des fidèles (voir deux articles précédents), son pasteur, Ivan Carluer, revient avec nous sur les enjeux liés à la francophonie.
1/ Ivan Carluer, votre église est multinationale. La définissez-vous comme avant tout française ou avant tout francophone ?
L’église MLK, dans sa forme présentielle, demeure résolument française. Plus de 80 % de ses membres réguliers sont de nationalité française. Il s’agit principalement de jeunes adultes dont les parents sont effectivement issus des Outre-mer ou des anciennes colonies françaises. Ce qui distingue MLK, c’est sa volonté affirmée de ne pas se définir comme une église communautaire. Y venir, c’est faire un choix clair d’intégration
Pour beaucoup, ce choix représente un parcours personnel exigeant, parfois même courageux : quitter une église communautaire dans laquelle on a grandi, pour rejoindre une megachurch française ouverte à la diversité. Ce métissage, cher à Martin Luther King, donne à MLK sa couleur singulière : environ 50 % de métis, 25 % de personnes d’origine africaine, 15 % d’origine européenne et 10 % d’origine asiatique.
Youtube et TikTok : des publics différents
Grâce à Google Analytics, nous pouvons également mieux comprendre notre audience en ligne. Les deux tiers des vues YouTube proviennent de France : 40 % de métropole, et 25 % des territoires d’Outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane). Le tiers restant se répartit dans l’espace francophone : Québec, Belgique, Suisse (15 %), Île Maurice (10 %) et divers pays africains (10 % seulement). Concernant les publications de l’église MLK sur le reseau social Tiktok, les jeunes internautes y sont, à l’inverse, majoritairement africains (55% contre 10% sur YouTube)
2/ La francophonie protestante a beaucoup changé en trente ans. Quel regard portez-vous sur ses principales transformations ?
Le centre de gravité de la francophonie protestante s’est incontestablement déplacé vers l’Afrique. Mais ce qui me semble encore plus marquant, c’est la transformation interne de la francophonie d’origine africaine, désormais scindée en deux courants.
Le premier est jeune, très connecté (TikTok en tête) mais fragile socialement. Il est ancré les périphéries africaines du golfe de Guinée, mais aussi dans nos banlieues françaises. Il s’éloigne progressivement de la France, tant sur le plan culturel que spirituel.
Le second courant, plus métissé, plus aisé, plus intégré, est urbain et mondialisé. Il s’épanouit à Montréal, Bruxelles ou dans les grandes villes françaises. On le retrouve davantage sur Instagram, dans une francophonie globalisée qui cherche à conjuguer foi, réussite sociale et esthétique.
3/ L’enquête conduite dans l’Eglise MLK montre une empreinte internationale bien supérieure à celle mesurée par l’IFOP (2024) au niveau national. Comment l’expliquez-vous ?
L’Église MLK est aujourd’hui une Église à portée régionale, voire nationale. Elle n’est plus une Église locale, car moins de 10 % de ses paroissiens résident à Créteil (environ 500 personnes), et ce pourcentage diminue à mesure que l’Église grandit. Elle n’est plus non plus une Église strictement départementale, puisque seulement 33 % des participants habitent dans le Val-de-Marne (94), où elle est implantée.
En revanche, 95 % des fidèles résident en Île-de-France, dont ils reflètent la diversité internationale. En effet, selon l’INSEE, depuis les années 2000, la majorité des nouveau-nés franciliens ont au moins un parent né à l’étranger ou dans un DOM-COM.
Or, cette génération née entre 2000 et 2025 constitue aujourd’hui la majorité des membres de l’Église MLK. Chacun y apporte une part de la culture de ses parents, imprimant ainsi à l’Église MLK une forte dimension internationale.
Une autre réalité fait de la megachurch MLK un Hub national et international : chaque week-end, plus de 200 personnes la visitent depuis un long voyage TGV ou avion. Enfin, la visibilité en ligne de MLK contribue naturellement à renforcer cette dynamique d’internationalisation.
4/ Votre église est à la fois très axée sur le présentiel (dans le Grand Paris) et très engagée dans la relation à distance (MLK Chez-vous). S’agit-il encore de la même Église, ou fait-on face à deux réalités distinctes ?
Il existe en effet deux visages de l’église MLK. L’église de Créteil, en présentiel, est très jeune (âge moyen : 27 ans), très métissée, et accueille chaque année environ 500 baptêmes d’adultes. Elle reflète la sociologie de sa banlieue, avec une orientation politique majoritairement à gauche (60 %), ce qui influence aussi les débats sociétaux, y compris sur des sujets sensibles comme l’avortement. À l’inverse, l’église en ligne attire un public plus âgé (47 ans en moyenne), plus conservateur, tant sur le plan politique (60 % à droite) que théologique. On y retrouve les codes classiques du protestantisme évangélique, avec une approche plus institutionnelle de la foi.
5/ Dans un monde de plus en plus incertain, la demande de sécurité communautaire grandit. L’enquête auprès des fidèles de MLK indique-t-elle un souhait dans ce sens, et si oui, lequel ?
C’est une question essentielle, et MLK semble aller à contre-courant de cette tendance. Rejoindre MLK, pour beaucoup, ce n’est pas chercher une nouvelle communauté fermée, mais s’ouvrir à un espace multiculturel. C’est un désir d’intégration, parfois une quête d’émancipation qui pousse nos jeunes.
Pour d’autres, c’est une fuite — parfois douloureuse — d’un milieu communautaire où ils ont parfois connu des dérives sectaires… C’est pourquoi nous avons choisi de parler d’ un « Espace MLK» plutôt que d’une « communauté » MLK. Mais cette ouverture est aussi une fragilité : le sentiment d’appartenance y est plus diffus, moins structurant.
« Le prix de la liberté de pensée »
Dans une société marquée par l’absence du père, nombreux sont les jeunes adultes en quête de figures d’autorité. L’église MLK ne répond pas à ce besoin par un encadrement paternaliste. Nous avons fait le choix de ne pas soutenir la théologie du “Père spirituel”, très présente ailleurs dans l’univers évangélique francophone. Je m’y oppose fermement, malgré son attrait pour cette génération en quête de cadrage et de sécurité et donc de père de substitution… Cela fragilise certes l’attachement à l’église MLK, mais c’est, à mes yeux, le prix de la liberté de pensée.
6/ Quand on regarde l’origine des fidèles de MLK, la diversité des parcours est frappante. On n’observe pas du tout de phénomène de « niche identitaire ». Comment l’Eglise MLK crée-t-elle du lien entre ce kaléidoscope de convertis ?
Votre question met en lumière le principal défi de l’Église MLK. La plupart des megachurches ont connu leur essor grâce à un ADN fort, clairement identifiable, qui favorise l’homogénéité de leur communauté. Par exemple, la megachurch Hillsong s’est développée à l’échelle mondiale en s’appuyant sur un standard musical et de louange uniformisé, reproduit fidèlement dans toutes les capitales où elle est implantée.
Or, toute organisation humaine a besoin de repères simples et structurants pour perdurer. Pourtant, la singularité de MLK — à l’image de son inspirateur Martin Luther King — réside précisément dans la diversité, plus que dans l’uniformité. A l’église MLK, c’est dans la diversité que nous puisons notre identité! Voilà le paradoxe — presque un oxymore vivant — que nous tentons d’assumer et de faire fructifier.
Ce chemin n’est pas évident : chacun est amené à prendre une certaine distance avec ses repères culturels d’origine, pour se laisser transformer peu à peu par une culture métissée, partagée. À MLK, personne n’est totalement « chez soi »… et c’est ce qui rend l’expérience si particulière. Nous sommes comme dans une auberge, celle du bon Samaritain : un lieu d’accueil et de soin, mais aussi de cohabitation, parfois inconfortable, avec des personnes très différentes de nous. Cela exige de chacun un travail intérieur sur ses attentes, ses références et ses préjugés. Il faut apprendre à aimer concrètement. Le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens est particulièrement vitale pour MLK. Car sans amour, une megachurch comme la nôtre peut se déliter aussi vite qu’elle a grandi.