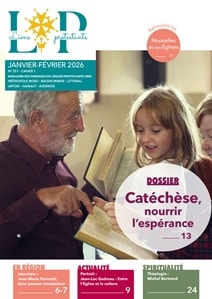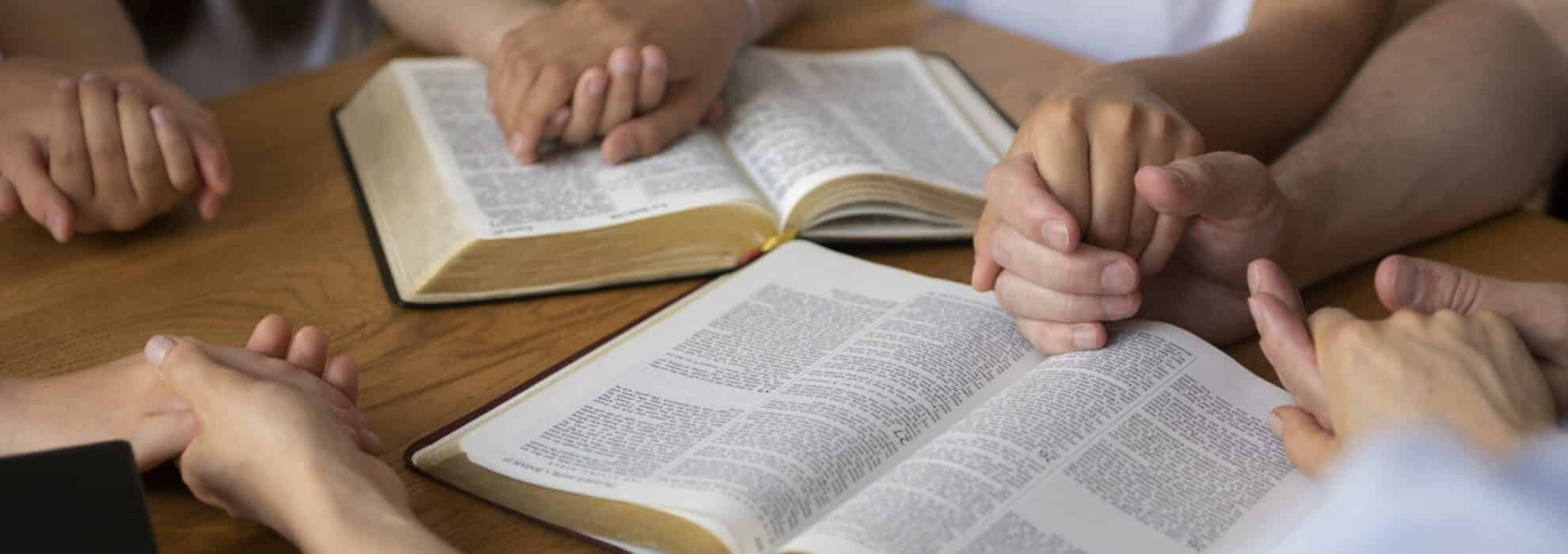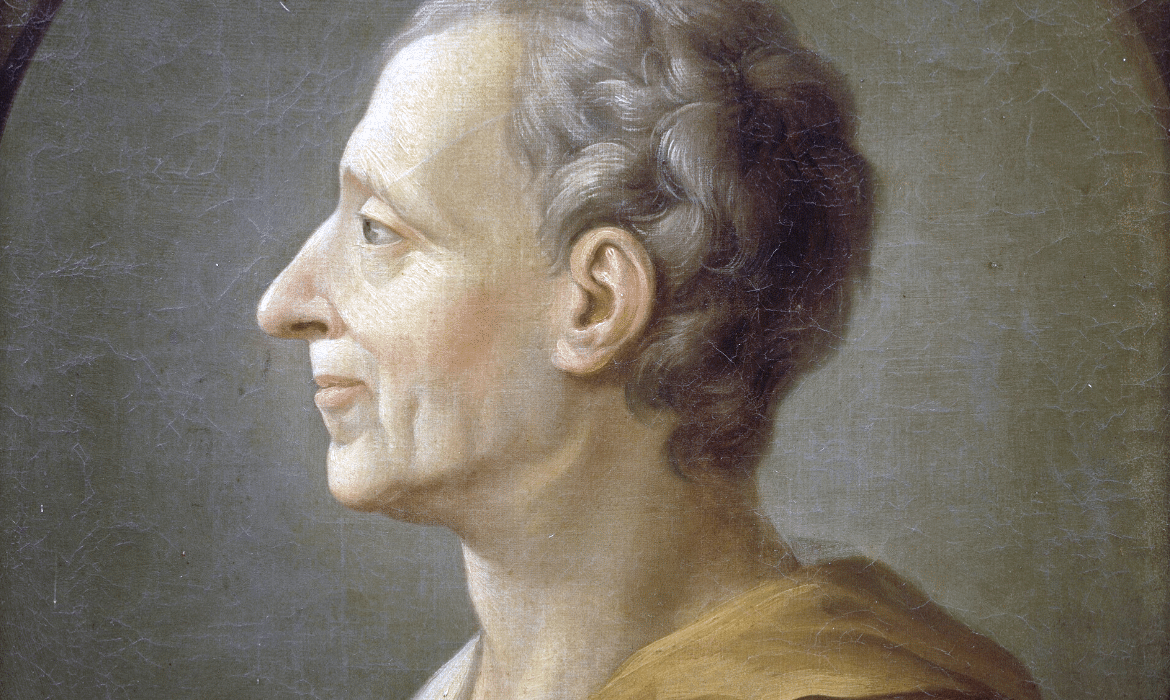Les origines de la communauté
Maubeuge est une ancienne cité drapière du Hainaut. En 1566, le comté devient l’épicentre de la révolte des Pays-Bas. Valenciennes, sa capitale devenue calviniste, se révolte. La répression espagnole y est féroce et le réformateur Guy De Brès y est pendu en 1567. Mais à Maubeuge, aucune communauté réformée n’est alors attestée. Certes, des protestants sont bien présents dans la cité : les sources judiciaires nous donnent quelques noms.
En 1572, le seigneur François de Glarges participe à la prise de Mons par les huguenots et les gueux, unis pour l’occasion. Il est décapité après la reprise de la ville par les Espagnols. En 1573, Antoine Géhennart est supplicié pour avoir résisté aux troupes du duc d’Albe. Puis plus aucun protestant n’est mentionné, si ce n’est quelques fugitifs interceptés à la frontière toute proche.
Une véritable communauté n’apparaît qu’au moment du Réveil du XIXe siècle. Un petit noyau de protestants se forme progressivement grâce au passage de colporteurs bibliques, d’évangélistes et de pasteurs venus de Belgique, notamment de Dour. En 1845, une première salle est louée pour la communauté disséminée dans le Val de Sambre. En 1859, le culte réformé est officiellement autorisé dans la cité. Maubeuge devient, en 1861, une annexe de la paroisse du Cateau. Elle est desservie par le pasteur de cette ville, qui assure cultes et visites. La communauté naissante reste cependant privée d’un pasteur attitré et d’un lieu de culte digne de ce nom, c’est-à-dire d’un temple.
Le temps de l’apogée : une paroisse, un temple
Le premier temple, aujourd’hui appelé « l’ancien temple », est construit en 1876-1877 selon les plans de l’architecte suédois Hansen. Inauguré dès 1878, il a aujourd’hui disparu, mais des photographies permettent d’en apprécier l’aspect.
La façade, richement décorée, présente un fronton surmonté d’une rosace, des contreforts coiffés de pinacles, et une porte encadrée de deux colonnes corinthiennes surmontée d’une Bible ouverte sculptée. Dix-sept arceaux décorent le pignon, tandis que de nombreuses inscriptions bibliques ornent la façade.
L’intérieur était lui aussi remarquable : l’abside en demi-cercle abritait une chaire avec escalier à double volée ; les boiseries conféraient une […]