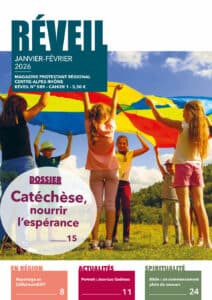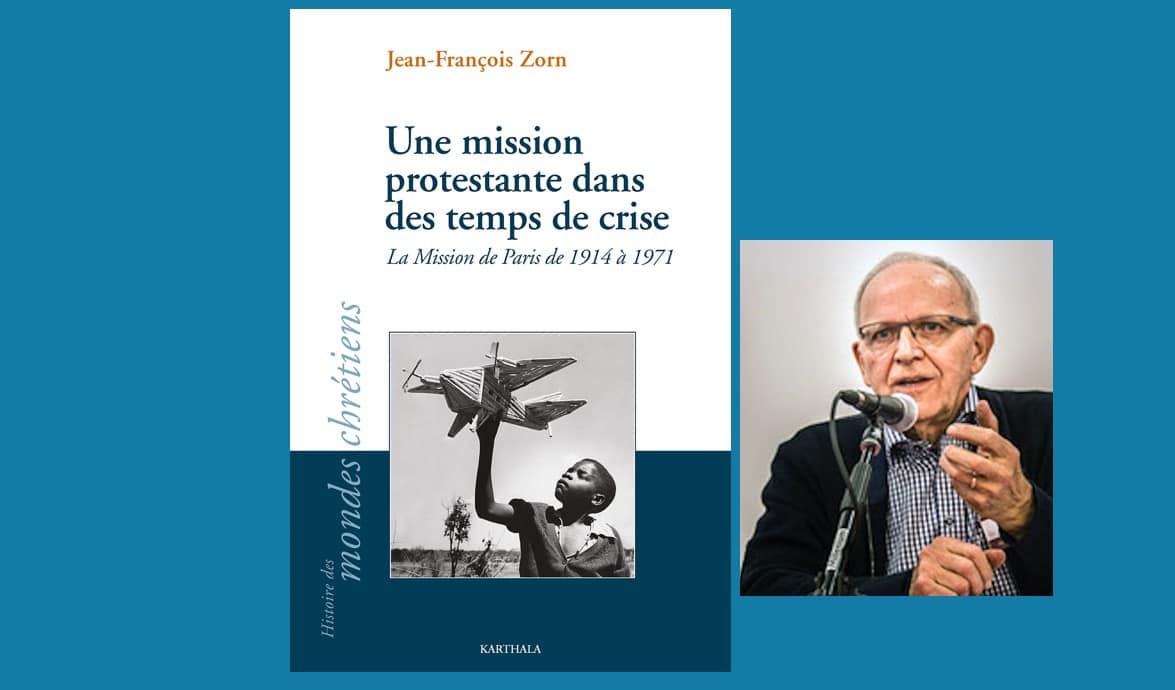Mon père, Pierre Fauriel, avec ses deux frères, Jean et Michel, ont été parmi les pionniers de l’arboriculture fruitière biologique dans le département de la Drôme sur la commune de Loriol après des étapes intermédiaires comme la production fruitière intégrée.
En ce qui me concerne, après des études agricoles (BTS productions fruitières au Lycée agricole d’Avignon) je travaille actuellement avec mon frère Joël en tant que salarié, sur cette même commune de Loriol-sur-Drôme, au sein de la ferme Biotiful, dont il est le gérant. Ce dernier a choisi de commercialiser ses produits localement : marché de détail de Valence, magasins de producteurs bio environnants et, plus récemment et suite à plusieurs années de gel sur les abricotiers et à une production fruitière devenue désormais très aléatoire, une diversification de la production avec la fabrication de pain bio au levain, en tant que paysan-boulanger, initiant par ce fait une vente à la ferme tous les vendredis après-midi.
Dans un monde confronté à des défis environnementaux croissants, l’agriculture et la gestion des espaces naturels se trouvent au cœur des enjeux liés à la préservation de la planète et à la survie de l’humanité.
Quelles articulations entre foi chrétienne et agriculture, entre agriculture et vente locale, entre éthique et écothéologie ?
Dans un monde de plus en plus industrialisé, le lien entre agriculture et foi peut sembler bien lointain. Pourtant, depuis les origines travailler la terre est un acte profondément spirituel.
De nombreuses traditions religieuses voient dans le travail agricole une vocation, une collaboration avec la création et le Créateur. Bien souvent, la terre est perçue comme un don de Dieu. Selon la tradition judéo-chrétienne, comme le stipule Genèse 2.15, l’homme est placé dans le jardin d’Éden pour le cultiver et le garder. Cette mission implique de produire, mais aussi de protéger ; le verbe hébreu utilisé est celui de « garder les commandements de Dieu. » Ce texte a souvent été interprété par les écothéologiens comme une invitation non pas à dominer, mais à prendre soin, à participer à la co-création et à la préservation de la terre. On pourrait parler d’une écologie intégrale où l’agriculture n’est pas une exploitation, mais une gestion responsable.
La théologienne postmoderne Catherine Keller souligne que le Dieu biblique agit dans une relation dynamique avec la création. Pour elle, la création n’est pas un événement passé, mais un processus continu, un « devenir divin » qui appelle les humains à la responsabilité. Elle écrit : « Une écospiritualité ne peut ignorer l’interdépendance radicale de tout ce qui vit ».
Dans un même esprit, l’écrivain, agriculteur et penseur chrétien Wendel Berry écrit que l’agriculteur est en quelque sorte « un prêtre de la terre, et que manger est un acte agricole, mais aussi un acte moral et spirituel ».
Comment pratiquer une agriculture respectueuse, durable et juste ?
La foi peut inspirer des choix éthiques comme le respect de la biodiversité, l’abandon ou le rejet des pratiques plus ou moins destructrices, la solidarité avec les plus pauvres.
Par la limitation drastique des intrants d’origine chimique de synthèse (désherbage, protection phytosanitaire, fertilisation, conservation des produits agricoles), l’agriculture biologique valorise le respect de la terre, la biodiversité de la faune et de la flore, protège la santé humaine ; plus globalement, elle favorise le respect pour la création divine. C’est un concept central pour de nombreuses traditions religieuses.
La commercialisation locale des produits biologiques au-delà de favoriser le rapprochement entre producteurs et consommateurs, permet de valoriser le travail des agriculteurs, réduire l’empreinte carbone liée au transport des […]