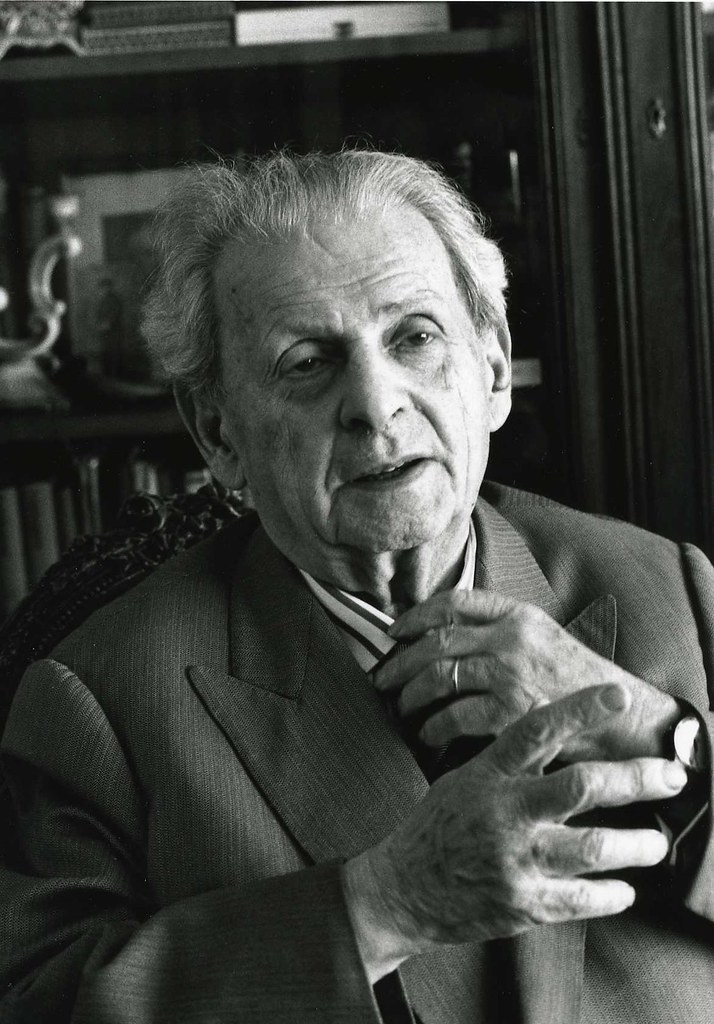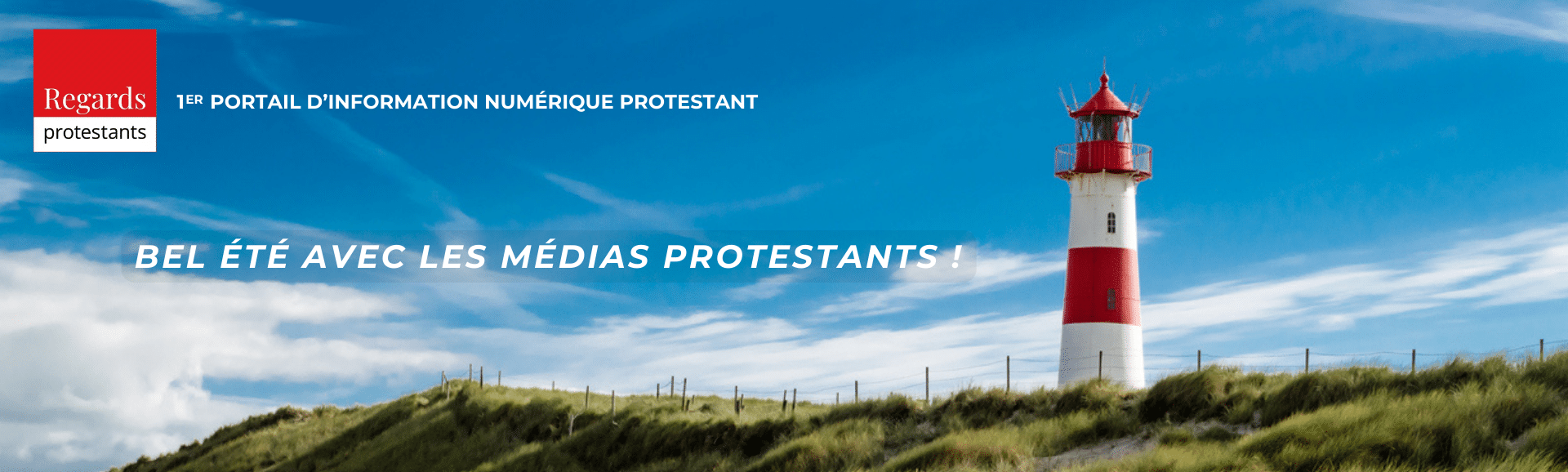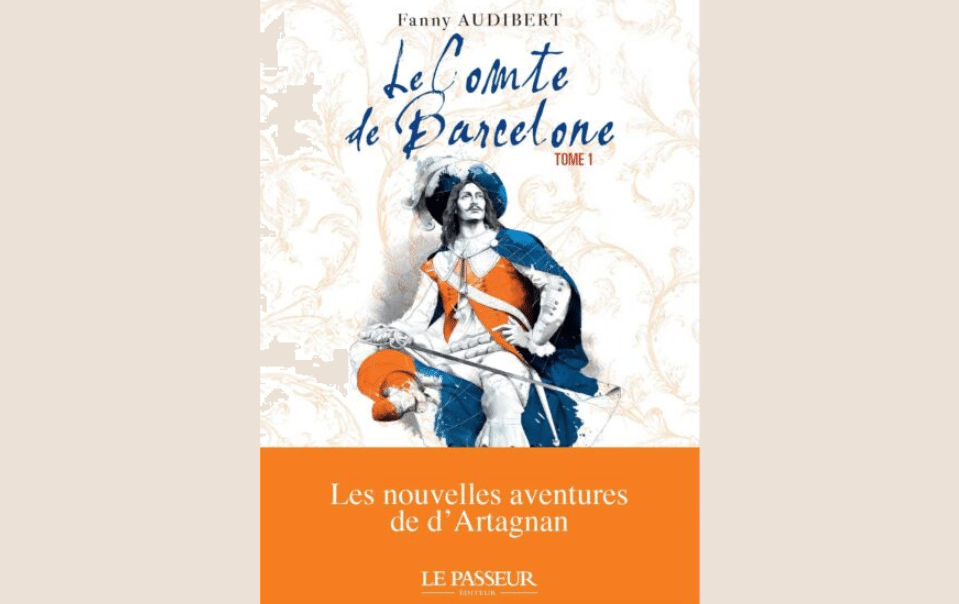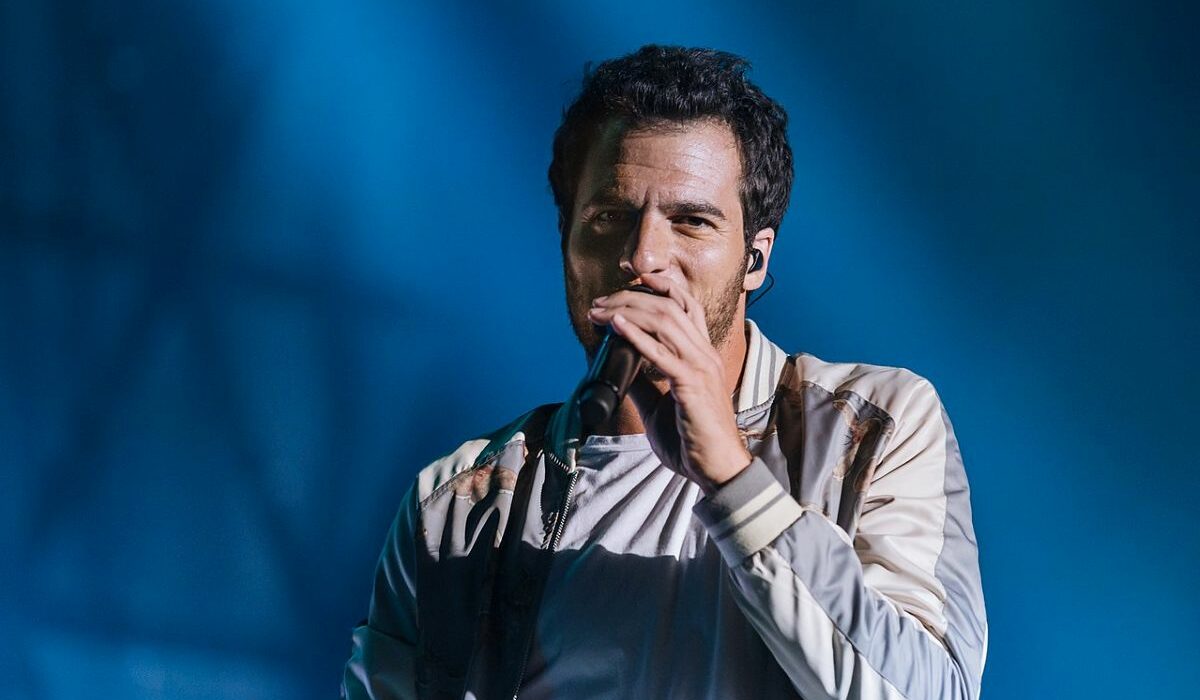Nous héritons d’un nom, d’une famille, d’un réseau de connaissance, d’un niveau culturel, de gênes et aussi d’un capital économique. L’humain qui met son premier pied sur terre est le descendant d’une structure familiale et sociale qui le précédait, d’un maillage complexe qui pose le bébé naissant à l’intersection de forces parfois antagonistes et parfois complémentaires. Nous sommes des héritiers pour le meilleur et pour le pire.
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Dès que l’Homme est capable de penser, il formule ces trois questions. Schématiquement, deux types de réponse ont été proposés au cours des siècles. La première est celle de la philosophie de la liberté qui met l’accent sur le changement et les mutations du monde. L’Homme doit s’adapter constamment au rythme du monde, il est condamné à être libre comme le dit Sartre dans son essai L’existentialisme est-il un humanisme ? L’Homme est obligé de faire avec la liberté. Jamais aucune excuse, ni aucune justification ne pourra le dédouaner de sa responsabilité. L’Homme n’échappe pas à sa liberté car c’est un fait fondamental et constitutif de son humanité. La seconde réponse est diamétralement opposée puisque c’est celle du déterminisme. La liberté n’est qu’une illusion que se donne l’Homme. Bien loin d’être maître de son destin, l’Homme est en fait prisonnier de son histoire et de toute la structure sociale et culturelle dont il a hérité.
Bien entendu, ce n’est pas l’une ou l’autre des solutions mais bien l’une et l’autre que l’on trouve mêlées dans nos existences et dans nos sociétés.
Notre société libérale se leurre
Les parents sont les premiers à naviguer entre les deux, quand ils demandent aux enfants de vivre une vie indépendante et d’être mieux qu’eux et, en même temps, d’être porteurs des valeurs qu’ils leur ont transmises.
Notre société, libérale avancée, qui promeut l’individu autonome, libéré des contraintes et de l’héritage du passé, se leurre elle-même à penser qu’elle a pu engendrer l’Homme nouveau et qu’elle réussit, là où la société communiste a échoué, à faire table rase du passé.
Nos héritages nous constituent à la fois en tant qu’individu et en tant que membre d’une communauté nationale, culturelle, ethnique, religieuse, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les institutions de la République essayent de corriger les inégalités d’héritage en donnant à chacun une chance équivalente d’accès aux études ou aux emplois qualifiés. Ces institutions essayent de corriger les écarts de richesse en organisant par l’impôt ou les droits de succession une certaine circulation du capital. Notre système de protection sociale performant a sans doute permis de limiter les conséquences dramatiques de la crise de 2008 qui a causé des drames humains importants aux États-Unis ou en Angleterre. Malgré tout cela, l’inégalité d’héritage demeure et se perpétue.
L’école permet-elle plus d’égalité ?
L’héritage est analysé par le sociologue Pierre Bourdieu comme un vecteur de reproduction de la hiérarchie sociale. Il montre que dans les sociétés précapitalistes, ce sont les stratégies matrimoniales qui étaient prépondérantes. Par contre, dans nos sociétés, ce sont les stratégies scolaires qui dominent. Dans le premier cas, il s’agit souvent de transmettre un patrimoine sans l’éparpiller, d’où des stratégies matrimoniales dont font preuve les familles pour marier les aînés qui héritent généralement seuls de la terre1. Bourdieu montre que, par la suite, la montée en puissance de l’État conduit à une modification des stratégies de transmission familiale. C’est l’institution scolaire qui va concentrer les enjeux principaux de cette transmission. Le diplôme devient nécessaire pour légitimer une position dominante. Pierre Bourdieu montre que l’école ne fonctionne pas comme un redistributeur social mais qu’elle fait perdurer les inégalités de départ. Les étudiants issus des catégories les plus défavorisées n’héritent pas au sein de leur milieu familial du « capital culturel » dont parle Pierre Bourdieu qui est valorisé par l’école. Ils ne possèdent donc pas les codes et les habitudes du milieu scolaire, ce qui les met d’emblée en position d’infériorité. La culture de l’école fait l’objet d’une acquisition laborieuse pour les individus qui ne sont pas issus des classes cultivées. Cécile Ladjali, enseignante en ZEP en Seine-Saint-Denis et auteur de l’Éloge de la transmission, dresse un constat très négatif : « Dans les classes à Saint-Denis, la culture subit une véritable suspicion de la part des jeunes de banlieue (…) Un énorme fossé se crée de plus en plus, entre les riches de mots et les pauvres de mots ». Comme l’écrit Pierre Bourdieu, pour beaucoup, « l’acquisition de la culture scolaire est acculturation », c’est-à-dire qu’elle implique une distanciation vis-à-vis de la culture d’origine pour mieux s’imprégner des normes et des valeurs de l’école.
Le système scolaire ne parvient pas à atténuer le poids de l’héritage familial et, dans la plupart des cas, il reproduit à l’identique les inégalités d’origine.
La résilience pour sortir du cercle vicieux
La transmission du capital culturel semble centrale dans le processus de reproduction sociale et conditionne fortement la réussite scolaire et donc la position sociale de chacun. Serions-nous des prisonniers passifs de notre héritage ? L’individu a pourtant les moyens de rejeter l’héritage qu’on lui attribue. Le neuro-psychiatre Boris Cyrulnik, par le concept de résilience, a mis en évidence la manière de rebondir après un traumatisme, pouvoir redevenir humain après un fracas et rompre ainsi le cercle vicieux de la transmission du malheur. L’individu peut mettre en place un certain nombre de mécanismes pour réagir aux infortunes de l’histoire.
D’une manière plus générale, certains auteurs, qui s’inscrivent dans les théories sociologiques individualistes, considèrent la transmission comme une base transformable et nécessairement transformée. Toute personne passe par un processus de déconstruction et de reconstruction de son histoire. Dès lors, en passant d’une génération à l’autre, les individus sont amenés à ne pas reproduire.
Et puis, il y a le hasard. Déjà au IVe siècle avant J.-C., Aristote pensait que tout ne se produit pas par nécessité et que le hasard peut devenir créateur et participer à ce qui se transmet.
Brice Deymié,
Aumônier national des prisons à la FPF
1 Le sens pratique, Pierre Bourdieu, éditions de Minuit, 1980.