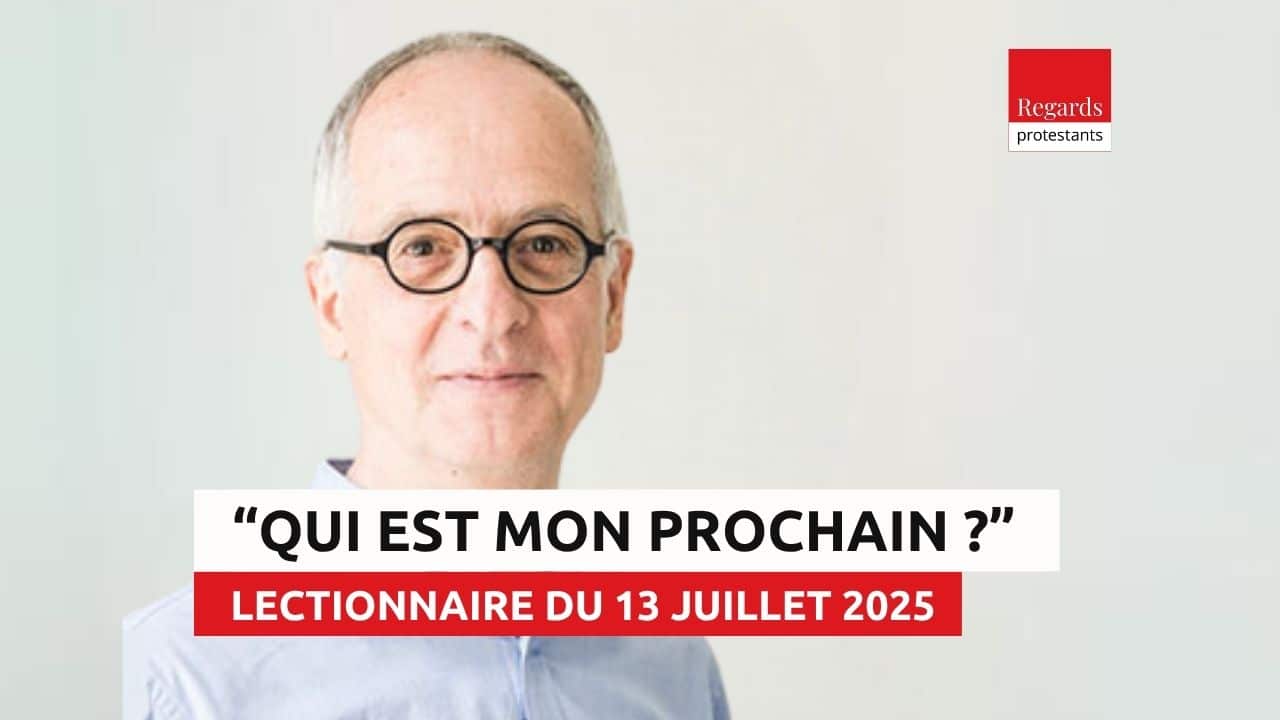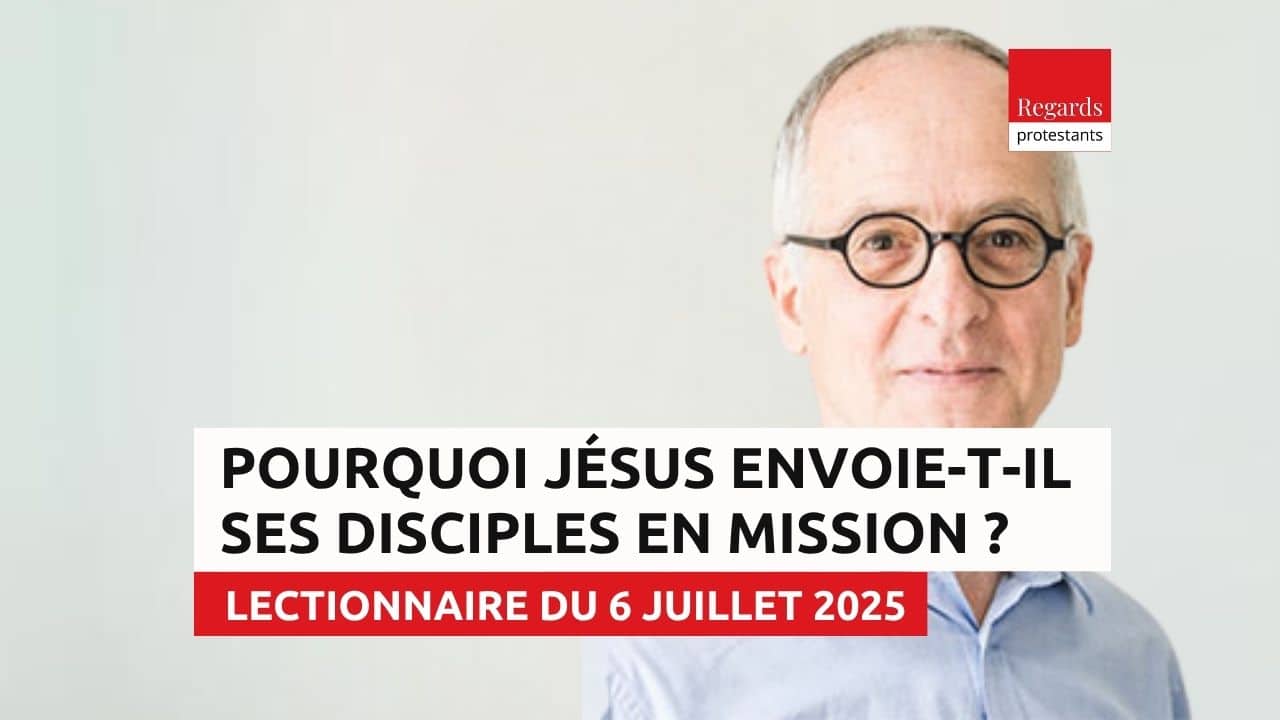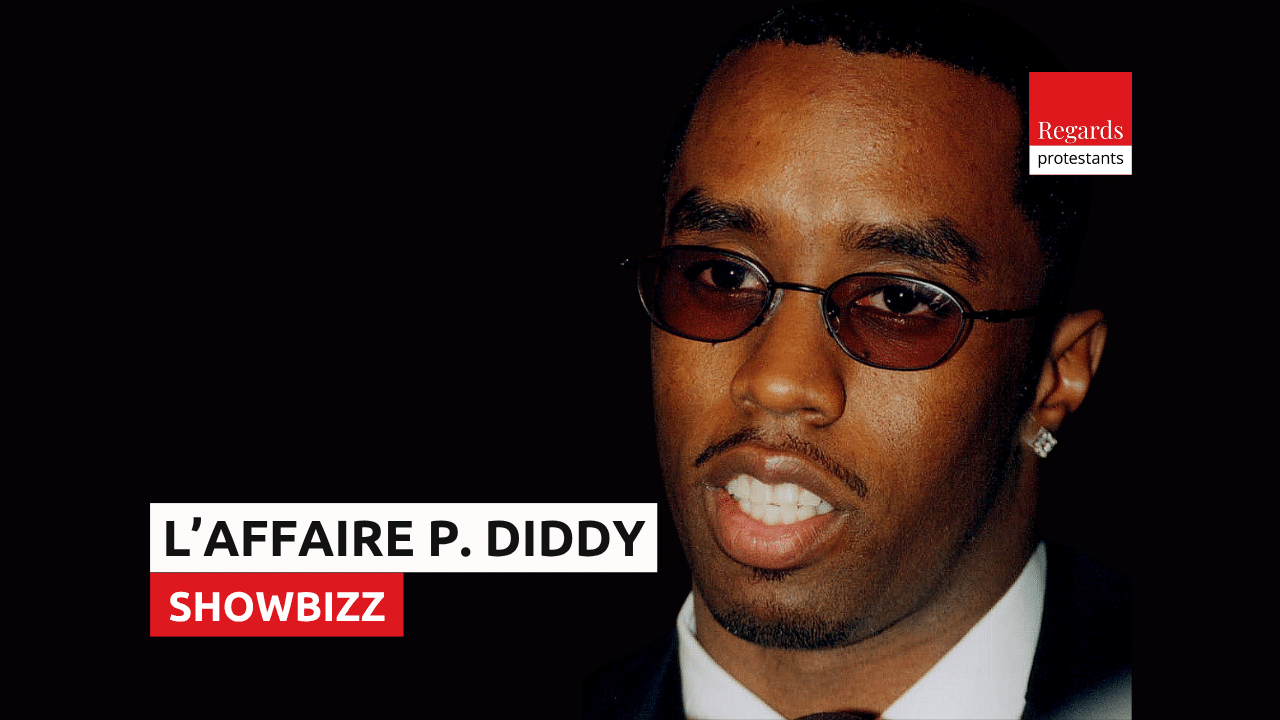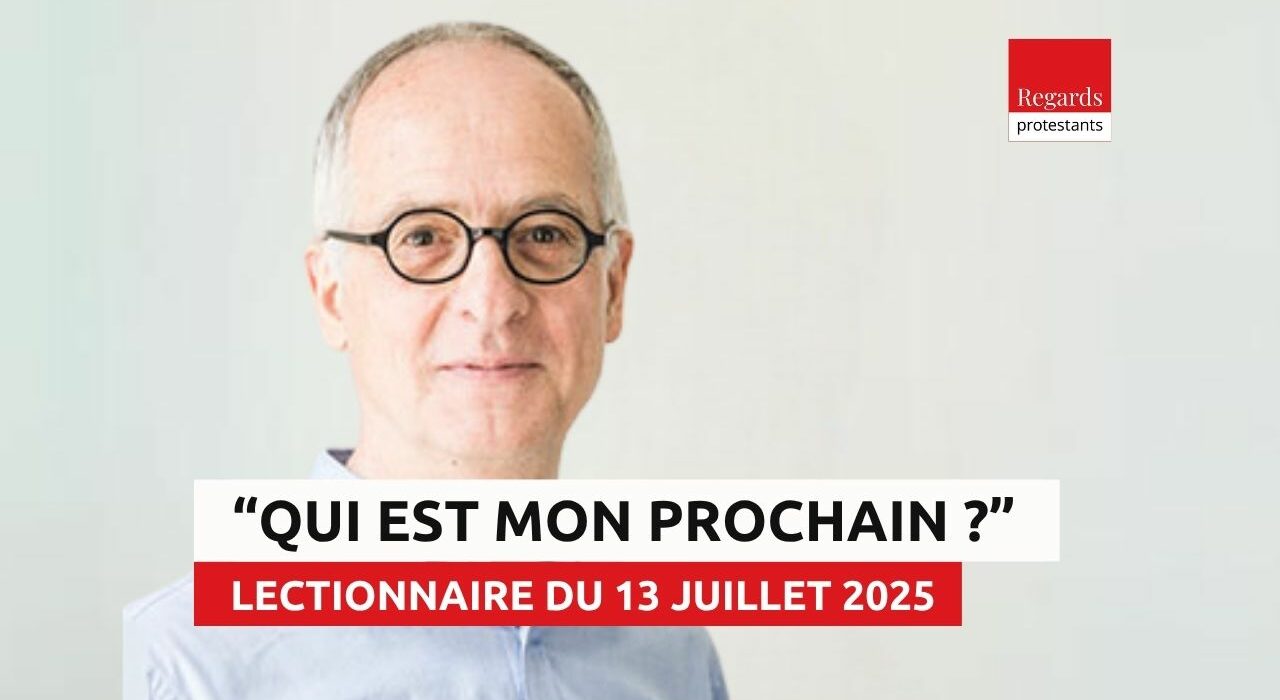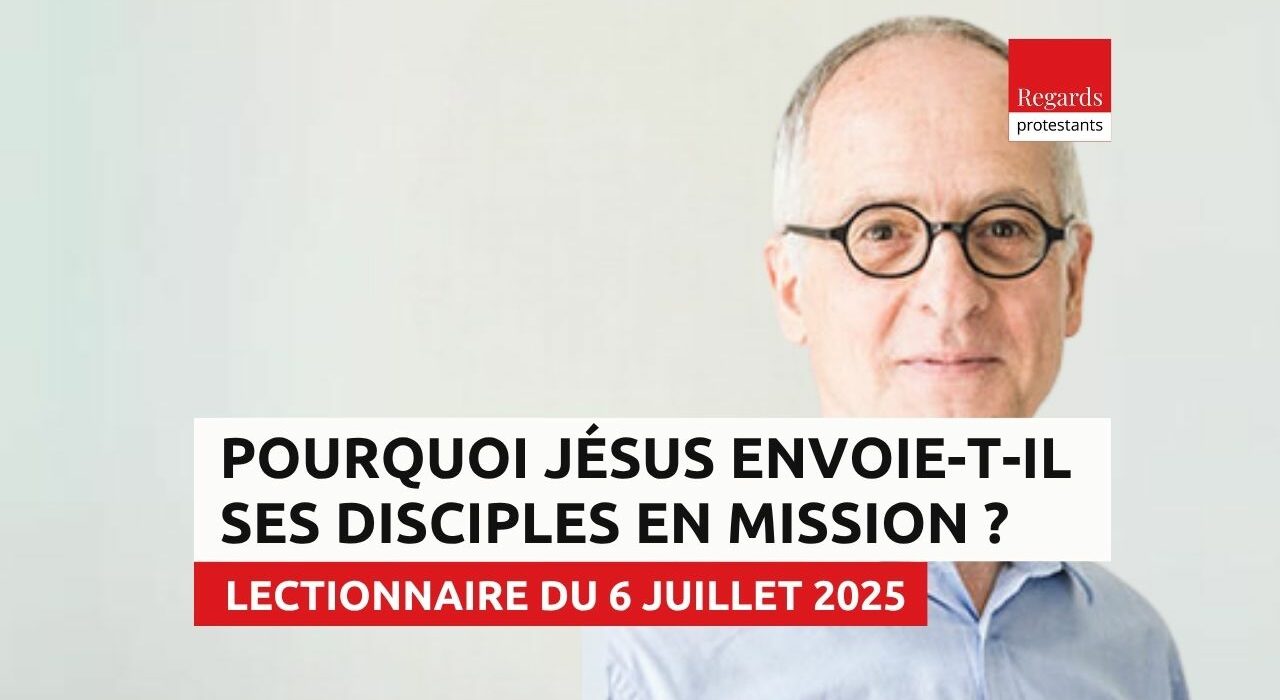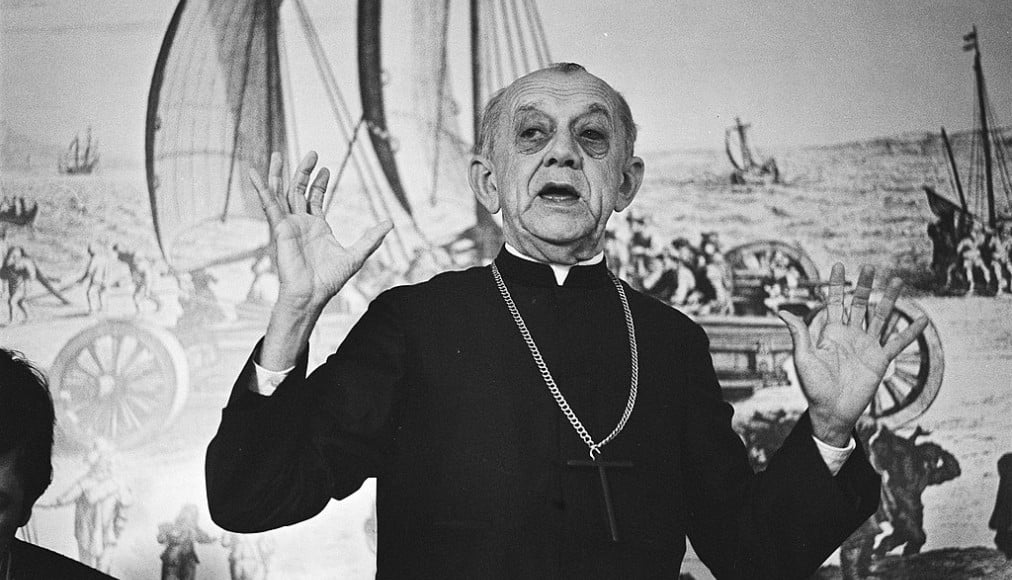En 325 après Jésus-Christ, un événement majeur marque un tournant dans l’histoire du christianisme : le concile de Nicée. Réunis à l’appel de l’empereur Constantin, quelque 300 évêques venus de tout l’Empire romain sont chargés de répondre à une question essentielle, que le Christ lui-même avait posée à ses disciples : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? »
C’est dans ce contexte, à la fois religieux et politique, que naît le Credo de Nicée, ou plus précisément le symbole de Nicée-Constantinople, toujours récité aujourd’hui dans les liturgies catholique, orthodoxe, protestante et anglicane. Loin d’être un texte poussiéreux, il est au cœur de la foi chrétienne contemporaine.
L’origine de ce credo remonte à une crise théologique déclenchée par Arius, prêtre d’Alexandrie. Ce dernier affirmait que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avait été créé par le Père et n’était donc pas éternel. Une idée jugée incompatible avec la foi des Églises. Face à cette divergence, les évêques rassemblés à Nicée proclament que le Christ est « consubstantiel au Père », c’est-à-dire de même nature divine. Cette formulation, empruntée à la philosophie grecque, n’est pas issue directement de la Bible, mais vise à en résumer fidèlement l’enseignement.
L’enjeu est double : théologique et politique. Pour Constantin, nouvel empereur converti au christianisme, l’unité de la foi est aussi un outil de stabilité pour son empire. L’Église, autrefois persécutée, est désormais convoquée par le pouvoir impérial, avec postes gratuits et reconnaissance officielle. C’est un basculement historique.
Le concile de Nicée produit aussi d’autres décisions, comme une date commune pour la célébration de Pâques. Mais c’est surtout le Credo qui devient le point de ralliement des chrétiens. Comme l’explique le pasteur Timothée Gestin, il agit comme un « mot de passe », un langage commun entre croyants, malgré les divisions ultérieures.
Le terme consubstantiel — pourtant absent des Écritures — symbolise aussi le rôle de la culture dans l’interprétation de la foi. L’Église ne récite pas la Bible mécaniquement, elle la médite et l’exprime à la lumière de la raison humaine.
Aujourd’hui encore, ce Credo a une forte portée œcuménique. Il rappelle que, malgré les différences confessionnelles, la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, unit l’ensemble des Églises chrétiennes.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Remerciements : Timothée Gestin
Entretien mené par : David Gonzalez
Technique : Horizontal Pictures, Quentin Sondag