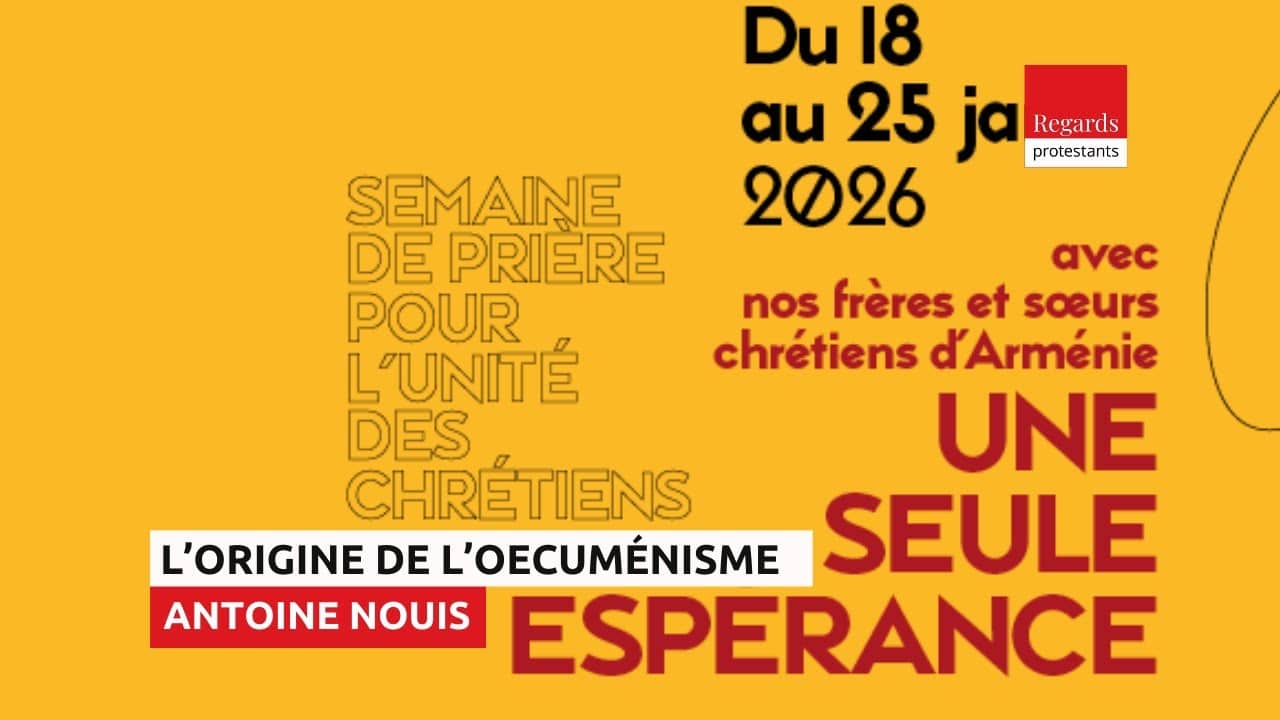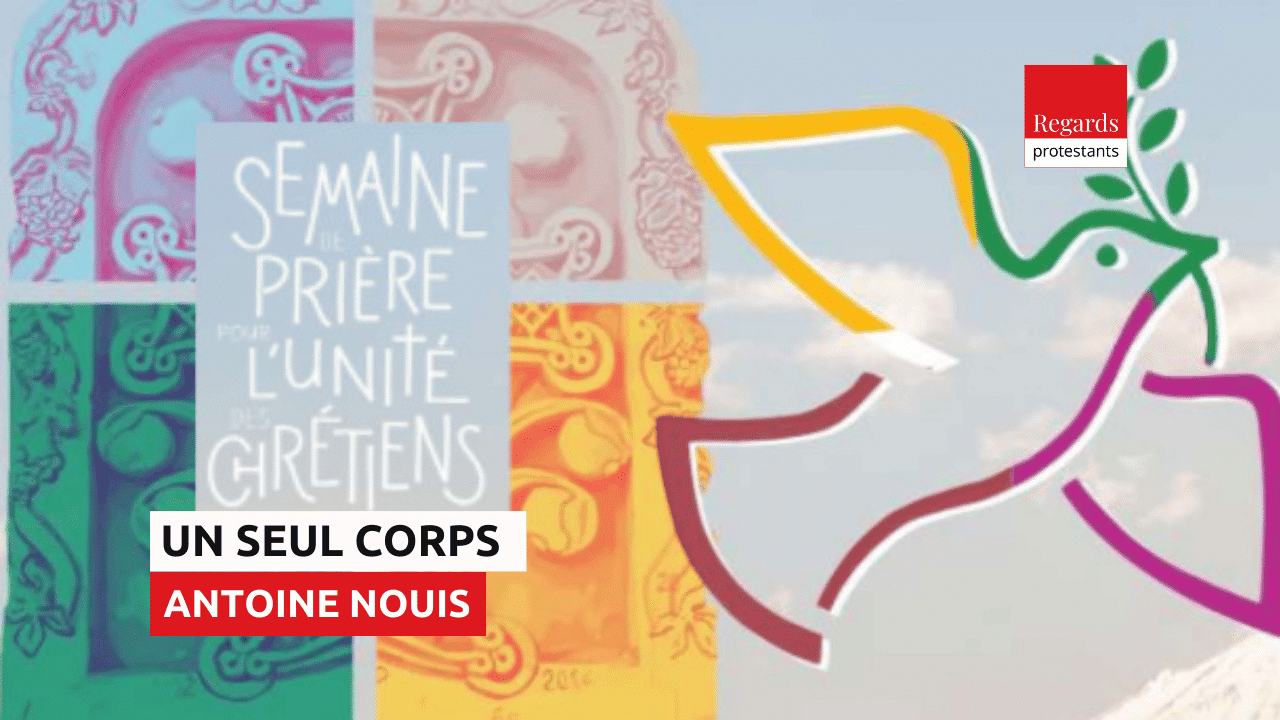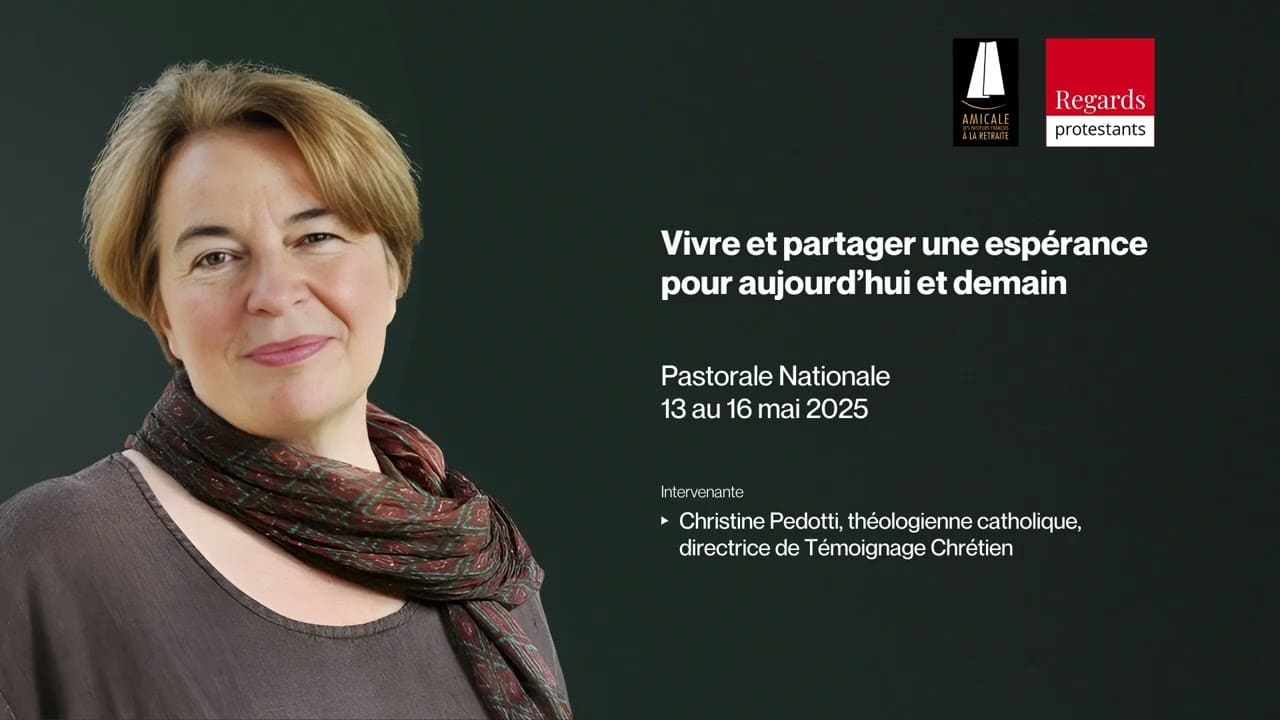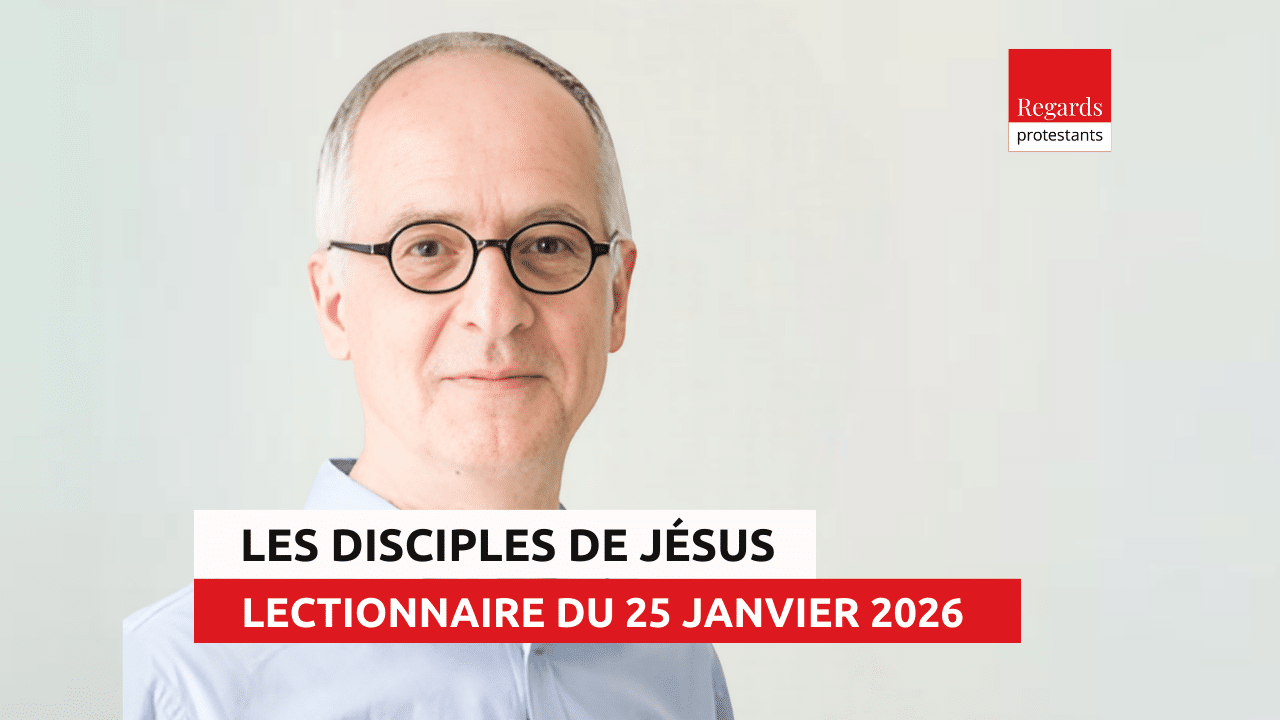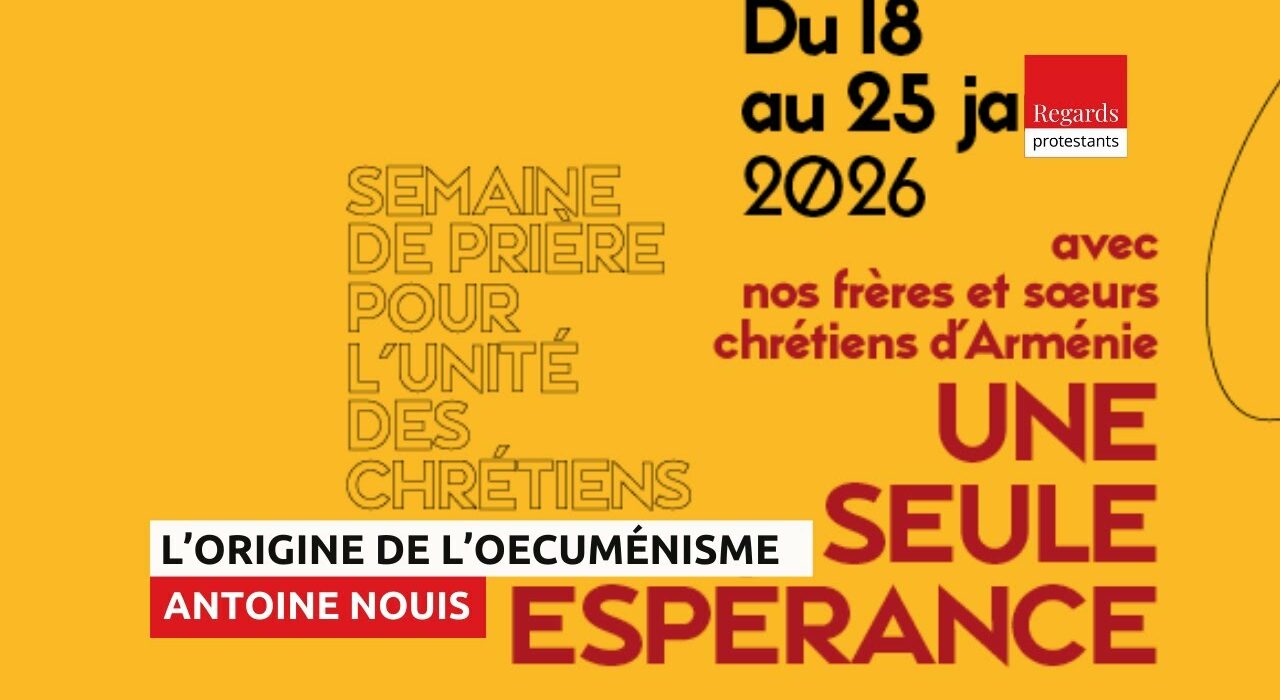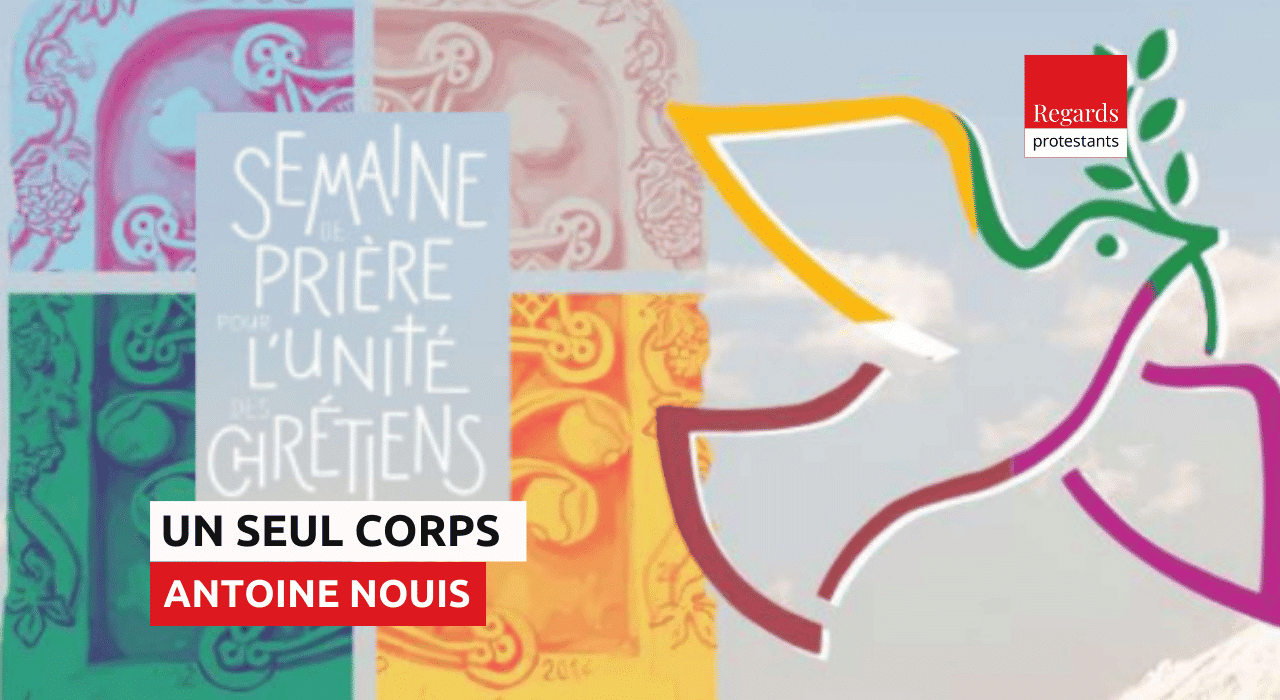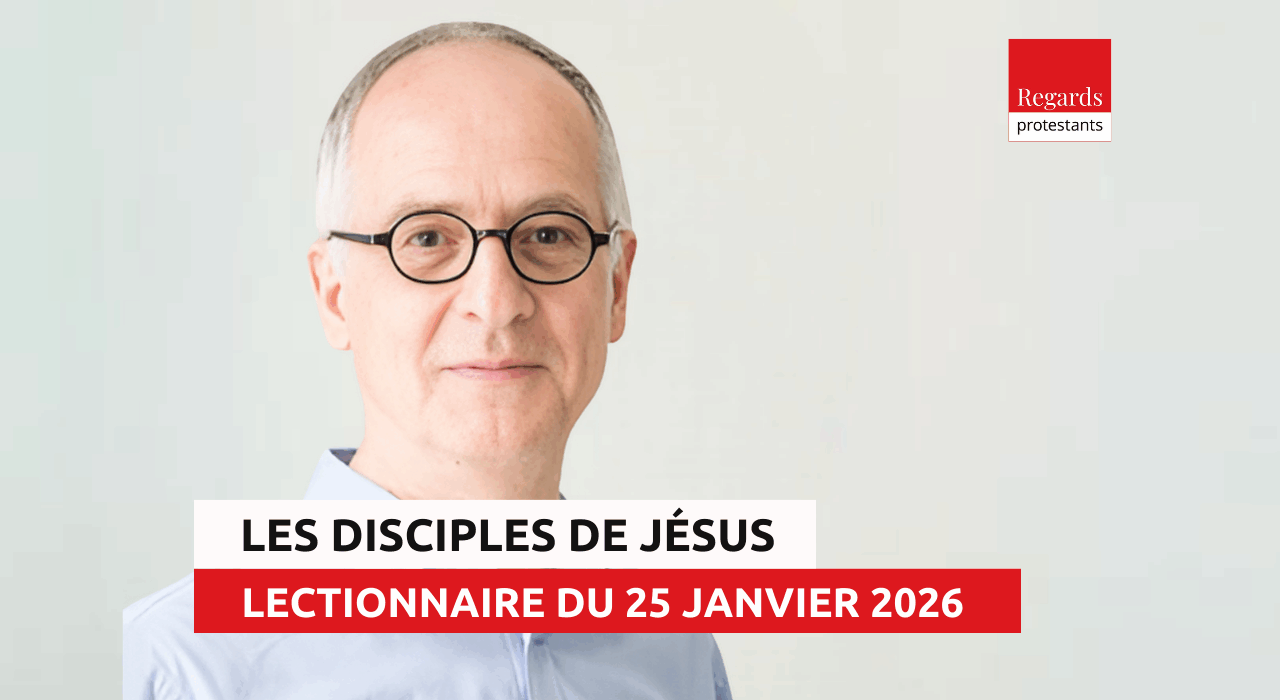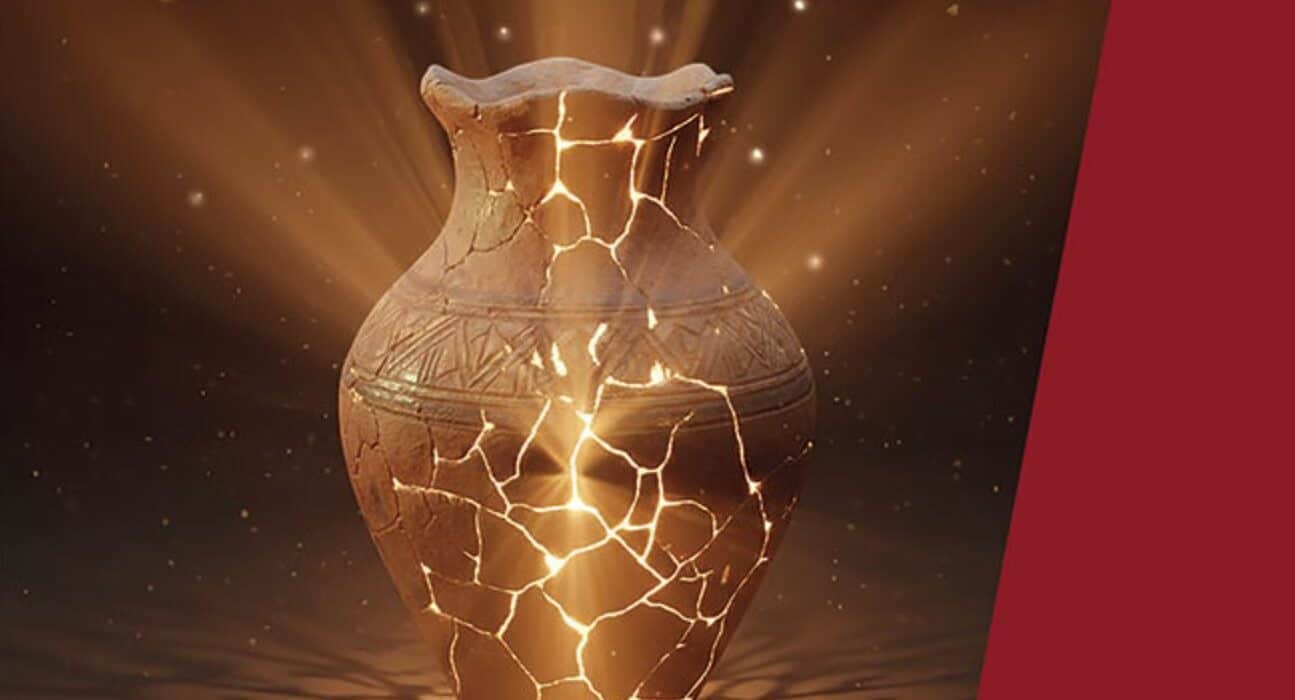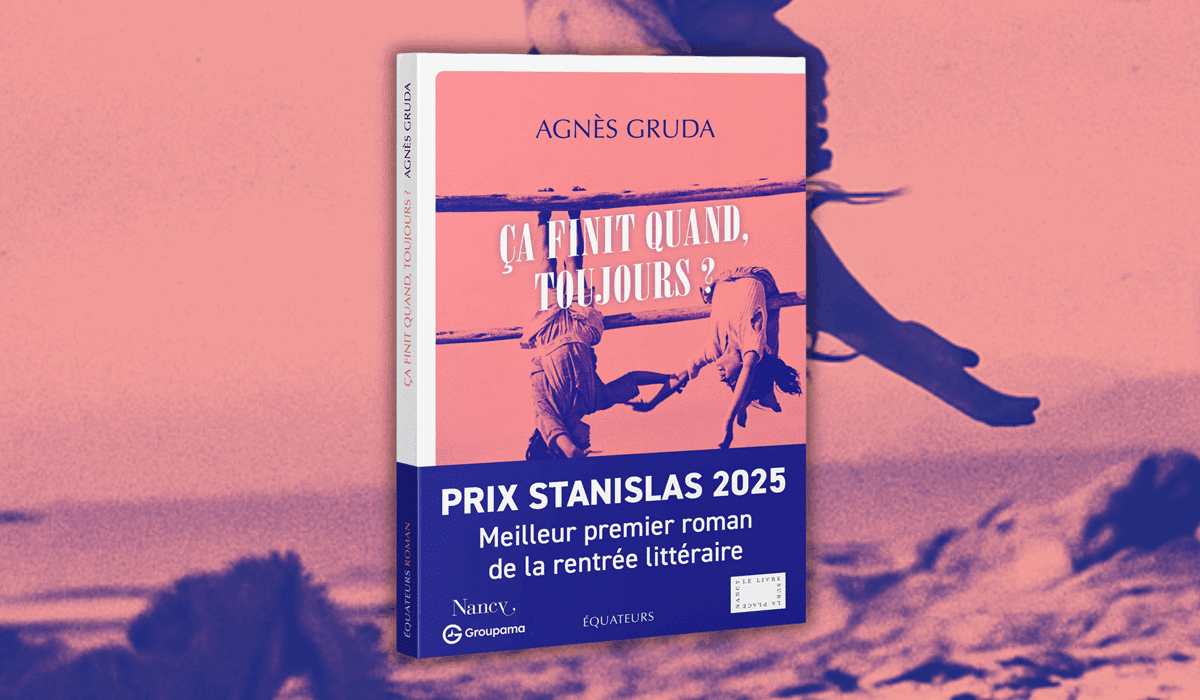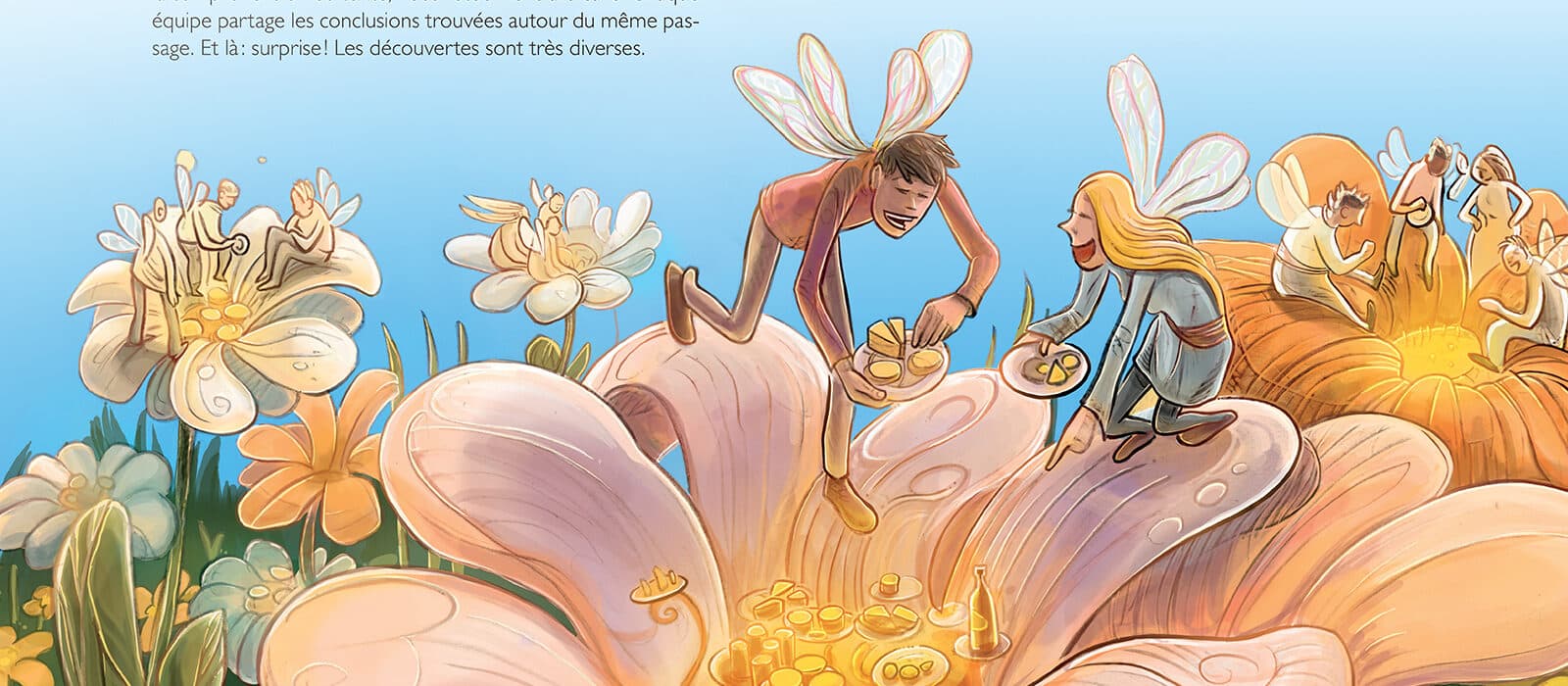Dans son ouvrage Le Partage. Jésus, les premiers chrétiens et l’argent, l’historien Jonathan Cornillon, maître de conférences à la Sorbonne et membre de l’Institut universitaire de France, explore une facette souvent méconnue du christianisme primitif : son organisation économique et ses implications sociales. À rebours des représentations spirituelles exclusives, il révèle une ambition concrète de transformation des rapports sociaux.
Les premières communautés chrétiennes, dès le Ier siècle, mettent en place un système de solidarité radical, fondé sur la mise en commun des biens. Inspirées du modèle de Jérusalem, ces communautés partagent un « fonds commun » alimenté par les dons de tous, riches ou pauvres. L’objectif : que personne ne manque de l’essentiel, notamment de nourriture. Cette logique collective se retrouve dans divers textes anciens, de Polycarpe à Tertullien, malgré la diversité géographique et temporelle des sources.
Si cette solidarité n’abolit pas juridiquement la propriété privée, elle la relativise fortement dans les faits. En cela, elle constitue une remise en cause implicite des hiérarchies économiques du monde romain. Pour Jonathan Cornillon, cet aspect subversif, bien que souvent dissimulé derrière un discours loyaliste envers le pouvoir impérial, est central.
La question de la rémunération des prédicateurs est aussi abordée. Si, à l’origine, les prédicateurs itinérants se contentent de subsister, la constitution d’une hiérarchie ecclésiastique dès le IIe siècle amène à une forme de compensation, sans que cela ne devienne un enrichissement. Toutefois, à partir du IIIe siècle, des différences de traitement apparaissent, signe d’une certaine aristocratisation du clergé.
Autre point saillant : la solidarité face à la mort. Enterrer les frères et sœurs dans la foi devient un impératif moral. Cette pratique aboutit à la création de cimetières chrétiens, reflets d’une volonté d’unité eschatologique.
« Les chrétiens des premiers siècles ont bel et bien cherché à changer la société, non par les structures, mais par des modes de vie alternatifs », explique Jonathan Cornillon. Si cette tentative n’a pas bouleversé l’ordre social romain, elle a tout de même introduit de nouveaux standards de solidarité, certains repris plus tard par les institutions. Une révolution douce, mais réelle.
Production : Fondation Bersier – Regards protestants
Remerciements : Jonathan Cornillon
Entretien mené par : David Gonzalez
Technique : Horizontal Pictures
A voir aussi :