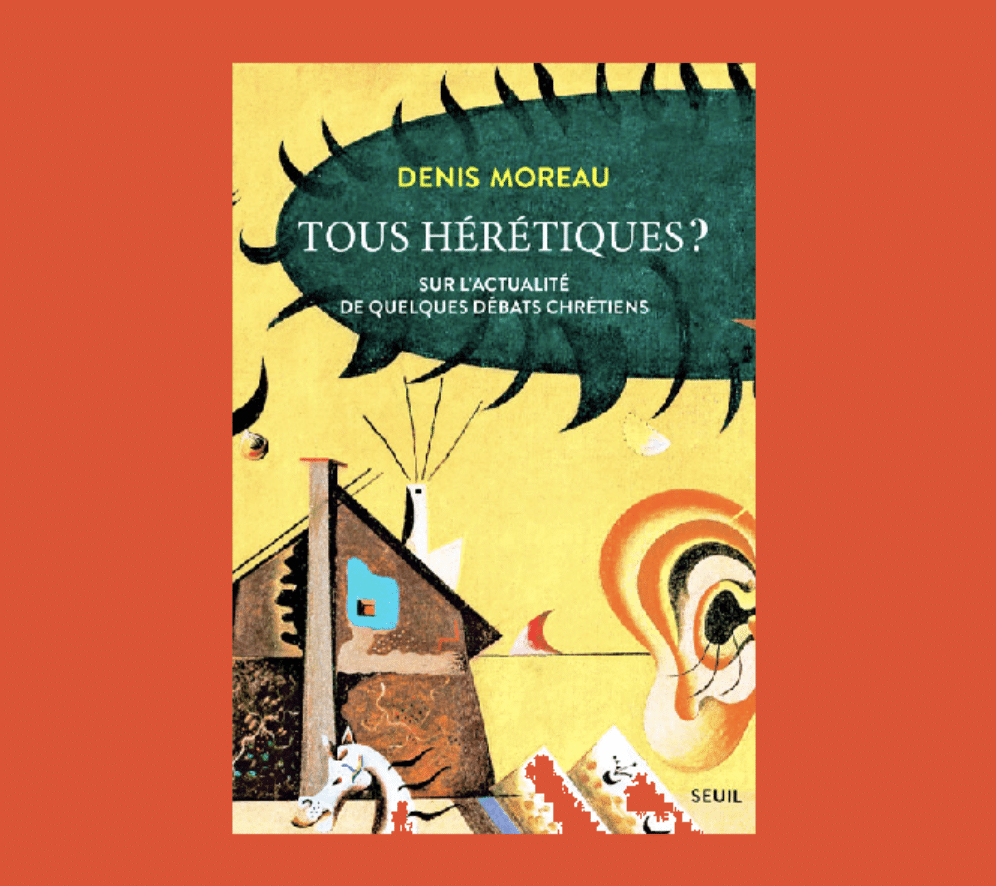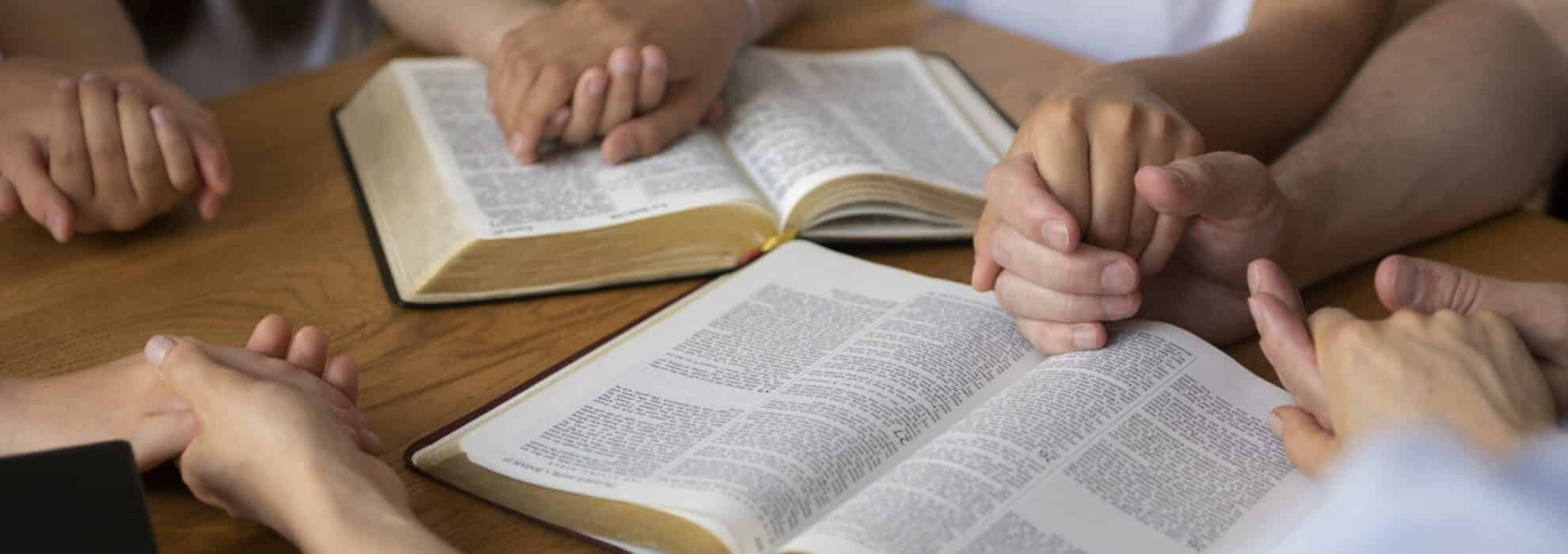Ce que révèle Bétharram, ce n’est pas une simple défaillance humaine, ni même une dérive institutionnelle. C’est une violence structurelle où l’ascèse devient non pas un chemin d’élévation, mais une fabrique de douleur. Le clerc, sommé de nier son corps, sa sensibilité, son humanité, se mutile intérieurement. Et cette mutilation, il l’érige en règle pour les autres : « Je souffre, donc tu dois souffrir. »
Peu à peu, cette violence s’installe et devient norme. Elle s’érige en système. Et comme tout le monde finit par y consentir – par peur, par loyauté, ou par croyance – elle s’enracine et devient le ciment du groupe. C’est ainsi que naît l’omerta, si difficile à comprendre. Cette logique pervertit le cœur même du message chrétien car on fait le mal au nom du Bien – une trahison qui, à elle seule, suffit à nier ce même message. Cela engendre des générations d’athées par dégoût, ou de croyants cabossés, marqués à vie par une foi qui aurait dû les libérer.
Ce qui se joue à Bétharram et dans toutes ces institutions aliénantes se rejoue à l’échelle de nos sociétés. Lorsque la violence n’est plus endiguée par un récit unificateur – capable de transformer la peur en relation, la colère en justice, la souffrance en fraternité – elle se répand, désinhibée. La société bascule alors dans des logiques d’autoritarisme, de compétition et de domination qui finissent par faire de la violence la matrice du lien social. Arrivent ensuite au pouvoir des extrémistes qui cristallisent cette violence, certains se réclamant même du christianisme tout en en trahissant chaque mot.
Face à cela, nous, protestants, portons une responsabilité : remettre en question et témoigner pour sortir du cycle de violence, montrer par l’exemple que le message chrétien peut encore éclairer, apaiser, orienter.
Thomas Kauffmann, anthropologue et humanitaire, pour « L’œil de Réforme »