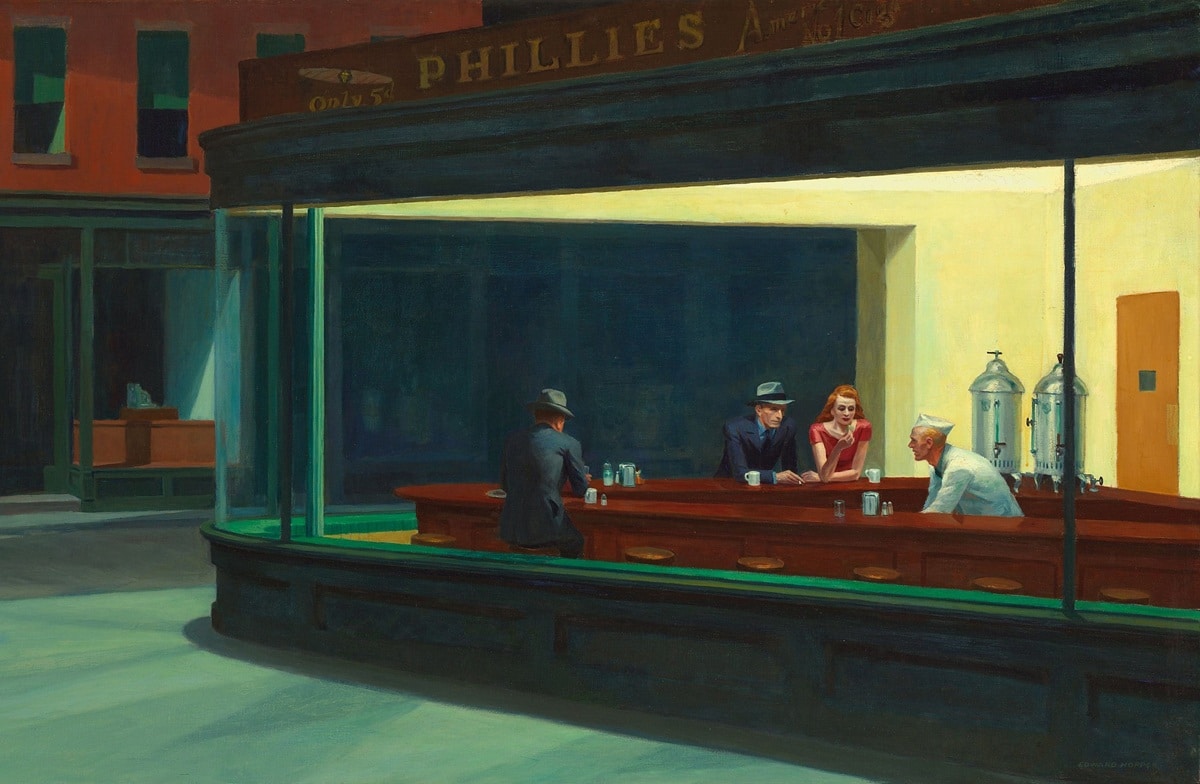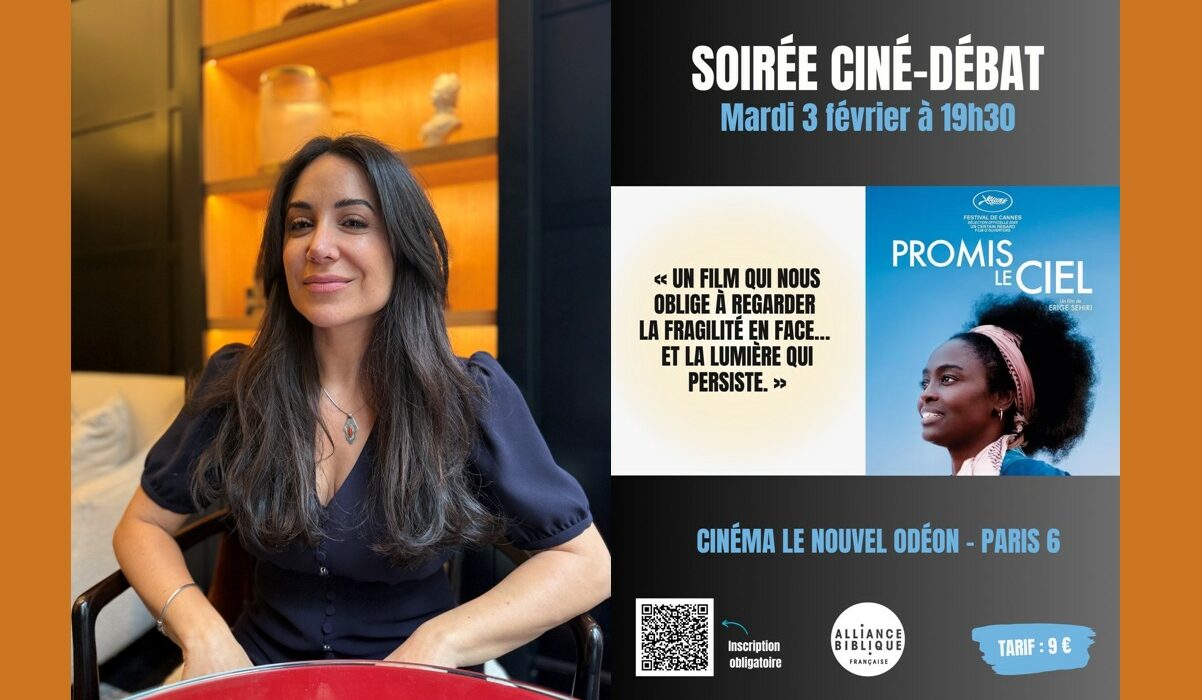Dominique de Villepin vient de publier, sur la plateforme Le Grand Continent, un texte substantiel (qui fait une soixantaine de pages en format PDF) intitulé Le pouvoir de dire non. Il n’en est sans doute pas le seul auteur. On sent, ici ou là, l’usage de fiches de lectures ou de notes de synthèse, mais peu importe. J’ai été assez étonné du contenu, aussi stimulant que lucide, de cet essai, assez loin des positions tenues par l’essentiel de sa famille politique, aujourd’hui.
On peut résumer sa position en citant deux phrases conclusives : « Tout commence par une reconnaissance : celle de nos limites. Puisque, comme j’ai voulu le montrer, la rareté planétaire est la source souterraine de toutes les dérives politiques actuelles ». Je suis très largement d’accord avec cette analyse.
Quand le déni des limites rend fou
Il commence son propos en parlant de la politique délirante mise en œuvre par Donald Trump. Et il souligne, avec raison, que Trump est l’arbre qui cache une forêt bien plus vaste. Sa réélection doit nous interroger : elle est le signe de l’ancrage politique profond de ce mouvement, dont on trouve d’autres avatars, ailleurs dans le monde, et jusque chez nous.
En fait, l’humanité tout entière, et même (ce qui est nouveau) la partie la plus nantie d’elle-même, bute, aujourd’hui, sur les limites de la Terre. Et cela génère des réactions extrêmes : « le déni frontal, la négation volontaire de toute limite. C’est l’illimitisme assumé, incarné par Donald Trump, figure d’un absolutisme sans habillage doctrinal, empire d’instincts et de postures, empire de commandement, au sens premier de l’imperium. L’action prime, le verbe tranche, le chef domine. Il ne gouverne pas, il incarne. Il n’organise pas, il impose. À l’intérieur comme à l’extérieur, tout doit se soumettre au théâtre de la puissance, à sa visibilité, à sa démonstration ».
Cet illimitisme rencontre un ressort profond chez tout un chacun : l’ivresse de la puissance totale. Il a été soutenu, historiquement, par les succès de l’innovation technique qui ont conduit, sans cesse, à repousser la frontière du possible. Ce qui était impossible aujourd’hui deviendrait possible demain.
Il y a des fondamentaux auxquels l’innovation technique ne permet pas d’échapper
Mais les succès évidents de l’innovation technique ont fait oublier qu’elle ne contournait que très partiellement certains fondamentaux. Au nombre de ces fondamentaux, il y a la consommation élevée d’énergie, impliquée dans pratiquement toutes les innovations techniques. On rêve, bien sûr, de produire plus en consommant moins d’énergie. On y réussit en partie, mais en partie seulement. En fait, aucune innovation technique n’a, depuis deux siècles, permis un retournement de tendance significatif. Le monde, dans son ensemble, continue à consommer de plus en plus d’énergie. On peut faire la même remarque sur la consommation des minerais et des ressources naturelles : aucune technique de recyclage n’est parvenue à freiner significativement la chasse aux minerais un peu partout dans le monde.
En résumé, dans certains domaines, l’horizon du possible se déplace, mais dans d’autres, non. Et c’est là que l’imaginaire de la toute-puissance, qui nous habite tous, se heurte à une réalité profondément blessante pour nous egos : il y a, bel et bien, de l’impossible.
Et cela produit, comme l’écrit Dominique de Villepin « le trumpisme qui est davantage qu’un homme : c’est une structure affective, une économie morale fondée sur la domination. La nature, la femme, l’étranger, tout doit y rester à sa place ».
Il y a pourtant de belles choses à vivre ensemble, au sein de nos limites collectives
Or cette angoisse, qui étreint particulièrement ceux qui ont eu l’habitude de se servir en premier, dans les biens à disposition sur la planète, un moment donné, nous fait oublier qu’il y a énormément de belles et de bonnes choses à notre disposition, pour peu que nous soyons disposés à les partager.
Oui, beaucoup, même parmi les chrétiens de tous bords et de tous pays, semblent sourds à la question fondamentale posée par l’évangile : « que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s’il se perd ou se ruine lui-même ? » (Luc 9.25).
Qu’avons-nous à espérer de cette folie prédatrice, en admettant même que nous soyons du côté des privilégiés ? Peu de choses, en fait. Bien moins, en tout cas, sans même parler d’amour du prochain, que de la joie de vivre ensemble des relations mutuellement enrichissantes.