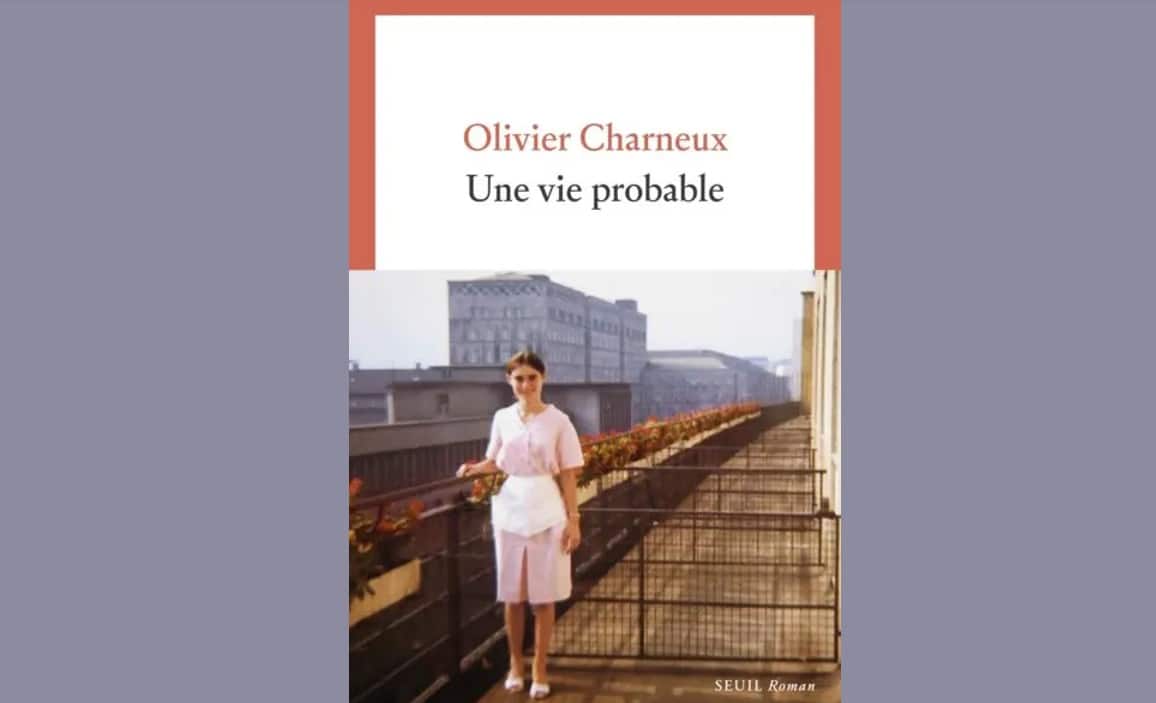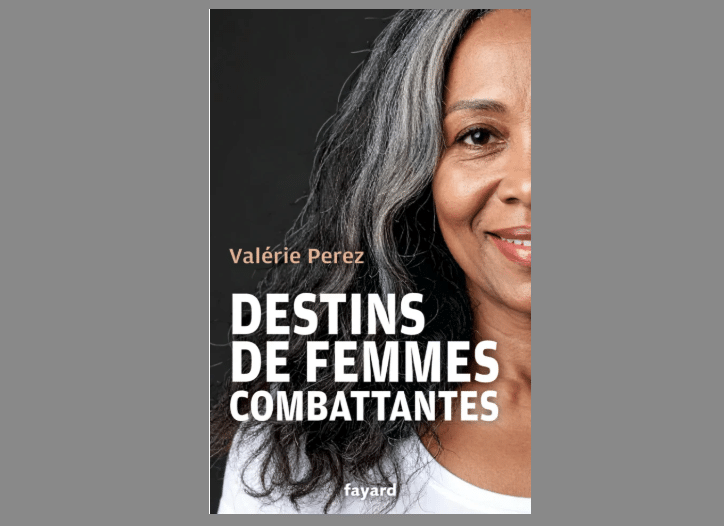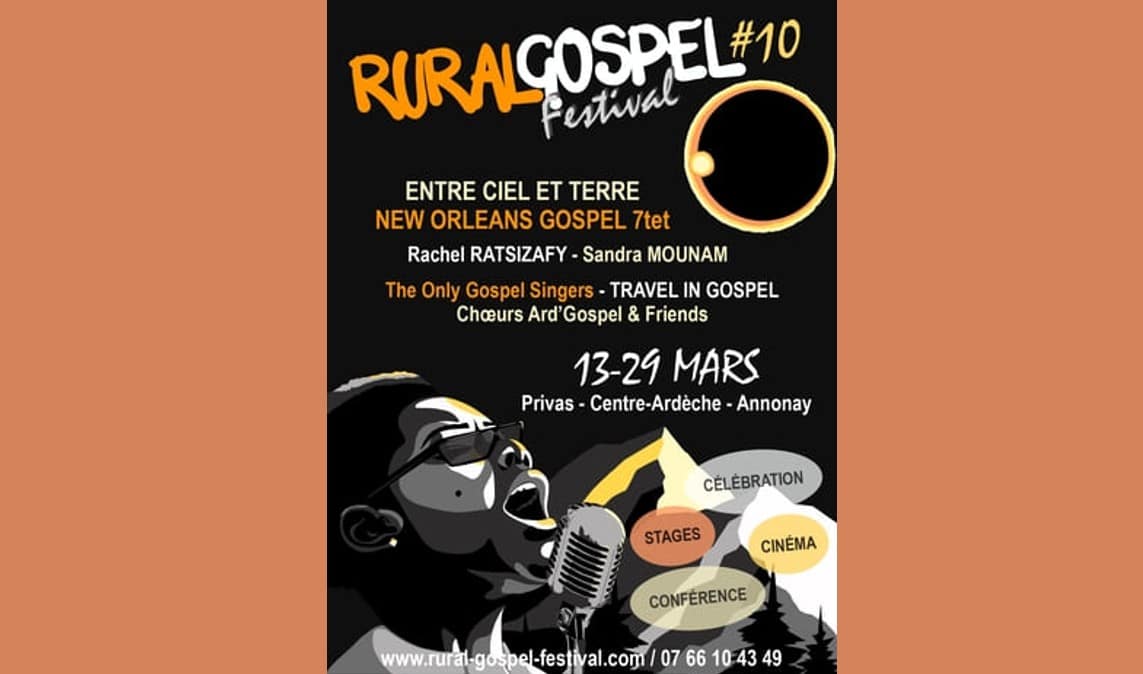Un adage latin s’applique bien aux Églises : corruptio optimi pessima (« la corruption du meilleur est la pire »). La foi, l’amour du prochain, la conversion au Christ relèvent du meilleur, mais quand ils se corrompent, ils ne donnent pas du « un peu moins bon », mais le pire. La foi relève de l’émerveillement de la découverte que notre vie est aimée. Elle n’est pas une bulle de hasard dans un océan de nécessité, mais elle est précédée du désir de Dieu. Comme le dit joliment le maître hassidique rabbi Nahman de Bratslav : « Le jour de ta naissance, c’est le jour où Dieu a décidé qu’il ne pouvait plus se passer de toi. » La foi est belle, mais quand elle se corrompt elle peut se transformer en orgueil, voire en intégrisme. Au nom de la foi, des horreurs ont été commises.
Quoi de plus beau que le commandement d’amour ? Saint Augustin a eu raison de définir l’éthique chrétienne en déclarant : « Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tu te tais par amour ; si tu cries, tu cries par amour. » L’amour est l’accomplissement de la loi, il résume la personne et l’enseignement du Christ, mais quand il se corrompt, il se transforme en manipulation. C’est au nom de l’amour que des abus sexuels ont lieu dans les familles et les Églises pour assouvir les désirs troubles de pervers.
Vigilance face aux dérives
La conversion au Christ définit la foi chrétienne. Dans le Nouveau Testament, on la trouve au cœur de la prédication de Jean le Baptiseur, de Jésus et de Pierre dans le discours de Pentecôte. La conversion est le changement de nos pensées, de nos paroles et de nos actions pour les ajuster à l’Évangile, mais le désir de conversion peut se corrompre en soumission quand il est manipulé par […]