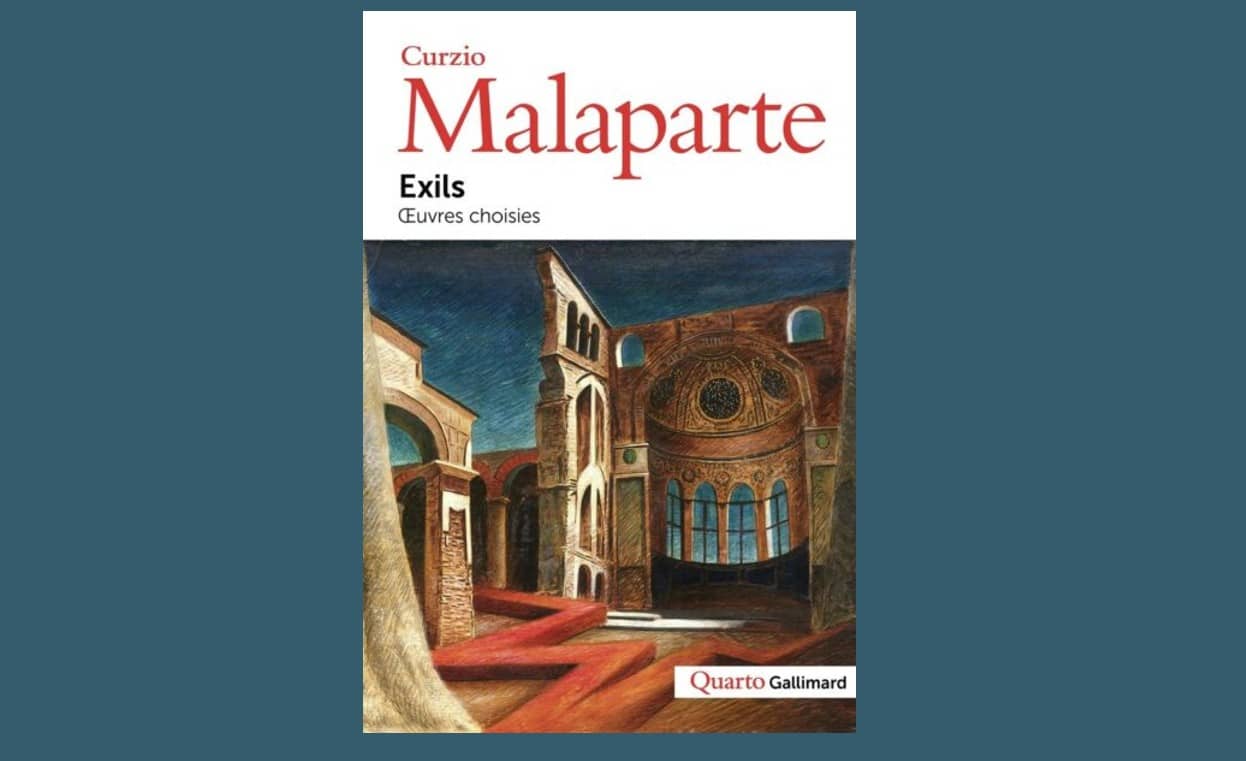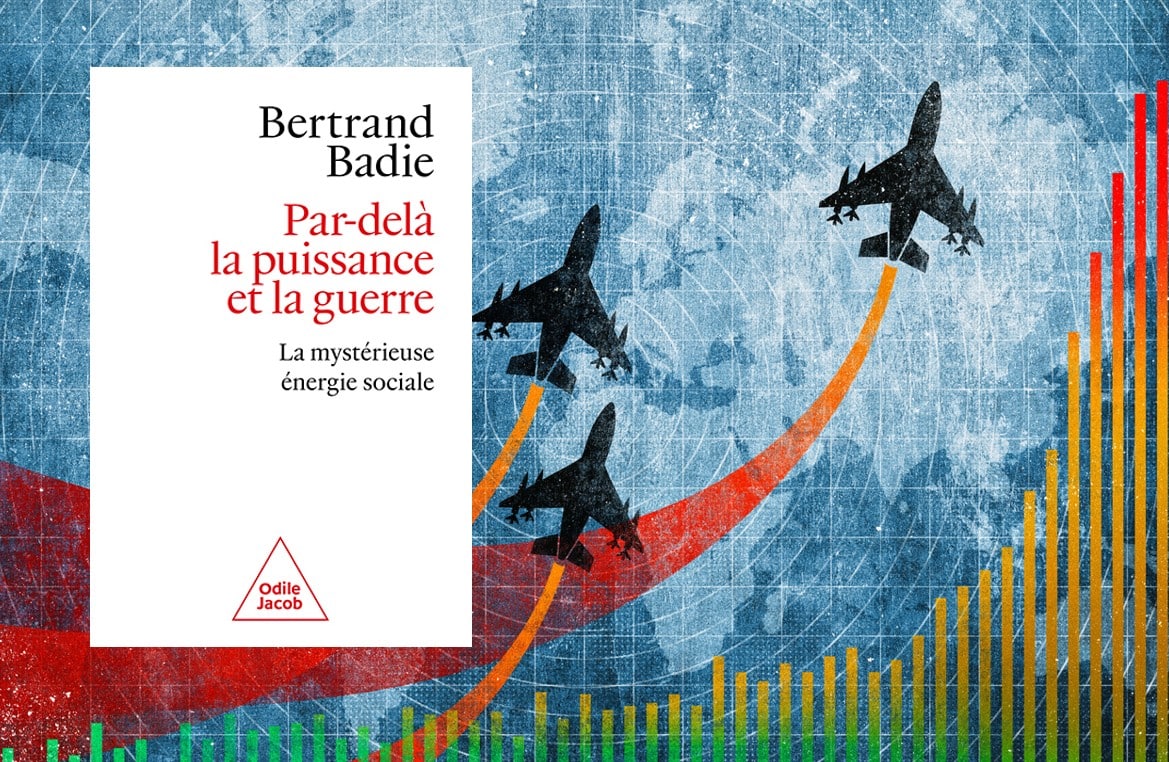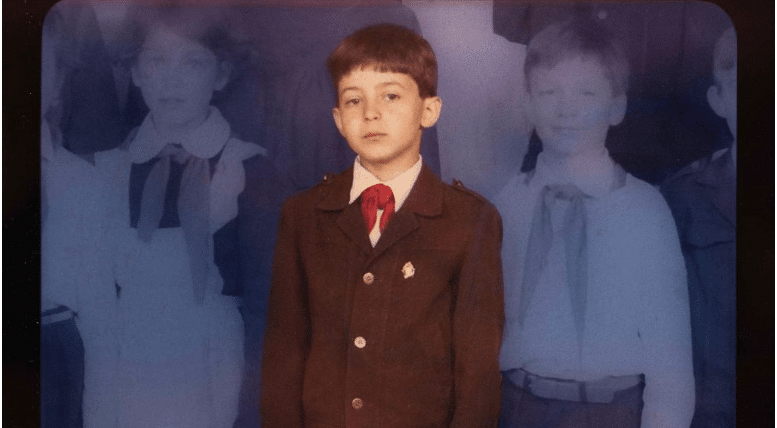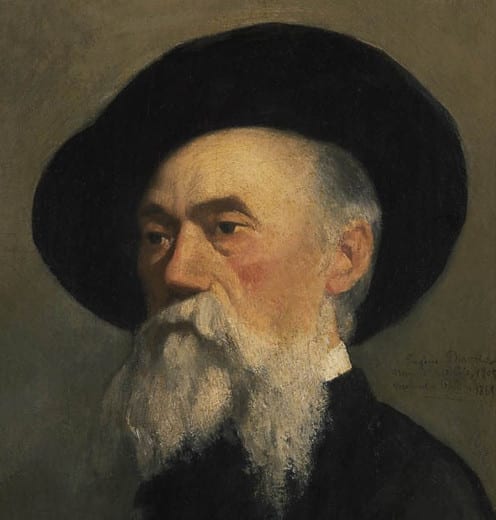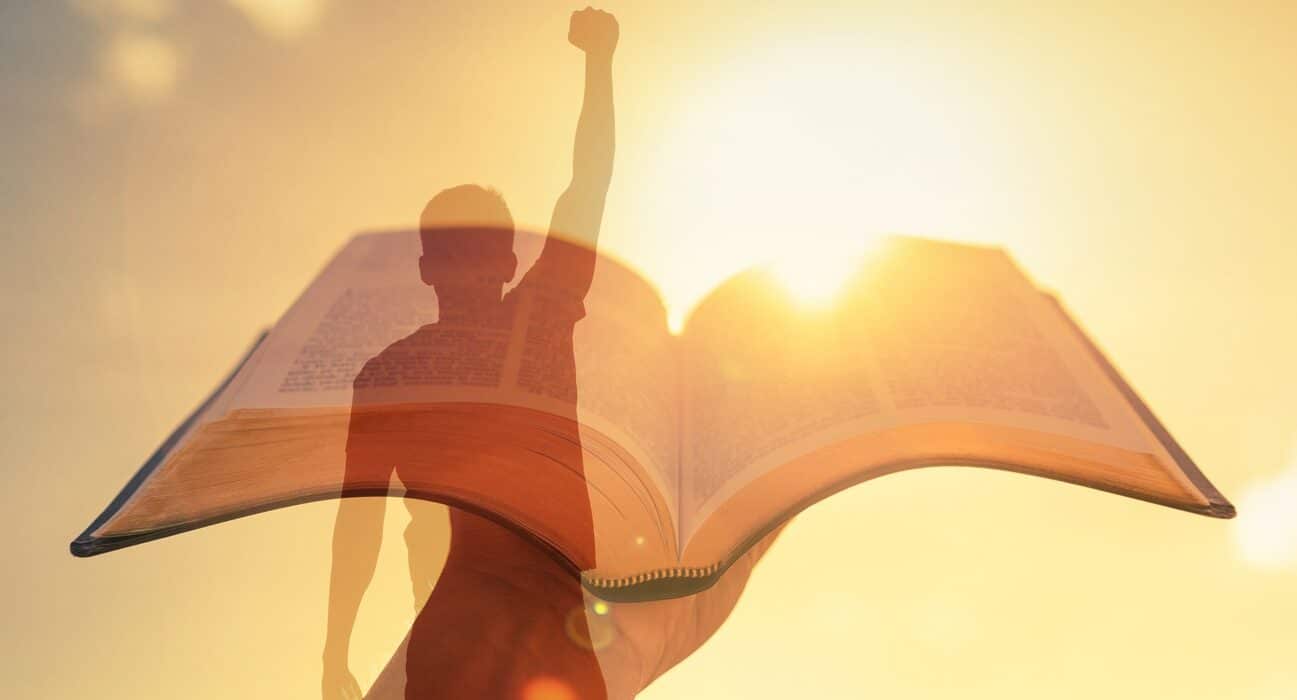L’État de droit est-il immanent, établi par le peuple (qui peut changer d’avis), comme l’avait proclamé en 1981 à la tribune de l’Assemblée le socialiste André Laignel s’adressant à la droite : « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires », et comme le pensent tous les populistes tenant d’une démocratie illibérale ? Ou est-il transcendant, comme le pensent les gens « raisonnables », qui ont lu Montesquieu, Arendt – pour qui il y a un lien entre dérive totalitaire et refus d’un donné transcendant –, et Rosanvallon – pour qui « la légitimité du droit tient au fait qu’il est une sorte de mémoire de la volonté générale » (Le Monde, 12/04/2025) – et qui sont convaincus de la nécessité surplombante sur nos destinées collectives de quelques principes anthropologiques universels et intangibles : la séparation des pouvoirs, l’égalité des citoyens devant la loi, la non rétroactivité des lois ?
Mais cette transcendance trouve sa première expression dans la tradition biblique, ce qui la rend difficile à expliquer et à revendiquer dans le monde sécularisé et laïc d’aujourd’hui où plus grand monde n’admet d’autres limites que celles que chacun se donne. Défendre l’État de droit, c’est en effet renoncer à une justification par nous-mêmes pour renouer avec un horizon qui nous dépasse. Observons que l’opinion est, à ce propos, à fronts renversés : les tenants d’un donné transcendant se recrutent plutôt chez les agnostiques, quand la réaction populiste draine un large courant chrétien…
Vincent Maunoury, médecin, pour « L’œil de Réforme »