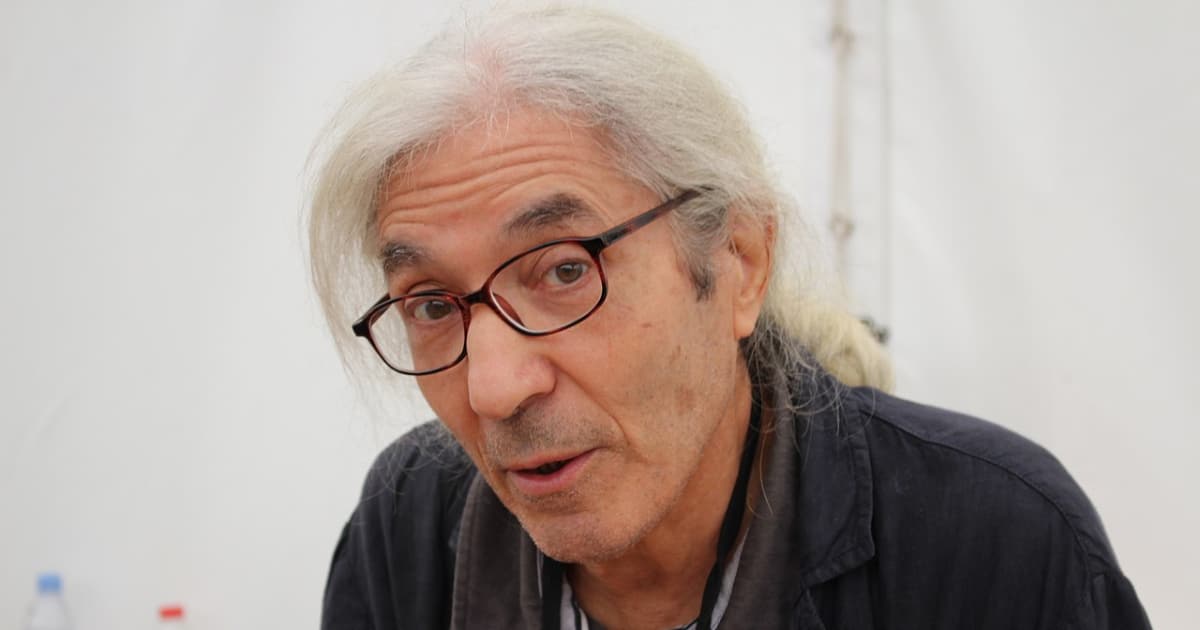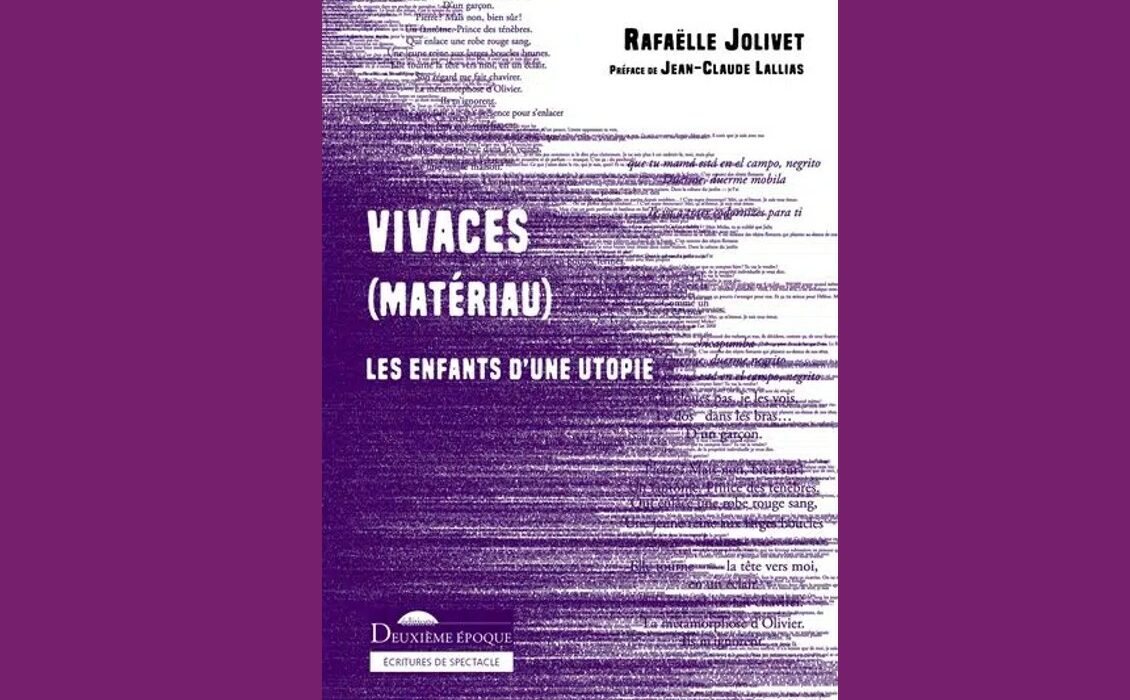Les propositions de loi sur les soins palliatifs et sur l’aide à mourir sont débattues depuis le lundi 12 mai à l’Assemblée nationale. Un vote solennel pour chacun des textes est prévu le 27 mai. François Bayrou a décidé de passer par deux textes, contre un seul en 2024, pour que les députés aient le choix de voter l’un des textes et pas l’autre. Avant ces débats sur la fin de vie, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a promis qu’ils resteraient « les plus respectueux possibles ». Les grandes lignes de ce projet de loi avaient été dévoilées en mars 2024, par Emmanuel Macron, mais l’examen du texte avait été interrompu par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024.
Une première proposition de loi prévoit la création d’un « droit opposable » à bénéficier de soins palliatifs. En juillet 2023, un rapport de la Cour des comptes soulignait que seule la moitié des besoins était pourvue, a rapporté Le Monde. La proposition de loi a pour but que chaque département dispose d’une unité de soins palliatifs. Le texte prévoit de redéfinir les soins palliatifs, mais aussi un droit de visite inconditionnel pour les patients recevant des soins Il veut aussi donner une base législative à la stratégie décennale des soins d’accompagnement. Le texte souhaite renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé et du secteur médico-social en matière de soins palliatifs et de fin de vie. Un projet de création de maisons d’accompagnement et de soins palliatifs est aussi mentionné par le site vie-publique.fr. Ces établissements seront des « unités de vie intermédiaires entre le domicile et l’hôpital », qui accueilleront et accompagneront les personnes en fin de vie et leur entourage. Les conditions de formulation des directives anticipées seront aussi améliorées.
Plusieurs lois sur la fin de vie depuis 1990
De son côté, le texte sur l’aide à mourir doit permettre aux malades souffrant d’une « affection grave et incurable », qui « engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale » et qui ne supportent plus leurs souffrances, de recevoir ou de s’administrer une substance létale. Le terme « aide à mourir » englobe ainsi l’euthanasie et le suicide assisté. Pour qu’un patient soit éligible, la proposition de loi établit cinq critères cumulatifs, a indiqué France 24. Il doit être âgé d’au moins 18 ans ; être Français ou résider en France ; être atteint d’une « affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale » ; cette dernière doit provoquer une « souffrance physique ou psychologique » réfractaire aux traitements ou insupportable ; et le patient doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Le texte prévoit que le médecin sollicité par le patient décide seul s’il est éligible, après avoir recueilli l’avis d’au moins un autre médecin et un autre soignant, dans un délai de 15 jours.
Depuis 1990, plusieurs lois sur les malades en fin de vie ont été adoptées. Celle du 31 juillet 1991 inscrit les soins palliatifs parmi les missions du service public hospitalier. L’accès aux soins palliatifs a ensuite été reconnu comme un droit garanti par la loi du 9 juin 1999. La première loi sur la fin de vie, la loi « Leonetti », date du 22 avril 2005 et pose l’interdiction de l’obstination déraisonnable. Elle permet à un patient de refuser un traitement et de bénéficier d’un accompagnement palliatif. Les équipes soignantes peuvent aussi mettre fin à un traitement chez un patient qui n’est plus en état d’exprimer sa volonté. La dernière loi, la loi « Claeys‑Leonetti » date du 2 février 2016. Les directives anticipées du patient ont désormais une valeur contraignante pour le médecin et ne sont plus soumises à une durée de validité. Elle permet aussi au patient de demander une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Cet accès est strictement encadré.
A lire aussi :
A écouter :