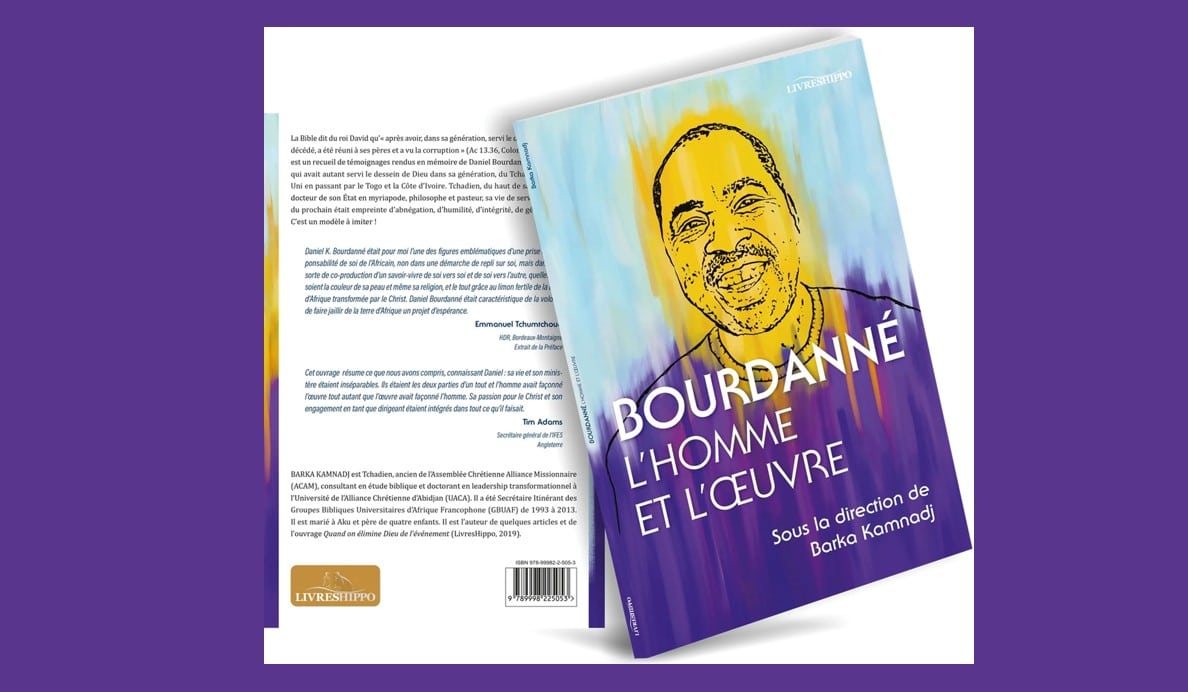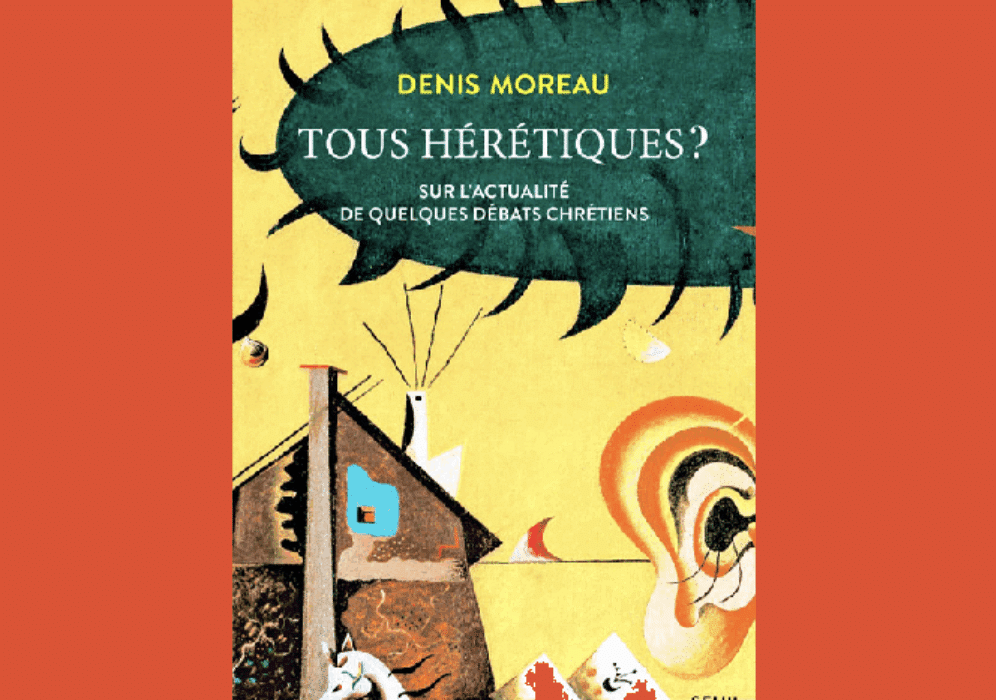« Mal nommer le monde, c’est rajouter au malheur du monde ». Ce mot fameux d’Albert Camus, Fatoumata Fathy Sidibé l’a rappelé à l’heure des conclusions du colloque organisé à Bruxelles par la Faculté Universitaire de Théologie Protestante (FUTP) et le nouveau centre de recherche CARES (1). L’affirmation a un corollaire : bien « nommer sa condition » – titre du colloque-, c’est un chemin vers un monde plus harmonieux.
Au fil des deux jours du colloque de Bruxelles (19-20 octobre 2022), c’est peu de dire que l’exercice s’est révélé une très grande réussite. Un colloque d’exception comme il y en a un tous les dix ans. Inoubliable et fondateur.
« Nommer sa condition » du point de vue de la situation féminine afropéenne impliquait trois prérequis : que les intéressées puissent prendre la parole. Elles l’ont fait, avec brio, compétence et conviction. Qu’un cadre conceptuel soit proposé à l’analyse, ce qui a été mis en place, avec des mots justes, par l’écrivaine Léonora Miano lors de la première matinée du colloque. Et qu’une pluralité disciplinaire (et de points de vue) soit mise en dialogue, pour éviter les enfermements.
Tous ces défis ont été relevés, avec en prime, une convivialité réjouissante, une cérémonie de prestige (doctorat Honoris Causa remis à Léonora Miano et Denis Mukwege), des locaux magnifiques (hôtel de ville de Bruxelles et centre Senghor à Etterbeek). Et de la bonne musique en prime avec les Africana Sessions, le mercredi 19 octobre au soir.
Définir l’afropéanité
On ne saurait ici résumer la richesse exceptionnelle des contenus présentés. Il faudra, pour cela, un écrin adapté, à savoir le beau livre dont on attend avec impatience la publication. Retenons l’essentiel, porteur d’enjeux majeurs pour l’avenir des protestantismes en Europe, et, au-delà, des christianismes et des cultures partagées. Présenté comme récent, discuté, disputé, le concept d’afropéanité s’est globalement imposé au fil des réflexions partagées. Lors du démarrage du colloque dans le salon gothique de l’hôtel de ville de Bruxelles, c’est à l’écrivaine Léonora Miano qu’il revient la maternité de la notion.
« Afropéanité » désigne une culture et une condition marquée à la fois par l’héritage africain et l’expérience sociale et citoyenne en Europe. Comme l’a rappelé Ali Benmakhlouf lors des conclusions du colloque, le mot est sans tiret. D’un seul tenant. En effet, les mots-valises à tirets ont souvent ce désavantage que le second terme a tendance à manger le premier. Les juifs ne sont pas toujours rassurés, par exemple, lorsque les chrétiens brandissent à temps et contre-temps les supposées « valeurs judéo-chrétiennes » ! Ici, avec le terme d’afropéanité, qui se décline au féminin (afropéenne) et au masculin (afropéen), les deux sources sont indissociables. Aucune n’englobe l’autre. Ce concept en devenir n’est pas enfermant : actrices et acteurs peuvent ou non se l’approprier, et surtout, il cohabite avec d’autres formes identitaires aux prises avec l’africanité.
L’afropéanité, objet de ce colloque, coexiste avec afro antillais, afro-américain, afro-asiatique... Au-dessus de ces diverses expériences identitaires, Léonora Miano propose une notion faîtière qui les rassemble. Elle est désignée par le terme « Africana ». Afropéa est une des filles d’Africana.
Via de multiples postes d’observation (associations, science-fiction, univers des influenceuses, roman, théologie) et disciplines des sciences humaines (sociologie, histoire, socio-anthropologie, philosophie, sciences de l’éducation…), le mot d’afropéanité a peu à peu pris de la substance au fil du colloque.
Le plus souvent, les unes et les autres se le sont appropriés. Les espaces et territoires circulatoires créoles, bien qu’aux prises aussi avec l’Amérique, ne sont pas étrangers à la mise en récit afropéenne, comme l’a souligné notamment la linguiste Darline Cothière, directrice à Paris de la Maison des journalistes. Jusqu’à Rebecca Monga, à l’heure de la remise du doctorat Honoris Causa à Léonora Miano et Denis Mukwege. Avec une aisance rhétorique impressionnante, elle a revendiqué l’identité afropéenne comme une « victoire ».

Afropéenne. Afropéen. Un mot qui nomme bien. A rebours des assignations identitaires et des injonctions à une « assimilation » qui violentent les identités et les parcours, le mot afropéen reflète l’expérience partagée par beaucoup d’afro-descendants établis en Europe. Certes pas pour toutes, pas pour tous. Mais ce n’est pas grave ! La pluralité des termes – dont les milieux protestants ont l’habitude – vaut mieux que le carcan taille unique.
Femmes « silencées » et « misogynoir »
Autour de la notion principale d’afropéanité traitée au cours du colloque de Bruxelles, d’autres termes se sont invités, au gré des exposés. Parmi ces notions, celle de « femme silencée » est souvent revenue. Par ce néologisme, venu d’un anglicisme, on entend décrire la femme assignée au silence, enjointe à écouter d’autres parler pour elle et sur elle. Scène encore trop familière des agoras européennes… Autre notion marquante, présentée par la sociologue Carmen Diop, c’est celle de « misogynoir ». Un mot qui fait se rejoindre la misogynie, dont toutes les femmes peuvent parfois souffrir, et le racisme contre les noires, qui rajoute un élément de stigmatisation supplémentaire.
L’occasion de souligner l’intérêt heuristique de l’approche dite intersectionnelle, objet d’une table ronde le jeudi 20 octobre au matin. Au lieu de cloisonner les approches, l’idée est d’étudier les discriminations multiples dont peuvent faire l’objet certaines personnes du fait de leur origine, de leur genre, de leur statut social, de leur phénotype (couleur de peau), de leur religion ou de leur sexualité. Ce cumul de discriminations doit être entendu, compris, enregistré dans sa factualité. Au-delà des bruits parasites des discours de délégitimation du « wokisme » (sic), qui cherchent à réduire la question des discriminations à de l’idéologie, il y a les faits. De nombreuses enquêtes sérieuses, dont plusieurs ont été citées lors du colloque (dossier des livres de jeunesse, étudié par Yvette Umuhire), rappellent implacablement que oui, être femme et noire, aujourd’hui en Europe, c’est s’exposer aux microagressions, au paternalisme, aux stéréotypes.
Le dire n’est pas se victimiser, ni proférer un jugement généralisant. Le rappeler, c’est mettre des mots sur des faits, contribuer à la fin à l’impunité, et amorcer une réflexion collective qui permet d’avancer. Y compris auprès des enseignants et des élèves, comme l’a souligné Francine Nyambek-Mebenga, maîtresse de conférence en sciences de l’éducation à l’Université Paris-Est Créteil (2).
Matrimoine afropéen
Sortir du silence. Dans ce processus, le colloque FUTP, pionnier à bien des égards, marque une étape décisive, soulignant au passage que « le patrimoine » (afropéen) « est en fait largement un matrimoine », comme l’affirma le professeur Bernard Coyault, doyen de la Faculté et artisan du nouveau laboratoire CARES.
Des propos qui font écho au travail de mémoire et d’histoire réalisé pour faire sortir de l’oubli la « gynéaologie » afropéenne. Par ce néologisme, présenté magistralement par Léonora Miano dans son intervention du mercredi 19 octobre au matin, on entend décrire cette transmission, de femme afropéenne à femme afropéenne, d’une histoire longtemps confisquée. Emblématique de cette gynéaologie en construction, sœur Louise Marie de Sainte Thérèse (1658-1730), femme noire et religieuse du XVIIe siècle, qui se définissait elle-même comme « fille de France ». Or l’expression impliquait un sang royal. Était-elle fille illégitime du roi Louis XIV ? Peut-être… L’affaire est débattue. Son portrait et sa légende, en tout cas, ont traversé les siècles. Et ce qui est sûr, c’est que Louise Marie, femme et noire, se reconnaissait haut et fort comme « fille de France ». Plus de 400 ans avant ce colloque sur l’afropéanité qui a ravivé sa mémoire. Merci à Léonora Miano pour cette évocation.
De religion, il a aussi été beaucoup question lors du colloque. D’abord, parce qu’elle participe des phénomènes de construction identitaire, mais aussi de solidarité. Ensuite, parce que la théologie est un objet d’étude central pour la force organisatrice, la FUTP de Bruxelles. Islam, catholicisme, protestantismes ont été abordés, à la fois comme lieux de ressource mais aussi espaces de valeurs à questionner. En revendiquant le droit à “l’autodétermination dans la sphère religieuse”, Kirafiky Mbog a ainsi rappelé, jeudi 20 octobre après-midi, que la pression sociale ne vient pas toujours de l’extérieur. Elle peut venir aussi du milieu familial et religieux auquel on appartient, plaidant pour l’espace nécessaire afin de « naviguer les doutes ».
En matière de protestantismes, toute une gamme de positionnements s’est exprimée, entre mobilisation du référentiel biblique comme socle éthique de l’action, et scénario de sortie de la religion. La perspective postcoloniale et décoloniale n’a pas été oubliée, notamment au travers de la figure puissante de Marie Muilu (1880-1959), garante de la pérennisation de l’Eglise kimbanguiste, dont Christel Zogning Meli nous a brossé un portrait remarquable. Plus globalement, c’est toute la question du sens et de la dynamique narrative où s’inscrivent les vies qui s’est trouvée mise en avant. Avec ces interpellations fortes de Jeanine Mukaminega, professeure d’Ancien Testament CARES-FUTP Bruxelles (3) : « Pour construire, il faut sortir de la cage » des représentations imposées… Et: « est-ce qu’on doit transmettre ou accompagner la naissance de quelque chose d’autre ? »
(1) Centre d’Études Afro-européennes et des Sciences des Religions de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles (FUTP); site : ;
(2) Francine Nyambek-Mebenga, « Construction du sens de la laïcité dans des contextes multiculturels: poids des choix pédagogiques et d’expériences socio-scolaires», Revue des sciences de l’éducation, vol. 42, n°1, 122-146
(3) Jeanine Mukaminega, notamment autrice de Lettre aux immigrés de tous les temps -Réouverture de la « lettre aux exilés » du prophète Jérémie, Paris, L’Harmattan, 2012