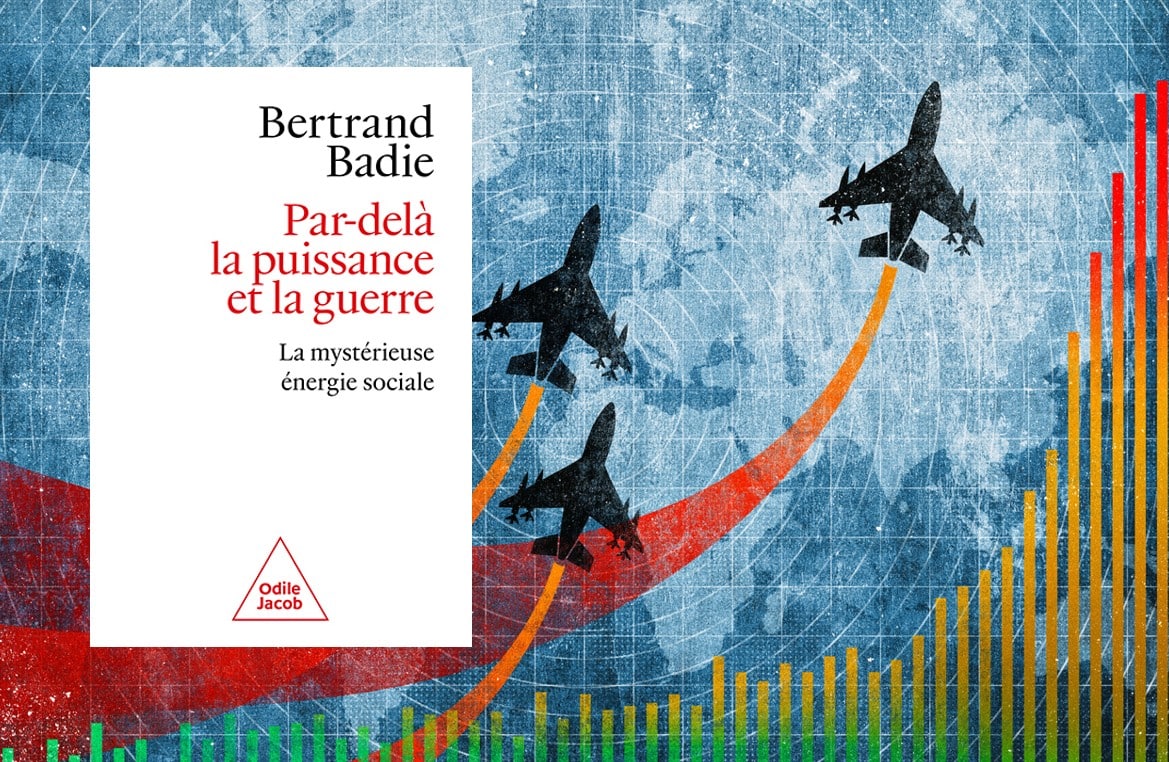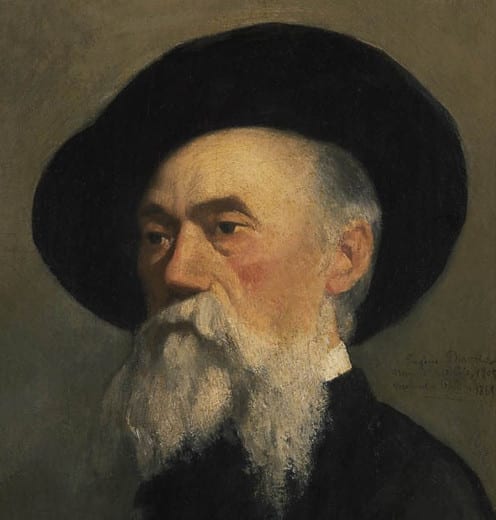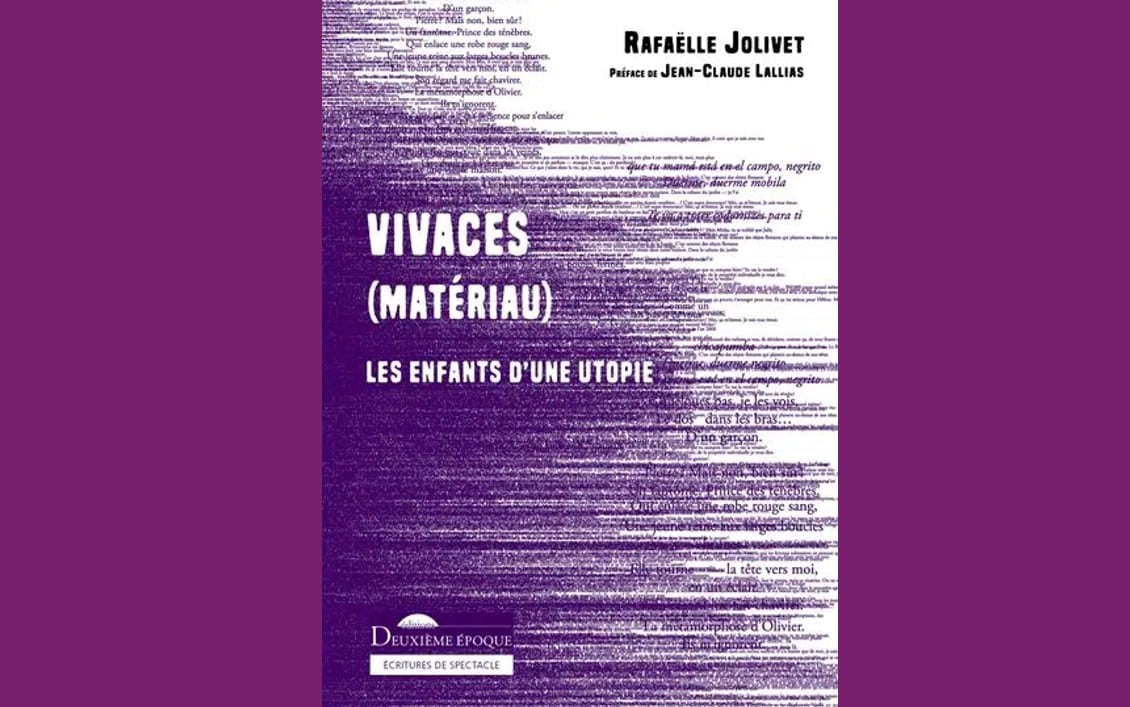« Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » (A.Camus). Aujourd’hui, l’usage de certains mots connaît une dérive car on cherche une plus grande charge émotionnelle, quitte à semer la confusion : parodiant Boileau, disons que ce qui s’énonce confusément ne peut plus se concevoir clairement. Le mot « génocide » connaît une inflation d’usage, particulièrement dans le cas du conflit israélo-palestinien à Gaza.
L’histoire nous rappelle que cinq génocides – mot créé par le juriste Raphaël Lemkin en 1943 – ont été perpétrés au XXe siècle. Contre les Hereros et les Namas en 1904 (80% et 50% de leurs populations respectives ont été exterminées), contre les Arméniens en 1915-23 (1,3 million de victimes), contre les juifs et les Roms en 1939-45 (6 millions), contre les Cambodgiens en 1975-79 (1,7 million) et contre les Tutsis rwandais en 1994 (800 000 victimes en trois mois). Ces chiffres doivent nous rendre à jamais prudents dans l’usage de ce mot.
Tsahal a tué plus de 50 000 Palestiniens en dix-huit mois, dont une majorité de civils : ce sont des crimes de guerre dont devra répondre le gouvernement israélien. Mais le nombre des victimes est comparable aux opérations de la Seconde Guerre mondiale. Qualifierait-on de génocides les bombardements alliés de Dresde ou d’Hiroshima en 1945 qui en firent chacun autant ou plus en un jour ?
Le choix intentionnel du mot « génocide » ouvre la voie à une trouble remise en cause de l’existence de l’État d’Israël, perçu par des générations peu informées comme une entité négative, une erreur de l’histoire, invisibilisant ainsi l’antisémitisme qui l’a fait naître. L’usage émotionnel du mot « génocide » victimise le peuple palestinien, certes. Mais aide-t-il à concevoir une paix juste et durable entre ces deux peuples ? J’en doute.
Jean Loignon, professeur d’histoire-géographie, pour « L’œil de Réforme »