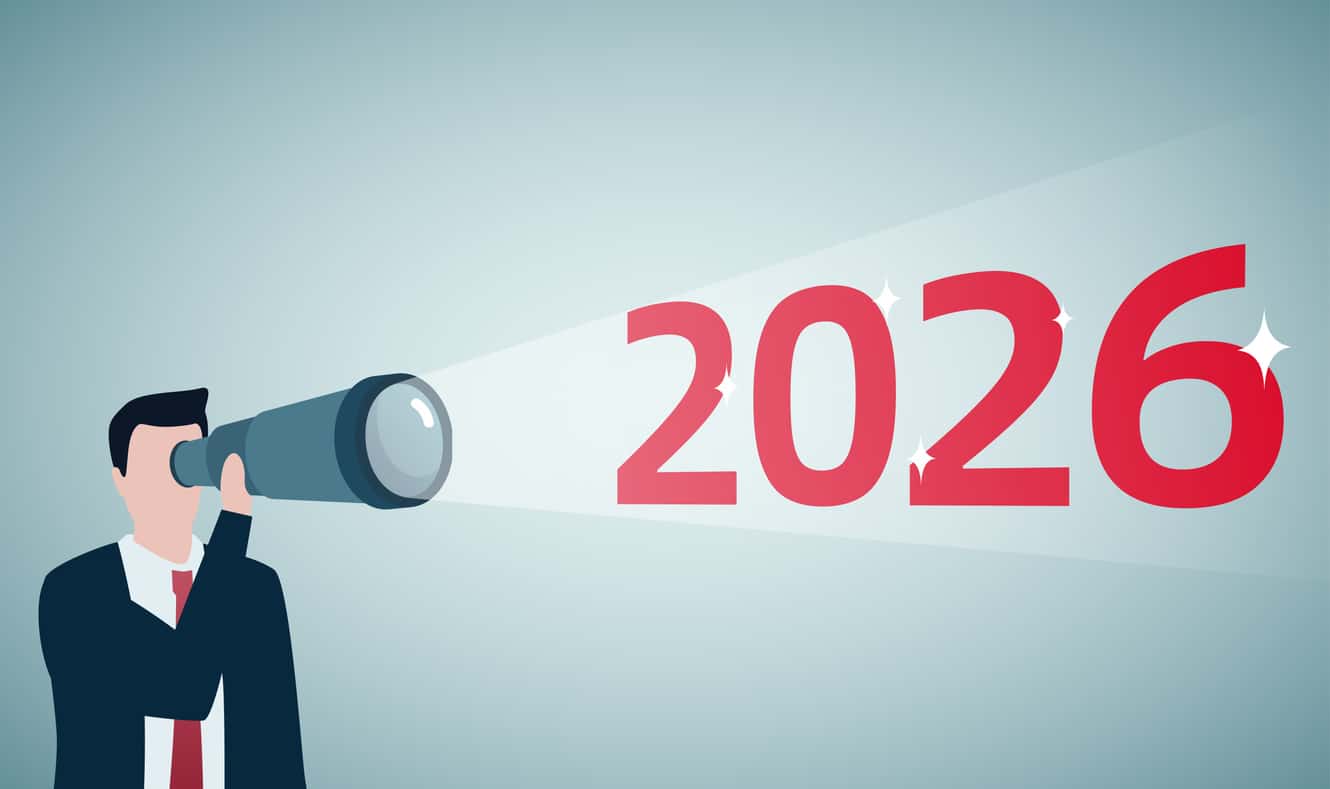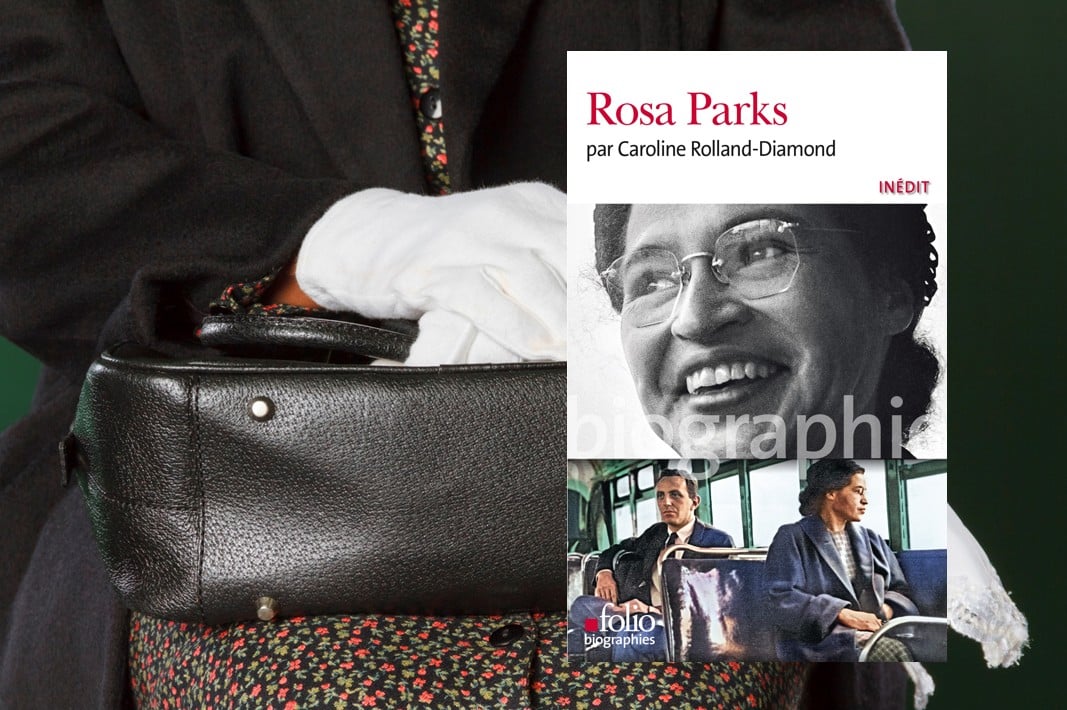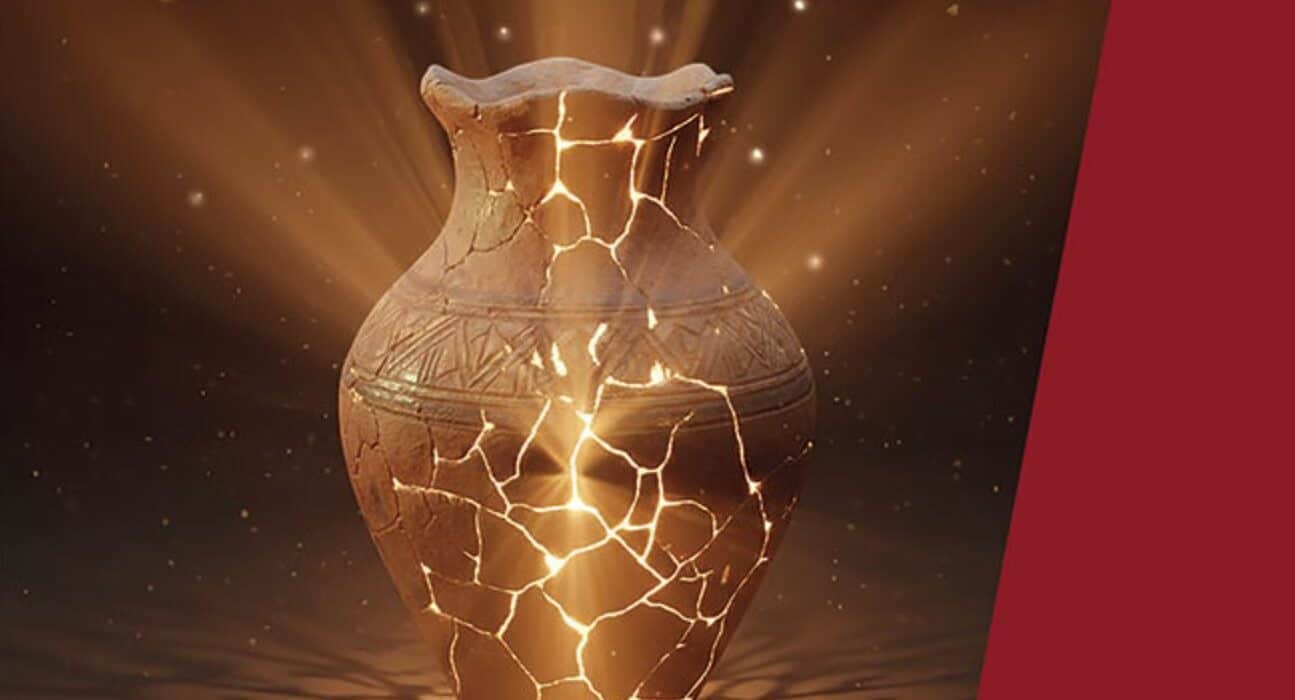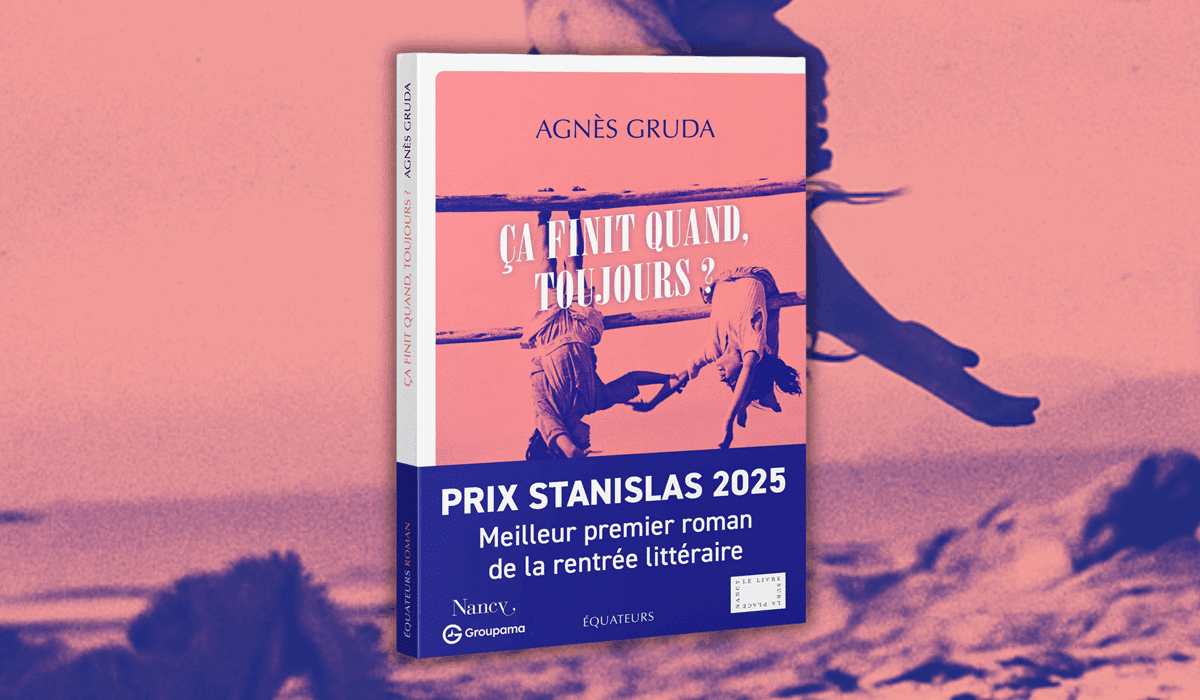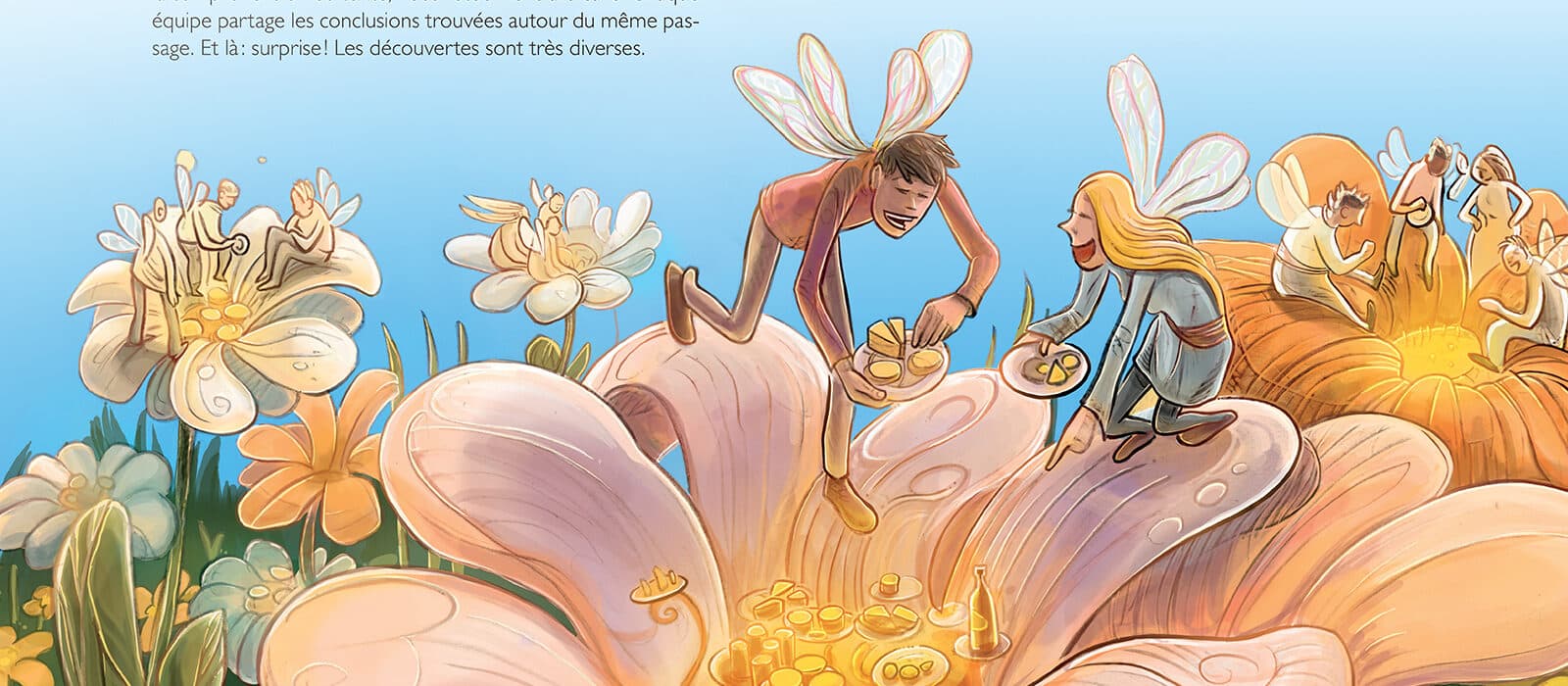Regardez la Chine. Essayez de la voir, au moins, telle qu’elle est. Non pas sous l’angle du kitch – au concert comme au cirque, des jongleurs et des écuyères en or – ou de l’armée – les missiles autrefois portaient des noms de flambeaux rouges – mais sous l’angle immémorial d’un Empire. Un pays que l’on ne connait pas, que l’on comprend mal, ou si peu. Romain Graziani, professeur en études chinoises à l’École normale supérieure de Lyon, publie ce printemps : « Les Lois et les nombres. Essai sur les ressorts de la culture politique chinoise » (Gallimard, 512 p., 24 €). Une merveille d’ouvrage, une analyse complexe et cependant limpide, une quadrature du cercle. Cet homme de science a bien voulu répondre à quelques questions pour Regards protestants.

Depuis toujours, en Chine, l’État constitue l’organisation centrale à partir de laquelle s’organise le politique. « Dès la plus haute antiquité, les penseurs de ce pays ont estimé qu’il fallait suivre une méthode claire et indiscutable pour rendre l’État puissant sur le plan militaire et prospère sur le plan économique, fût-ce au détriment de sa population, explique Romain Graziani. Dans un souci d’efficacité et dans un contexte de guerre généralisée, ils ont imposé le paradigme de la mesure, de la quantification du réel ainsi que la prédominance des normes numériques, à leurs yeux les outils les plus efficaces pour contrer les sources d’érosion de l’autorité souveraine, empêcher des décisions discrétionnaires de la justice, contrer les inspirations personnelles des dirigeants lorsqu’elles sont dictées non par des données objectives mais seulement par leur humeur du moment ou encore lorsqu’elles sont soufflées par des conseillers cupides et corrompus. »
Le paradigme des nombres
Cette conception du politique a d’emblée tendu à un certain « objectivisme », un mot qui peut paraître anachronique pour une époque aussi reculée, mais qui traduit bien la pensée des théoriciens de la domination absolue, que l’on appelle Légistes. « Ils ont voulu se soustraire à toute personnalisation du pouvoir, atteindre une forme d’impartialité et d’uniformisation, souligne Romain Graziani. Non seulement dans le domaine de la monnaie, de l’écriture ou du découpage du territoire, mais aussi dans les décisions de justice, avec la minutieuse tarification pénale des crimes et des délits. Les nombres, les mesures et les données quantitatives doivent s’appliquer à l’intégralité des phénomènes sociaux : performance au travail, que ce soit dans les champs de bataille ou de labour, dans les ateliers ou les fermes, avec une légion d’inspecteurs, de sergents, de censeurs. » On peine à le croire, mais il faut imaginer ce que cela signifie : le temps de trajet des fonctionnaires en mission était chronométré, tout comme les quotas de production avec les récoltes effectivement livrées. « Cette volonté d’objectivation permit à certains royaumes chinois de l’antiquité de lutter contre l’emprise de la subjectivité individuelle dans la sphère de la gouvernance et de la production sociale, nous rappelle encore Romain Graziani : le charisme du souverain n’était plus requis, les qualités morales des serviteurs de l’État n’étaient plus indispensables, des mécanismes et des montages impersonnels devaient assurer le fonctionnement du système indépendamment de la personnalité des gens en place. »
Avec le confucianisme, la vertu et les talents devaient primer, avec la doctrine légiste, la technocratie devait avoir le dernier mot. Les lois et les procédures, les normes et les nombres, les dispositifs de surveillance et de sécurité devaient permettre à l’État de fonctionner tout seul, comme en pilotage automatique.
L’unité absolue du pouvoir : des lois plutôt que des droits
On est très loin, chacun le constate, de la conception occidentale du politique, telle qu’elle est apparue en Grèce ancienne ou dans la Rome antique. Alors que nous estimons que l’organisation collective doit faire l’objet d’une délibération publique, qu’elle fait naître l’esprit civique, et bien sûr encourage le peuple à participer à un débat général, on ne trouve rien de tel en Chine. « La place de l’individu n’a rien à voir avec celle qui domine dans le monde occidental, observe Romain Graziani. Les gens du peuple sont des sujets, au sens premier de celui qui est mis en sujétion ; toute activité, qu’elle soit commerciale, artistique, intellectuelle ou artisanale, doit s’inscrire dans une logique aussi lucrative que productive, pour le seul intérêt de l’État. Dans ces conditions, il n’y a en Chine que des lois, car l’idée même que des droits puissent leur être associés, comme une contrepartie, demeure inconcevable : ce serait aller là contre le culte de l’unité absolue du pouvoir. »
Un système encore aujourd’hui basé sur la mesure et la quantité
La pérennité d’un tel modèle n’est pas tout à fait naturelle. Notre interlocuteur admet que les dirigeants chinois d’aujourd’hui font un usage immodéré, averti et sagace, des grandes références du passé, des grandes figures de l’Histoire, afin de remplir le vide laissé par la doctrine marxiste qui est en voie de déréliction. « Mais cet imaginaire est aujourd’hui largement partagé, souligne Romain Graziani. Le système rencontre une adhésion massive, et les réserves ne sont pas de nature à renverser le régime. Je vois mal aujourd’hui quelles forces serait en mesure d’y parvenir. L’armée, l’armature institutionnelle, l’administration sont si puissantes, l’adhésion populaire est si forte malgré les crises que je n’imagine pas que la situation change avant plusieurs décennies. L’État chinois tient les rênes du pays de plus en plus fermement, et s’il a stimulé la consommation et la libre entreprise, il n’a pas lâché prise, bien au contraire. Il agit toujours en s’appuyant sur la mesure et la quantité, bref sur le paradigme objectif des nombres, avec une surveillance généralisée qui a été formulée dans ses principes dès l’antiquité (automaticité des procédures, généralisation de l’espionnage, etc.) »
Longtemps, les Occidentaux ont pensé que l’ouverture du marché chinois allait faire naître, comme par enchantement, par mimétisme ou par émulation, le désir des Chinois de vivre en démocratie. Force est de constater que cette approche était une illusion.
« Ce discours, presque unanimement admis et relayé dans les cercles politiques, les milieux d’affaires et les institutions internationales était un leurre qui aujourd’hui confine à la mauvaise farce, estime Romain Graziani. La Chine reste ferme sur ses principes et fidèles à ses traditions politiques en dépit de mutations spectaculaires. »
Une méconnaissance profonde de ce qu’est la Chine explique notre aveuglement. « Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, mais ce n’est pas un cas isolé, considère encore le chinois comme une langue rare, alors même que les Chinois représentent un cinquième de l’humanité, déplore encore notre interlocuteur. La pensée et plus largement la civilisation chinoise sont encore bien trop largement absentes du paysage intellectuel en Europe. Elles n’intéressent qu’à la marge (à titre d’exemple, pas une faculté d’histoire en France ne recruterait un sinologue : tous les spécialistes de la Chine à l’université sont confinés dans des départements de langues et cultures de l’Asie orientale). On s’étonne de certains progrès fulgurants venant de Chine, en particulier concernant l’IA, sans apercevoir la longue tradition « numérique » qui la préparait depuis longtemps à l’intégrer au cœur de la société. Sans faire le lien entre la tradition juridique chinoise et l’invasion du numérique dans la vie courante là-bas. » Cet aveuglement prépare mal notre pays, mais encore l’ensemble du bloc occidental, à faire face aux menaces du monde de demain. Romain Graziani nous aura prévenus.
A lire : « Les lois et les nombres, essai sur les ressorts de la culture politique chinoise », Gallimard, 512 p. 24 €