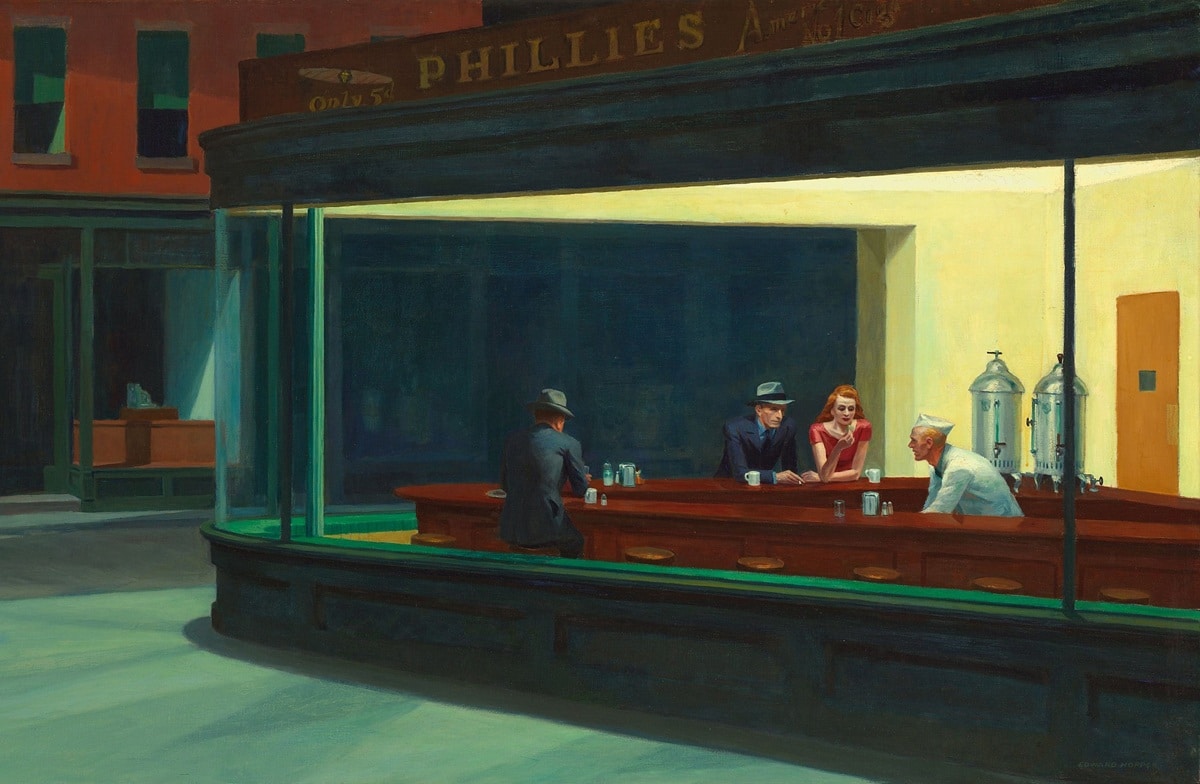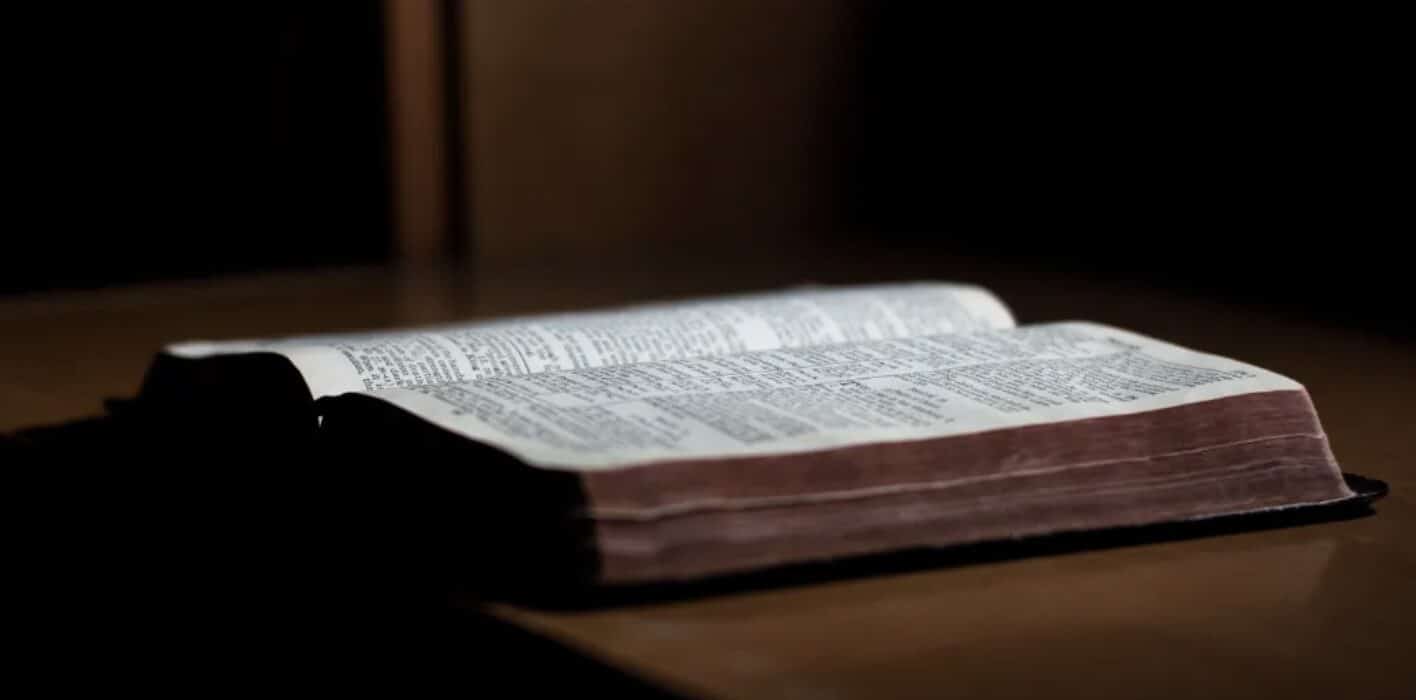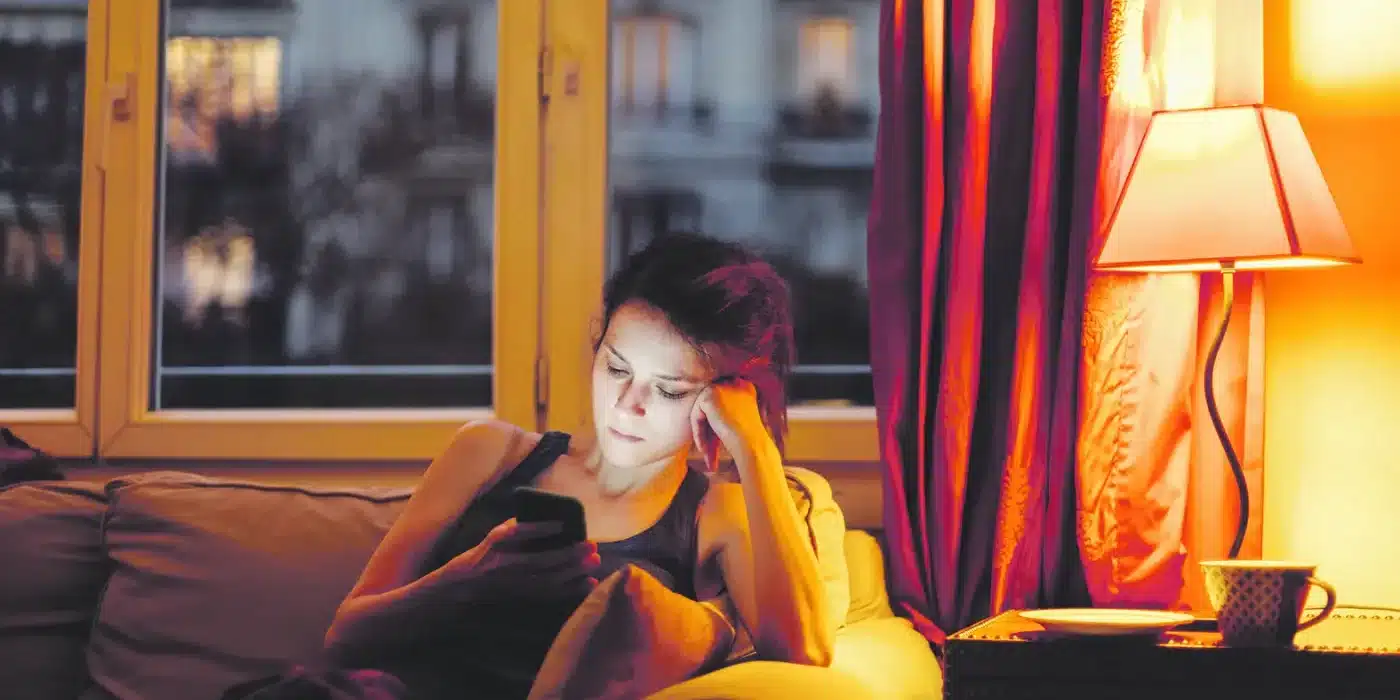Je suis sidéré par ce que des personnes, par milliers, voire par millions, acceptent de croire sans l’ombre d’une preuve : des caricatures grossières, des affirmations délirantes, de la propagande basique et sans subtilité, etc. Cela semble sans limite.
À vrai dire, la psychologie sociale a étudié depuis longtemps la manière dont tout un chacun, dans la vie quotidienne, décide de croire quelque chose sans trop approfondir. C’est absolument nécessaire, sans quoi toute notre vie s’épuiserait en vérifications envahissantes et paralysantes. C’est ce qu’on appelle des « heuristiques » spontanées : quelque chose qui nous paraît suffisamment vraisemblable, à un moment donné, pour que nous allions de l’avant.
Et c’est ainsi que l’on s’est rendu compte que, si quelqu’un parle avec suffisamment d’aplomb, beaucoup de ceux qui l’écoutent sont prêts à le croire. Il suscitera beaucoup plus d’adhésion et de confiance que quelqu’un qui laisse les choses ouvertes, travaille dans la nuance et ne se prononce qu’avec prudence.
C’est vrai dans une multitude de situations[1]. Dans un entretien d’embauche, par exemple (l’expérience a été faite), l’aplomb fait meilleure impression que la modestie. Cette réalité, maintes fois confirmée par l’expérience, est assez déstabilisante pour moi, car je me rends compte que, de ce point de vue, je suis atypique. Quelqu’un qui affirme les choses de manière péremptoire et sans nuances me met sur la défensive. Et j’ai plus de goût pour les questions à explorer que pour les réponses hâtives.
Qu’est-ce qui suscite la confiance ou la méfiance ?
A vrai dire, les ressorts de cette confiance aveugle ne sont pas vraiment démêlés. Ils ne se ramènent pas, en tout cas, à des hiérarchies sociales (les expériences menées le prouvent).
On sait bien, en général, que les personnes accordent plus de confiance à ce dont elles sont déjà convaincues. Mais, là, il s’agit d’autre chose : elles acceptent de croire quelqu’un, simplement parce qu’il a l’air sûr de lui. Même un robot d’intelligence artificielle qui sort un discours bien construit et sans failles n’éveille pas souvent le soupçon. Cela a, semble-t-il, quelque chose de rassurant de suivre un orateur qui a l’air de savoir où il va. L’actualité nous en donne de nombreux exemples un peu partout dans le monde : les leaders populistes ou autoritaires ne tiennent pas seulement par la menace et le rapport de force. Jusqu’à un certain point, ils inspirent confiance. Un slogan répété finit par être cru. C’est ni plus ni moins que du « bourrage de crâne » : c’est simple et basique, mais, manifestement, terriblement efficace !
Ceux qui ont une formation scientifique sont mal armés, dans ces contextes-là, car ils ont l’habitude de s’adresser à des auditoires méfiants qu’il faut convaincre à coups d’arguments. Les auditoires ordinaires n’ont, souvent, pas envie de les suivre sur ce terrain.
La foi non plus ne se démontre pas, mais elle laisse un espace de liberté à l’auditeur
Par comparaison qu’en est-il de la foi ? Elle n’est pas de l’ordre de la démonstration, elle non plus. Elle repose sur un élan qui peut se manipuler. Mais ce qui est frappant, quand on lit les évangiles, c’est de voir que le public était partagé. Les uns accordaient leur foi à Jésus, tandis que les autres étaient sceptiques.
Déjà, on peut noter que l’enjeu est différent : il ne s’agit pas simplement de croire telle ou telle affirmation. Celui qui croit entame un chemin de vie qui l’engage et qui donne un sens particulier à son existence. Forcément cela suscite plus de questions.
Mais je pense aussi que l’attitude de Jésus fait une différence. Certes, il est assuré dans ses affirmations et, à l’occasion, il ne mâche pas ses mots. Mais il ne fait pas non plus pression sur ses auditeurs. Il leur laisse un espace de liberté. Il entend les laisser se mettre en route. De la sorte, cela construit une adhésion qui procède par allers et retours, par approfondissements successifs.
Et aujourd’hui encore, l’évangile, si nous l’accueillons, nous fait accéder à la liberté. Et c’est dans la liberté qu’il s’écoute, qu’il s’entend et qu’il nous transporte.
La propagande religieuse est un genre qui a existé et qui existe toujours. Mais elle est, il faut le dire, à l’opposé de l’enseignement du Christ.
[1] Cf, par exemple, la revue de littérature dans : Briony D. Pulford, Andrew M. Colman, Eike K. Buabang, Eva M. Krockow, « The Persuasive Power of Knowledge: Testing the Confidence Heuristic », Journal of Experimental Psychology, 2018, Vol. 147, No. 10.