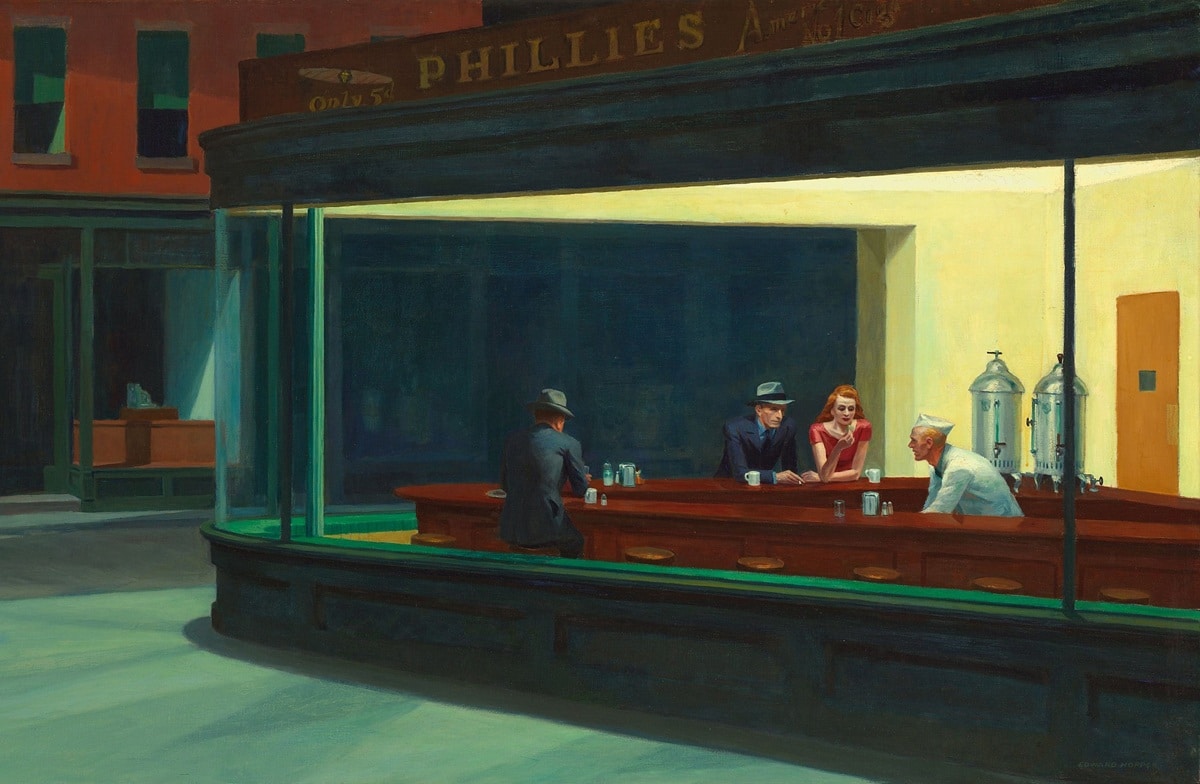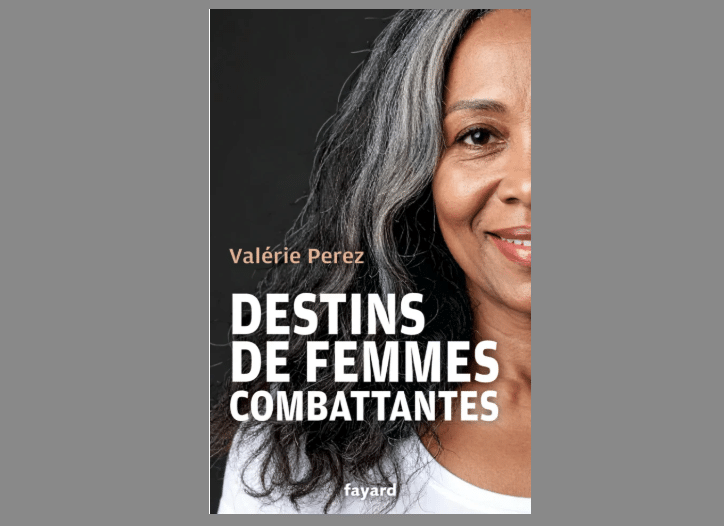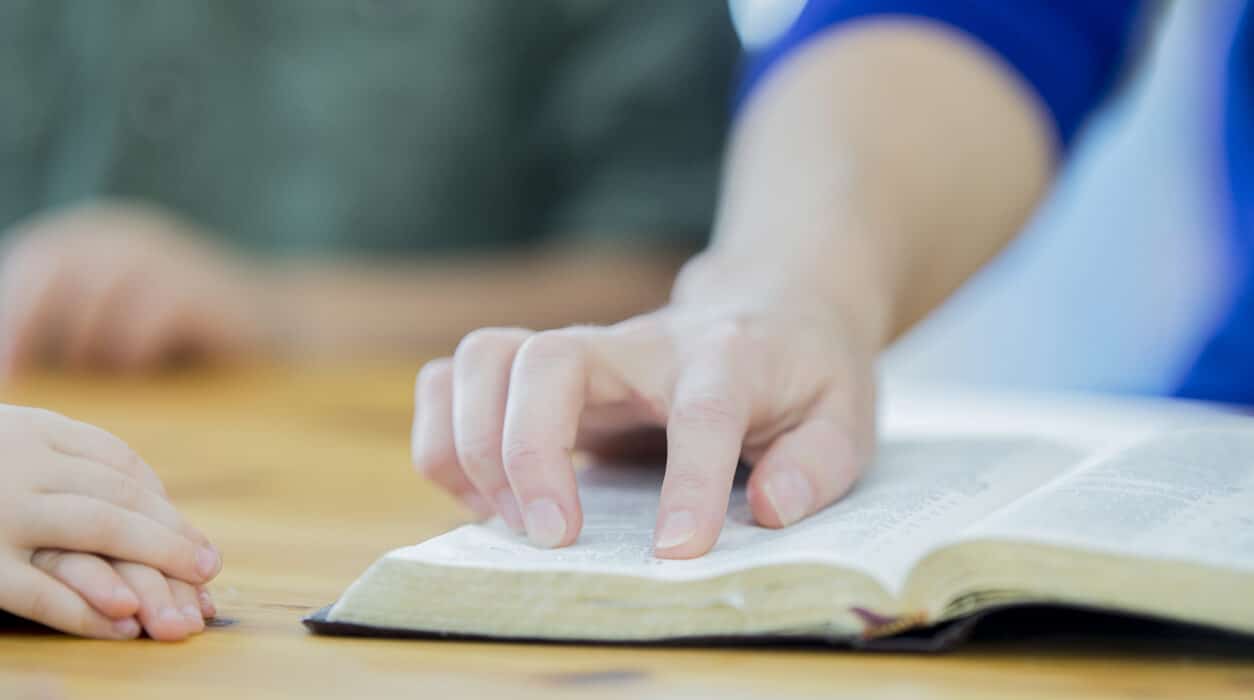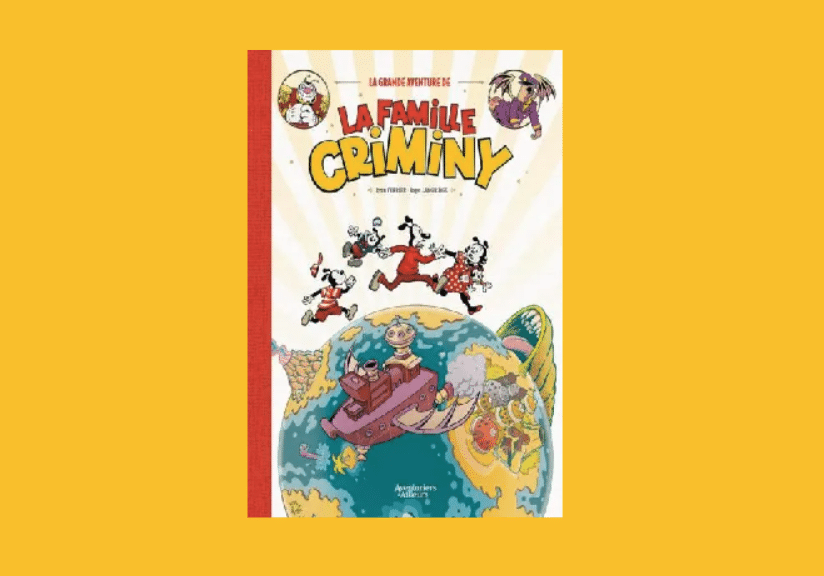Ce qui semble impossible aujourd’hui, serait, virtuellement, possible demain. C’est spécialement frappant, ces dernières années, dans le domaine des télécommunications. Mais il y a des domaines où l’innovation technique ne permet plus que des avancées limitées.
Par exemple, en France (et dans l’ensemble de l’Europe) la progression des rendements agricoles stagne, depuis les années 1990, pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et le tournesol. Il y a des interprétations diverses de cette stagnation. Les plus technophiles ne manquent pas d’imaginer qu’il faudrait aller plus loin dans les intrants artificiels. De l’autre côté, certains pointent la dégradation des sols due à l’usage immodéré des mêmes intrants. Mais ce constat, que personne ne conteste, explique, en tout cas, la tension aiguë dans laquelle vit la profession agricole. Et elle se répercute sur un autre sujet où l’innovation technique ne peut pas grand-chose : celui de l’usage de l’eau. On peut sans doute l’optimiser davantage, mais il est surtout de plus en plus évident qu’il faudra arbitrer entre des usages concurrents.
Autre coup d’arrêt : depuis le début des années 2000, le nombre de kilomètres parcourus en voiture, chaque année, dans la France entière, ne croît plus que très lentement, surtout comparé à ce qui a prévalu entre 1950 et 2000. Cela ne résulte pas tellement d’une prise de conscience écologique, mais plutôt du fait qu’il n’y a plus de place pour la voiture en ville. Il serait possible de construire des infrastructures gigantesques pour continuer à irriguer l’espace urbain, et multiplier les parkings à étage, mais tout cela coûte beaucoup trop cher et les techniques constructives touchent leurs limites. De la sorte, les artères structurantes des grandes villes sont saturées et, l’une après l’autre, les autorités municipales limitent l’usage de la voiture en centre-ville.
Dernier exemple : on commence à se tourner vers des gisements de pétrole de moins en moins performants. Ce qu’on appelle le « taux de retour énergétique », c’est-à-dire l’énergie produite, par rapport à l’énergie nécessaire pour extraire l’hydrocarbure, était, autrefois de 100/1. En ce qui concerne le gaz de schiste, il est autour de 4/1 (les évaluations varient). Et, là non plus, nonobstant les ravages environnementaux provoqués par l’exploitation du gaz de schiste, on ne parvient pas à améliorer ce taux de retour.
Les conséquences sociales de ces blocages
Cette fermeture des horizons provoque des tensions considérables. La question de l’usage de la voiture a embrasé la France, au moment de l’épisode des gilets jaunes. La répartition des ressources en eau est, actuellement, un des sujets les plus conflictuels, même dans le climat non aride de notre territoire. Et l’accès aux ressources énergétiques devient une arme de guerre puissante.
Les tensions sociales sont d’autant plus vives que l’innovation technique a souvent servi à acheter la paix sociale. Beaucoup de groupes sociaux ont accepté une position dominée, moyennant la promesse qu’ils récupéreraient, en partie, les bénéfices des progrès technologiques. Dès l’aube de la révolution industrielle, les tenants de cette nouvelle voie ont pensé qu’ils avaient trouvé un bon moyen de régler la plupart des dilemmes moraux. Les outils perfectionnés ont permis, de fait, d’être moins dépendants les uns des autres. L’économie de marché a, elle-même, été présentée comme méritocratique : elle permettrait aux plus méritants de s’enrichir.
On va retourner vers des enjeux sociaux frontaux et cela risque de faire des étincelles
L’histoire réelle des deux-cents dernières années, a été semée de bien plus de misères, d’exploitations et de conflits atroces, que ce que cette utopie prévoyait.
Mais, en ce moment, s’ouvre une nouvelle période où l’innovation technique permet de moins en moins de déplacer les oppositions sociales. L’indépendance qu’elle permet se retourne en isolement face aux difficultés. Et les inégalités entre pays et entre groupes sociaux n’ont plus la perspective de diminuer « par le bas », les plus pauvres pouvant envisager de gagner de l’aisance matérielle.
L’économie moderne s’est construite contre la féodalité et contre les rapports monarchiques. Mais les tensions d’aujourd’hui font émerger de nouvelles féodalités.
On comprend où je veux en venir : à nous, modestement, pour autant que nous ne sacrifions pas nous-mêmes à Mamon, de nous démarquer, et de proposer aide et repères à tous ceux, autour de nous, qui risquent d’être entraînés dans des événements violents qui les dépasseront.