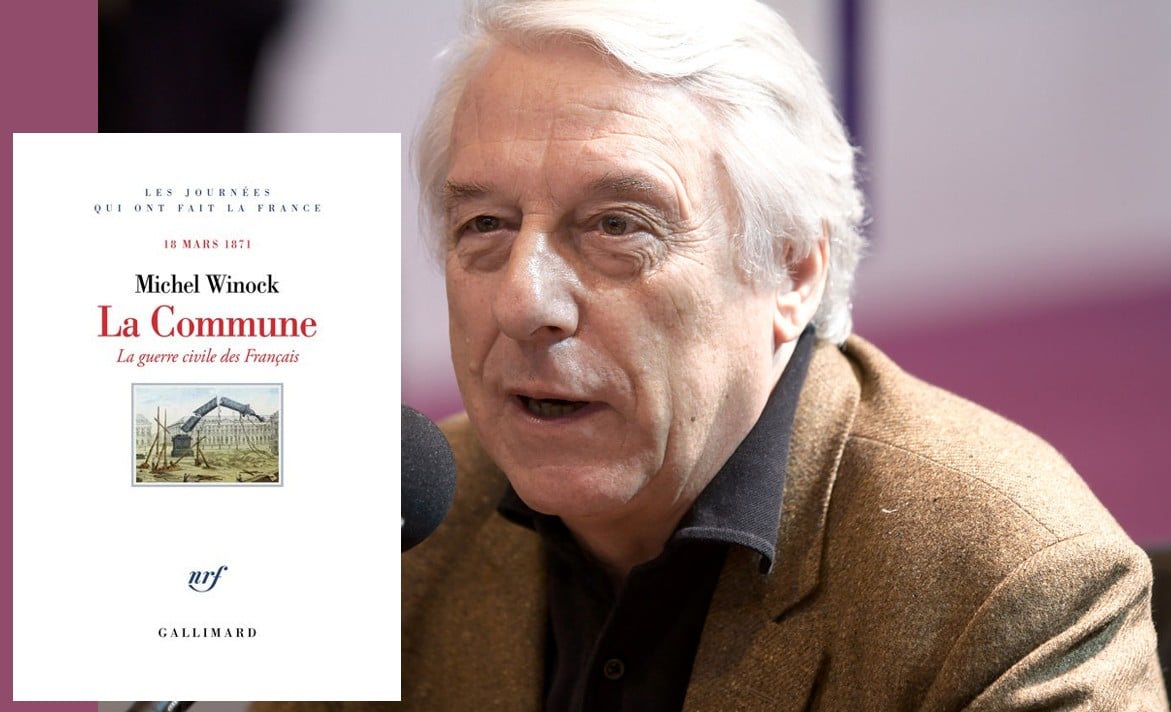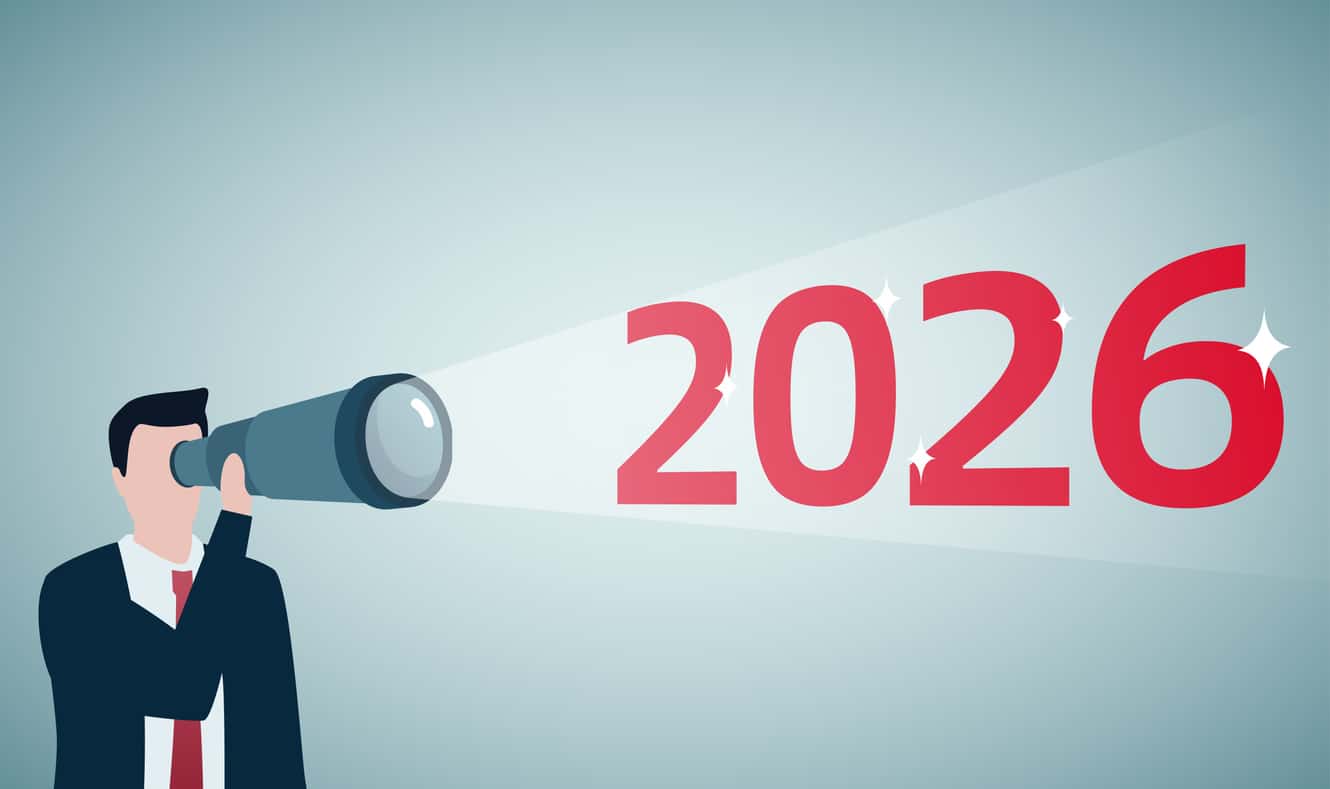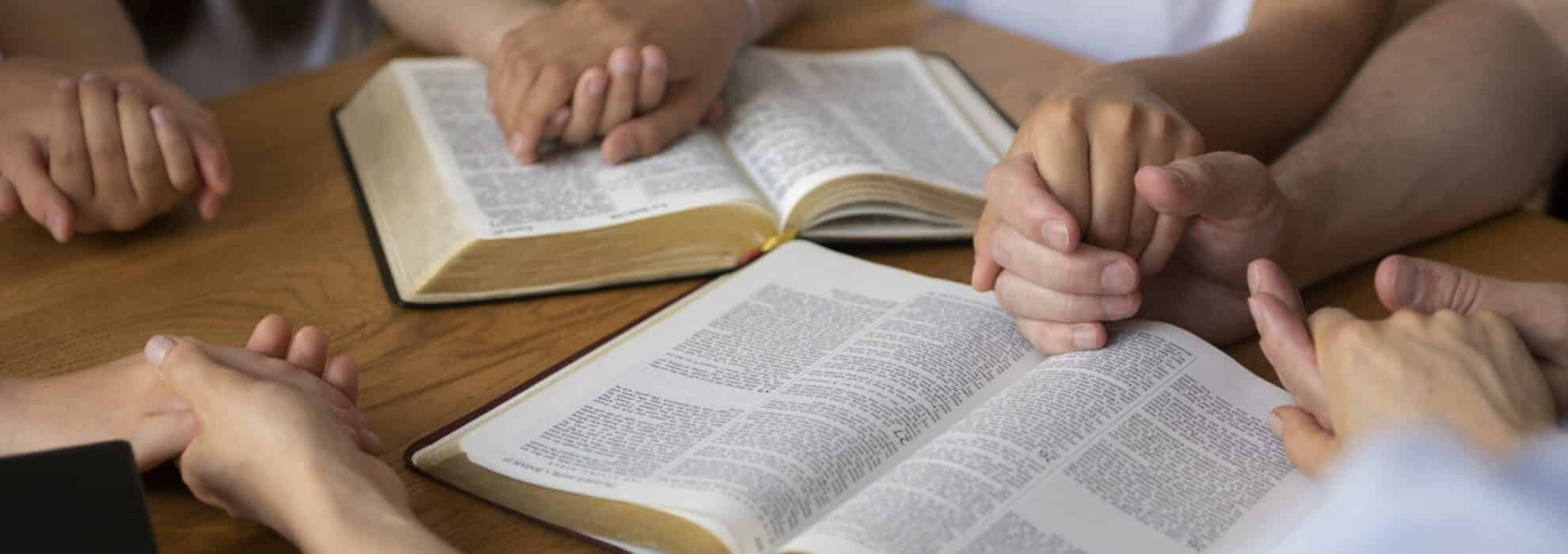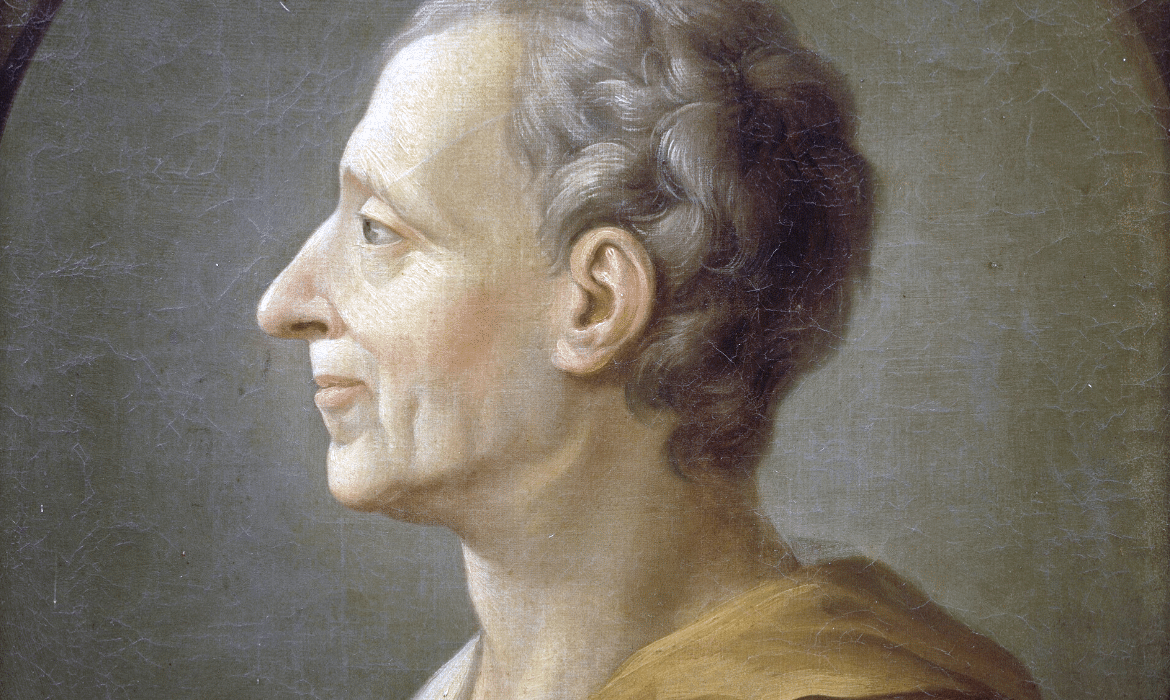L’ordre mondial est mort, le concert des nations n’est plus qu’un vieux souvenir. On ne fera pas l’économie d’une révision de nos programmes. La France est-elle armée pour faire face à la situation ? Nous ne parlons pas de l’arme atomique évidemment, mais des outils institutionnels permettant de rassembler nos concitoyens contre d’éventuels ennemis. Les leçons de la Débâcle devraient nous inspirer. Chacun sait ce que Charles de Gaulle écrivit, dans ses « Mémoires de guerre », au sujet d’Albert Lebrun, président de la République en juin 40 : « Au fond, comme chef de l’Etat, deux choses lui avaient manqué : qu’il fût un chef ; qu’il y eût un Etat.» Nous n’en sommes pas là, fort heureusement. Voici quelques jours, Emmanuel Macron s’exprimant devant des internautes, a déclaré qu’il sonnait le tocsin. Lucide parole. Mais après ? Nos institutions nous garantissent-elles une solidité à toute épreuve ? Nous avons sollicité l’avis d’Eric Roussel, qui vient de diriger, en compagnie de Frédéric Turpin, la formidable « Histoire de la Ve République », paru aux éditions Bouquins.
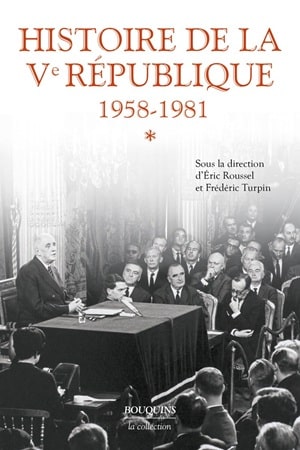
« La Troisième république a abordé la guerre de 39 avec des gouvernements divisés, souligne-t-il d’emblée. Les institutions avaient été construites de telle manière qu’il n’y eût pas d’autorité réunie dans les mains d’une seule personne. C’est au cours de la journée du 16 juin 40 que le général de Gaulle a réagi, et pensé les contours de la fonction présidentielle telle que nous la connaissons. C’est même de cette expérience tragique que l’idée de l’article 16, pièce maîtresse de notre constitution, lui est venue. » Rappelons les termes exact de cet point clé : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. »
Le concept de monarque républicain
N’allons pas imaginer que le chef de l’Etat puisse devenir, grâce à ce texte, un dictateur. Utilisé au lendemain de la tentative de putsch des généraux d’Alger le 22 avril 1961, ce dispositif est resté très encadré. « Quand on entend des opposants dire qu’Emmanuel Macron pourrait se saisir de cet article pour gouverner seul, on ne peut que s’insurger, déclare Eric Roussel. Non seulement le Président ne peut en faire usage sous n’importe quel prétexte, mais encore doit-il rendre compte de son action au bout de six mois, tout abus de pouvoir de sa part l’entraînant devant la Haute Cour de Justice. En revanche, en cas de crise majeure, il pourrait s’en emparer pour sauver la République. »
Il faut bien le reconnaître, le monarque républicain voulu par les pères de la Constitution – n’oublions jamais le rôle important tenu par Michel Debré auprès du Général – a du plomb dans l’aile. Affaibli par le suffrage universel ? Certes. Mais ce n’est pas un drame en soi. Dans son ouvrage « C’était de Gaulle », Alain Peyrefitte rapporte que le Général estimait que cette constitution a été conçue pour gouverner sans majorité.
La perte de puissance de la fonction présidentielle provient surtout de l’instauration du quinquennat.
« C’est l’élément principal qui a altéré ses pouvoirs, observe Eric Roussel. A la fin de sa vie, dans des conversations très sérieuses et rigoureuses, Valéry Giscard d’Estaing a reconnu devant son directeur de cabinet, devant mon ami Frédéric Turpin et moi-même, qu’il avait eu tort de faire renaître ce projet à l’orée des années deux mille. En pratique, le raccourcissement de la durée du mandat présidentiel a certes renforcé les pouvoirs du chef de l’Etat, puisqu’il l’encourage à agir plus vite et plus fort. Mais en écrasant la fonction de Premier ministre, en provoquant des interventions constantes dans le débat public, il expose le président, et donc il l’abaisse du même coup. »
« La grandeur a besoin de mystère, on admire mal ce qu’on connaît bien »
Paradoxe ? Allons donc… A partir de 2007, sous l’impulsion d’un président plein d’énergie, de volonté, l’action présidentielle a pris les allures d’une véritable geste quotidienne. Et si François Hollande a promis d’être un président normal (formule qui lui fut beaucoup reprochée, mais qui traduisait son désir de revenir à une pratique traditionnelle de la fonction), force est de constater qu’il s’est mêlé des domaines les plus variés – jusques et y compris l’expulsion d’une jeune fille installée sur notre territoire en situation irrégulière. Mais chacun voit bien que ce comportement pose problème, parce qu’il retire au chef de l’Etat la hauteur de vue, le rôle d’arbitre que lui conférait nos institutions. L’analyse que l’on prête à Charles de Gaulle : « La grandeur a besoin de mystère, on admire mal ce qu’on connaît bien », nous fait comprendre l’impasse où, de nos jours, se trouve le chef de l’Etat. Cette impasse est d’autant plus préoccupante que, de par le monde, les pouvoirs autoritaires pullulent, y compris dans la patrie de l’équilibre des pouvoirs, les Etats Unis.
Puiser dans le passé des raisons de croire en l’avenir n’est pas une lubie de nostalgique. Les portes de l’enfer ne sont pas encore ouvertes. N’abandonnons pas toute espérance.
A lire :
« Histoire de la Ve République, volume 1 (1958-1981), » sous la direction d’Eric Roussel et Frédéric Turpin, Bouquins, 1220 p. 32 €