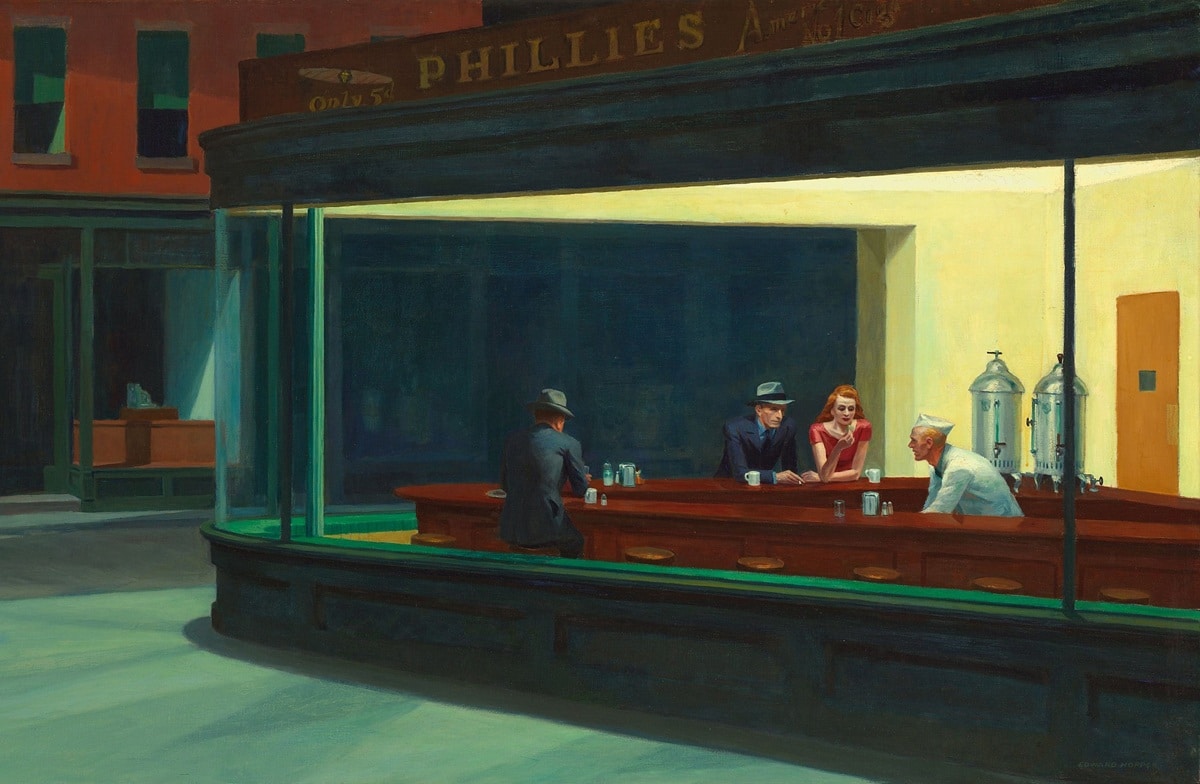Les évêques de France dans une déclaration très prudente ont commenté la situation politique actuelle en parlant du « symptôme d’une société inquiète, douloureuse, divisée », puis en ajoutant que « le malaise social que nous constatons a certes partie liée à des décisions politiques, mais qu’il est plus profond. Il tient aussi à l’individualisme et à l’égoïsme dans lesquels nos sociétés se laissent entraîner depuis des décennies, à la dissolution des liens sociaux, à la fragilisation des familles, à la pression de la consommation, à l’affaiblissement de notre sens du respect de la vie humaine, à l’effacement de Dieu dans la conscience commune ».
Malaise social donc, tensions sur les divers liens sociaux, individualisme : entendu.
La Fédération Protestante de France (à ma connaissance, le CNEF n’a publié aucune prise de position), prudente elle aussi, a été un cran plus loin en appelant de ses vœux « une société équitable et solidaire qui exige un esprit de concorde et le devoir de fraternité de chaque citoyen ».
Les deux instances appellent au discernement dans les choix électoraux, mais elles ne disent rien des associations catholiques ou protestantes (pour ne pas parler de toutes les autres) qui essayent, précisément, de construire des pratiques solidaires, de faire vivre des liens sociaux et fraternels et de sortir de l’individualisme.
Or plusieurs de ces associations n’en sont pas restées à une position aussi prudente et ont élaboré une tribune des chrétiens contre l’extrême-droite et organisé un rassemblement sur ce thème, ce dimanche, à Paris.

Je comprends la motivation particulière des ces associations car, outre leur opposition politique au programme du Rassemblement national, c’est leur activité même qui sera mise en danger en cas d’arrivée au pouvoir de l’extrême-droite, soit par la diminution ou la suppression de certaines subventions, soit par la criminalisation de leur activité.
Le rôle joué par le tissu associatif en France, aujourd’hui
On peut, en effet, déplorer la fragilité du lien social (et je la déplore, moi aussi), mais il faut prendre la mesure de l’importance des missions que les pouvoirs publics ont, de fait, délégué à des associations dans tout ce qui est solidarité de proximité, aide alimentaire, aide au logement, etc. Aujourd’hui ce sont largement les associations (religieuses aussi bien que laïques) qui sont porteuses de ce qui reste de lien social (en dehors du champ du travail qui obéit à d’autres logiques). Et même ceux qui n’ont pas de mots assez durs à l’égard de « l’écologie punitive » se trouveraient bien d’observer ce qui se passe dans les associations qui tentent de mettre en œuvre la transition écologique de manière active et collective plutôt que défensive et individualiste.
Et dans ce domaine on ne peut pas confondre extrême droite et extrême gauche comme le veut une rhétorique un peu facile. Même la FPF parle, à mon avis, un peu rapidement « des extrêmes ». Sur le terrain je vois très bien la différence entre ce que font les associations inspirées par les idées de gauche (modérée ou radicale) et ce que font d’autres groupuscules inspirés par d’autres idées, ou ce que ne font pas des personnes qui comptent surtout sur les forces de police pour faire tenir la société.
Extrêmement quoi ?
La rhétorique des « extrêmes » finit, en effet, par anesthésier la réflexion. Au moment de la réforme des retraites, j’ai trouvé l’attitude de LFI à l’assemblée nationale extrêmement stupide et l’attitude du pouvoir extrêmement arrogante et têtue. Oui, il y a un extrême centre qui a ses propres problèmes !
L’extrême droite, donc, représente un danger pour le lien social, non pas parce qu’elle est extrême, mais parce qu’elle entravera la solidarité de proximité et qu’elle exclura au maximum certaines personnes du jeu social.
Est-ce à dire que ce qui se vit dans les réseaux militants de gauche est dépourvu de danger ? Assurément non : il y a souvent, dans les milieux associatifs, une importante conflictualité. Des questions dérisoires peuvent devenir des enjeux de pouvoir démesurés. Par ailleurs, les relais politiques de ces militants ne sont pas exempts de tentations autoritaires. Et, comme dans tous les appareils politiques (de gauche comme de droite), plus on monte dans la hiérarchie interne, plus les rapports interpersonnels sont brutaux.
Il ne faut donc pas être naïf. Mais ce que je veux souligner, c’est que notre vote n’engage pas que des questions idéologiques. Il met en jeu, également, ce qui se vit sur le terrain, au jour le jour. Et, dans ce domaine, le tissu associatif ne réussit pas toujours à construire des relations solidaires et fraternelles, mais, au moins, il essaye.
Et ces tentatives, pour inabouties qu’elles soient, doivent être soutenues.