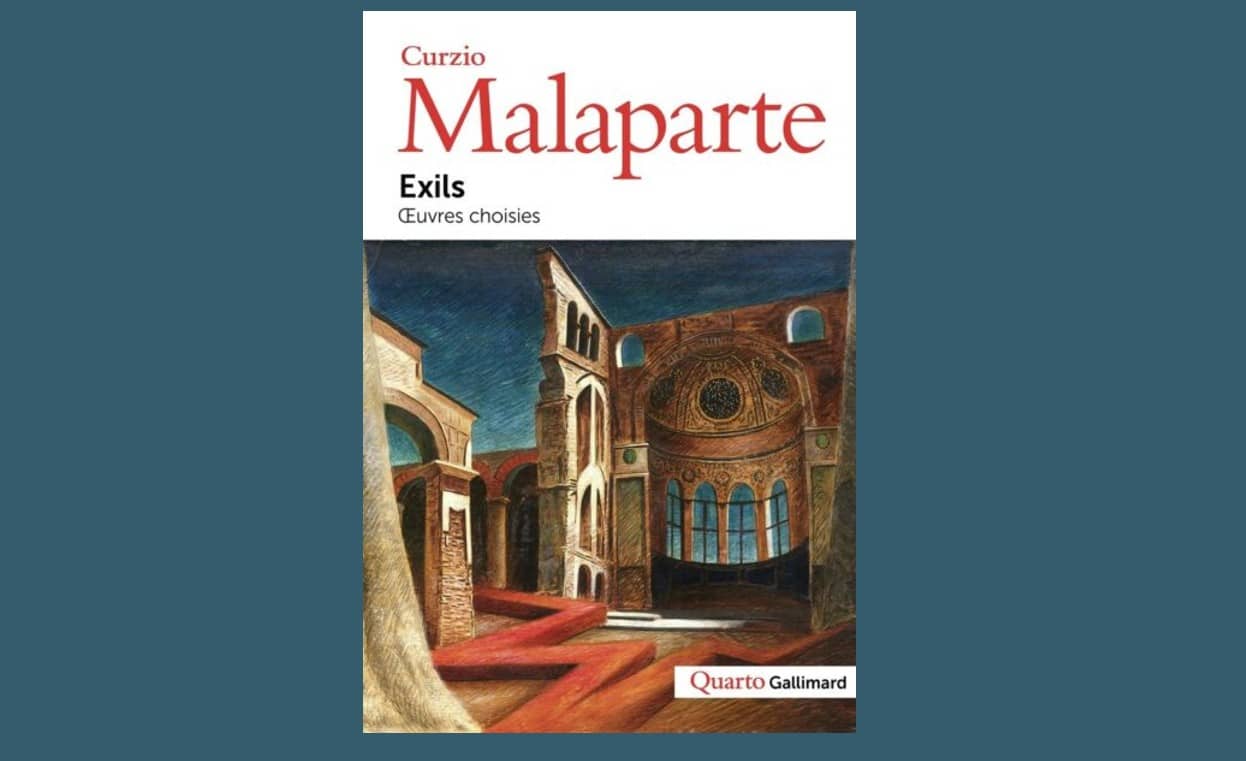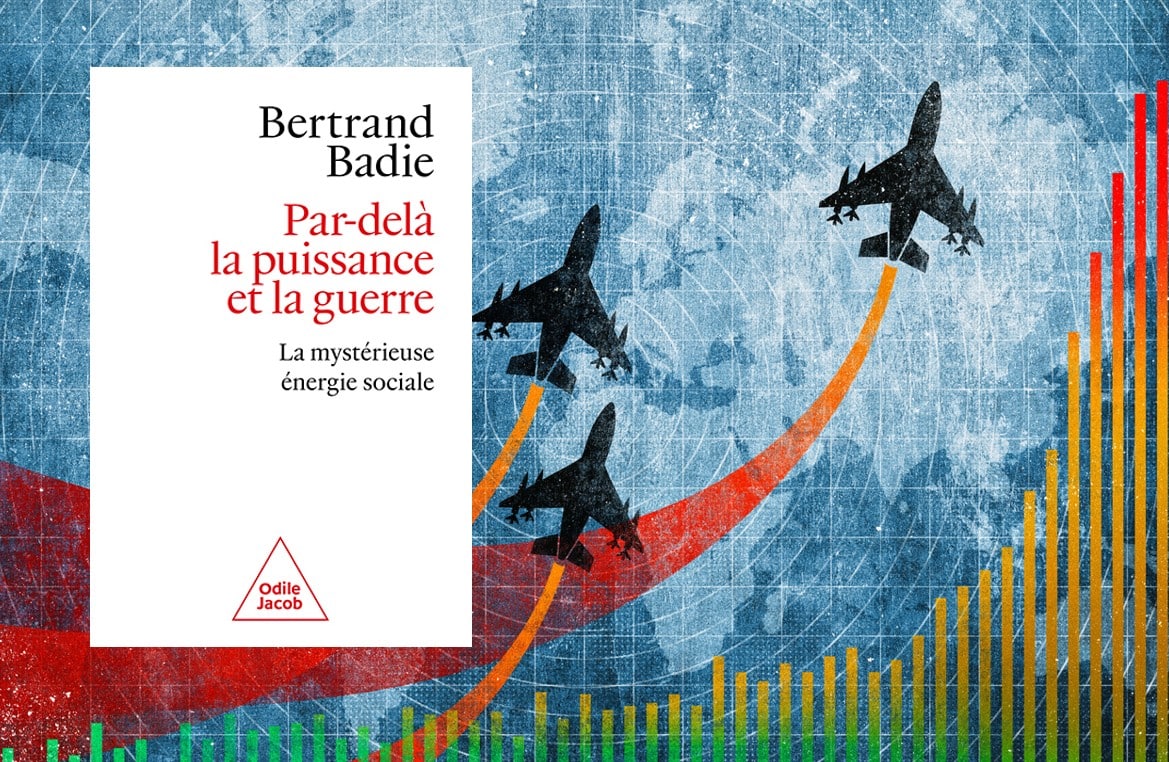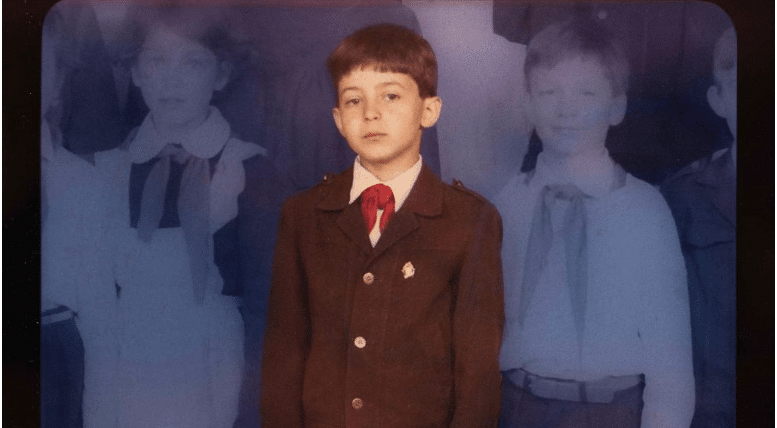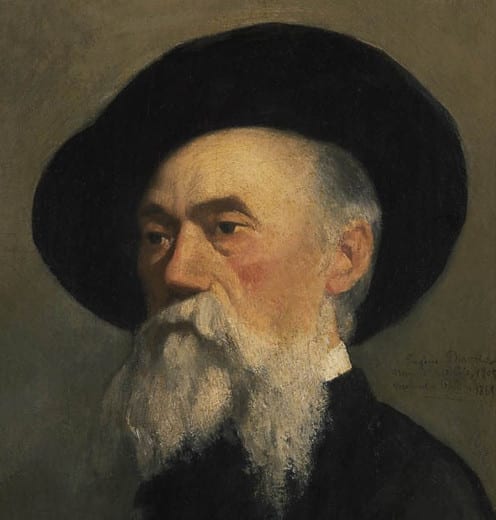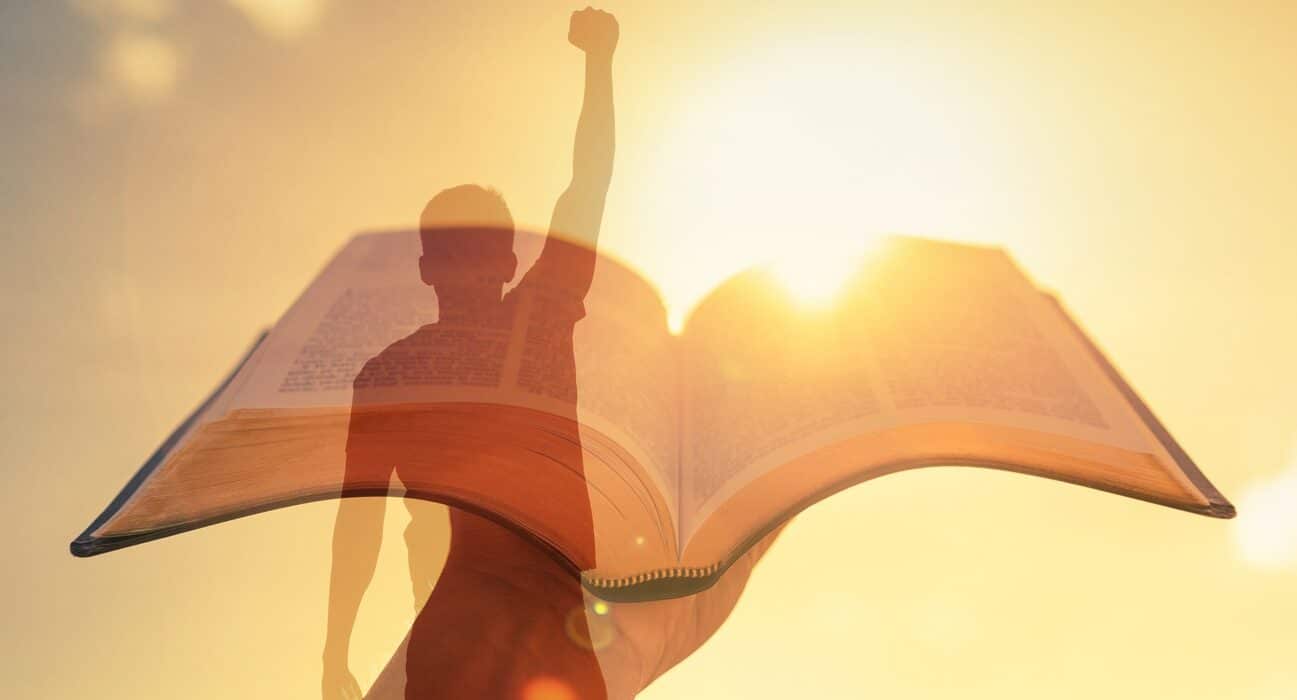La proposition de loi n° 1102 relative aux soins palliatifs et d’accompagnement déposée le 11 mars par la députée Annie Vidal (Ensemble pour la République) intègre la notion de soins spirituels, en définissant les soins palliatifs comme « des soins de support et de confort destinés à répondre aux besoins physiques de la personne, dont le traitement de la douleur, ainsi qu’à ses besoins psychologiques, sociaux et spirituels ».
La loi du 9 décembre 1905 n’a pas institué l’inculture du fait religieux par l’État, car elle intègre la neutralité d’un État qui reconnaît que chaque personne peut pratiquer le culte de son choix. Si cette notion de « soins spirituels » est maintenue dans le texte qui sera discuté et voté entre le 12 et le 16 mai 2025 à l’Assemblée nationale, nous pourrons nous réjouir d’une avancée modeste mais effective, de la reconnaissance de la dimension holistique des citoyens français dans la loi française.
Nous savons combien toutes les formes d’accompagnements complémentaires – affectif, psychologique et spirituel – sont précieuses dans ces moments qui précèdent le « grand départ » où chaque mot, chaque geste, chaque témoignage comptent. Comment ne pas être éclairé par les paroles lumineuses de l’Évangile de Jean 11.25/26 :« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
Le renforcement juridique de la reconnaissance des soins spirituels est une réaffirmation des droits des patients croyants et encouragera toutes celles et tous ceux qui s’investissent au service des malades en fin de vie dans ce domaine.
Thierry Le Gall, directeur du service pastoral du CNEF auprès des parlementaires, pour « L’œil de Réforme »