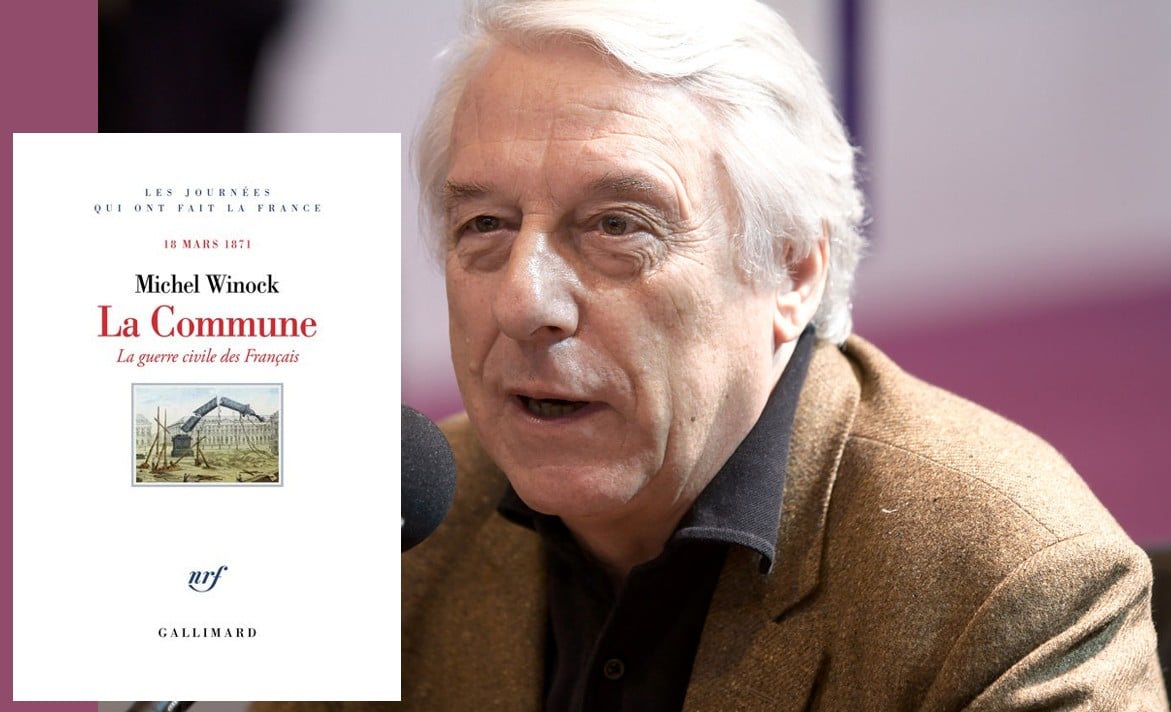Risquer sa vie pour informer, telle est l’ambition des reporters de guerre. Mémona Hintermann est de ces êtres courageux. Femme aux pays des rouleurs de mécaniques, elle a depuis quarante ans parcouru les régions les plus dangereuses de notre monde, et même croisé des crocodiles en col blanc quand elle fit partie du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. En publiant « Une journaliste ne devrait pas dire ça ? » (Hugo Doc, 348 p. 18,55€) cette journaliste au caractère bien trempé nous dévoile quelques aspects de son parcours.
« Je ne crois pas du tout que les reporters de guerre composent l’aristocratie de notre métier, déclare Mémona Hintermann. D’ailleurs, disons-le franchement, parler de ce qui se passe au coin de votre rue vous oblige à être le plus conforme à la réalité parce que vous avez toujours un témoin qui va vous contredire, alors que si vous partez au fin fond de la planète, vous pouvez laisser courir votre imagination sans être forcément démenti. Plus sérieusement, le moindre sujet de vie quotidienne exige rigueur et sens de l’écoute, la justesse du regard. »

On le devine, chacune ou chacun des journalistes qui se lancent à l’assaut d’une guerre possède en lui des motivations profondes, plus ou moins secrètes, qu’il ou elle s’avoue plus ou moins. Le chemin suivi par Mémona Hintermann est éloquent. « Quand j‘étais enfant, j’avais envie de parler de ce qui se passait dans mon village, sur les pentes d’un volcan à la Réunion, nous explique-t-elle. Ma mère était une femme qui souffrait beaucoup, dure au mal et qui ne réclamait qu’une chose : qu’on la regarde comme une personne digne. Qui allait le dire ? Qui allait raconter son destin ? Ma motivation vient de là. J’ai appris mon métier au ras des pâquerettes, sur les îlettes de la Réunion, ces plateaux situés entre les montagnes, et j’ai d’abord parlé des cyclones, de la coupe de la canne à sucre avant de venir en métropole puis de partir pour d’autres aventures. »
La peur est consubstantielle du métier de reporter de guerre. Là encore, c’est dans le courage de l’enfance que Mémonna Hintermann a puisé la force d’affronter les plus grands périls.
« A la Réunion, les prédateurs étaient nombreux, qui tournaient autour de nous, révèle-t-elle. Comme un oiseau sur le qui-vive, attentive à toute menace, je suis toujours restée en éveil. » Une telle tournure d’esprit n’exclut pas la confiance en l’autre, mais elle guide les choix professionnels. « Quand je partais en mission, j’évitais les collègues dont je devinais qu’ils allaient s’effondrer dès qu’ils allaient entendre une salve de mitraillette, mais tout autant les têtes brûlées qui risquaient de me mettre en danger, souligne Mémona Hintermann. Si, dans les jours ou les semaines qui viennent, je devais repartir (je ne dis cela que par hypothèse) je choisirais des gens capables de surmonter ma fatigue ou ma mauvaise humeur et dont je serais moi aussi capable de soutenir les faiblesses. »
On le sait, ce métier particulier fut longtemps l’apanage des hommes. En ce domaine aussi, l’engagement des femmes a transformé la manière de raconter les événements.
« Nous avons ouvert le compas du public, estime Mémona Hintermann. Autrefois, les reportages ne montraient que des soldats en action ; nous avons voulu faire comprendre les enjeux locaux des affrontements dont nous étions les témoins. Pas forcément des enfants qui crient, des vieillards qui s’accrochent à leur maison tombée en ruine, non.
L’émotion compte, mais elle ne doit pas tout envahir. A chaque fois que j’ai couvert une guerre, je me suis posée cette question : de quoi s’agit-il ? Pour répondre, il est fondamental de choisir des interlocuteurs qui incarnent la situation particulière où l’on se trouve. Il faut que les téléspectateurs puissent s’imaginer la complexité des choses, des problèmes posés. Encore une fois, je le dis, la guerre n’a rien de noble. C’est une saloperie Je ne suis pas plus forte que les autres, j’ai seulement envie de raconter ce que je vois. »
Fille d’une catholique bretonne et d’un père indien musulman qui vivaient en union libre, Mémona Hintermann a grandi dans une famille nombreuse. Elle passait de l’église à la madrassah, percevait que tout le monde priait le même dieu mais que chaque famille spirituelle regardait l’autre en ennemie. « C’était déjà la guerre », analyse-t-elle en un saisissant raccourci.