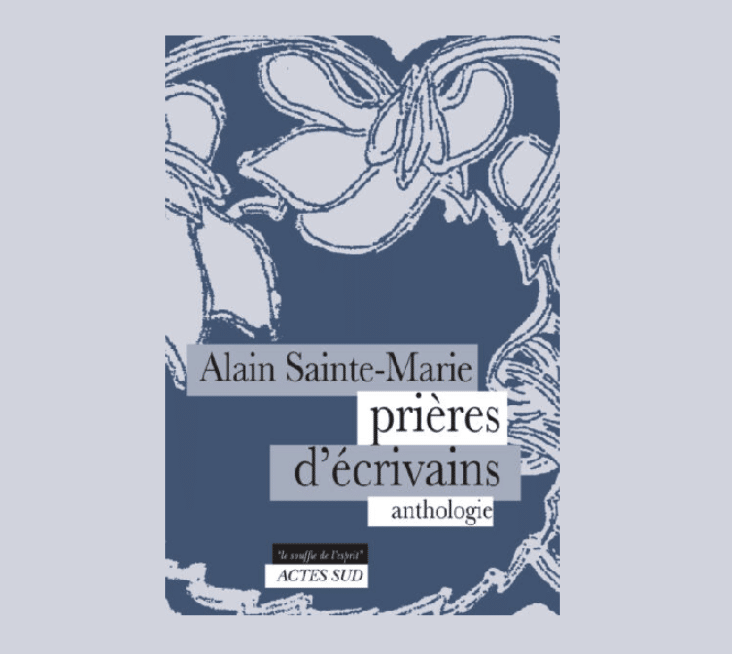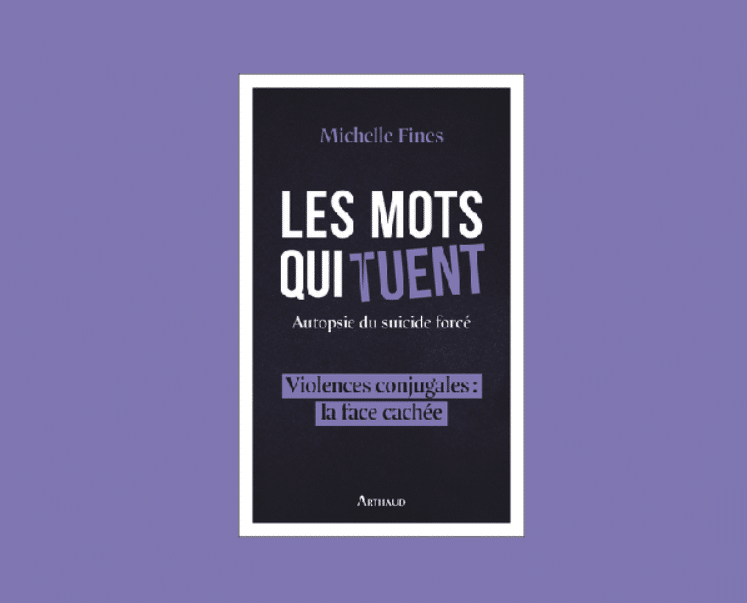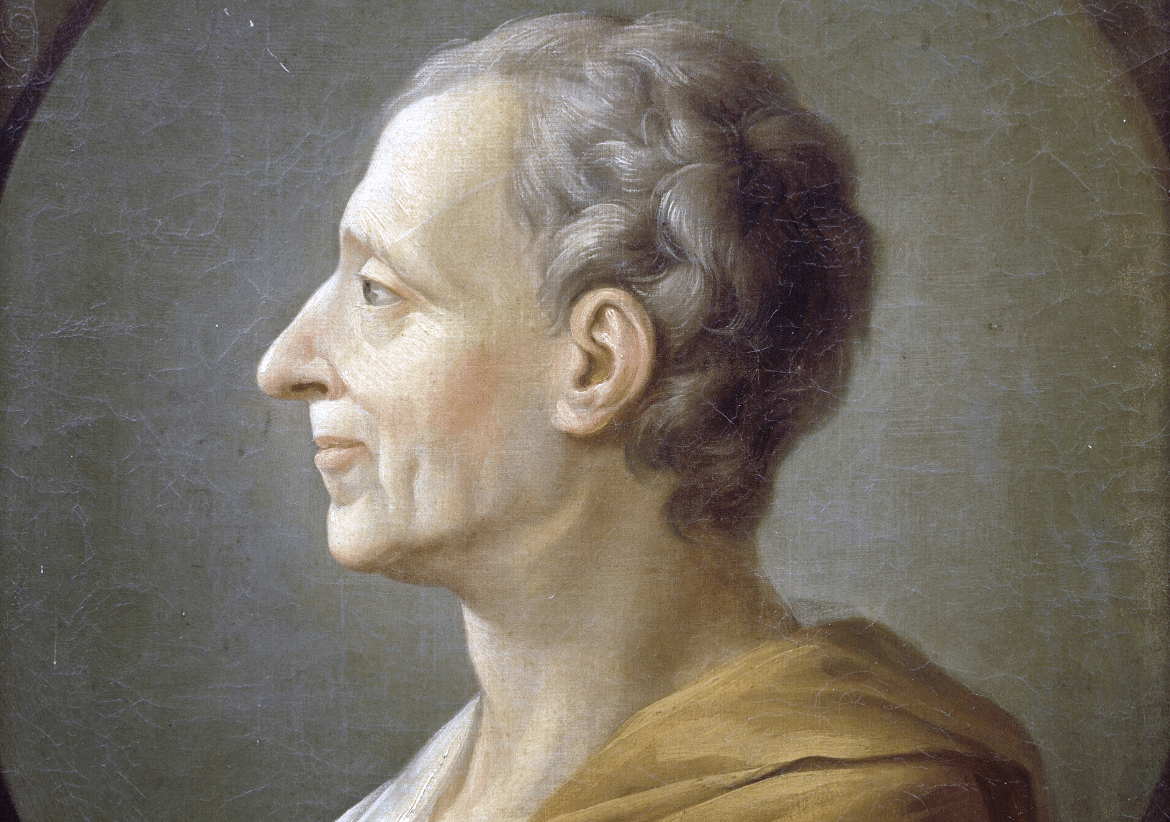Le Québec a toujours bonne réputation en France : îlot de résistance francophone en Amérique du Nord, inventivité linguistique qui fait dire divulgâcher pour spoiler ou téléphone intelligent pour smartphone, convivialité chaleureuse et inclusive avec une intégration des immigrants bien plus rapide qu’en France, etc. Fréquentant régulièrement ce pays, je partage et j’apprécie ce constat. Mais mon quotidien québécois me fait percevoir d’autres réalités qui m’interrogent.
Une récente bulle spéculative immobilière a jeté à la rue des milliers d’habitants évincés par la hausse exponentielle des prix et des loyers des logements. Toutes les villes ont leurs campements d’itinérants (SDF) qui affrontent sous la tente l’hiver canadien.
L’excellence de la médecine québécoise est indéniable, mais inaccessible à une large fraction de la population. Faute de pouvoir accéder au secteur privé, cette dernière doit se rabattre sur un hôpital public en surcharge permanente. Idem pour le secteur de l’enseignement.
Le secteur communautaire est le lieu multiforme de l’engagement bénévole des Québécois, mais cette solidarité impressionnante ne peut pallier les carences d’un État faible, qui peine à faire respecter les lois protectrices. Une vie politique inconsistante, avec des partis interchangeables, ne semble pas en mesure de réformer le système. Une résignation sceptique est le lot de bien des électeurs, souvent abstentionnistes.
Le Québec actuel frappe par sa dé-catholicisation, fruit du rejet massif d’une Église malheureusement déviante et identifiée comme « la grande noirceur ». Mais les valeurs chrétiennes de justice et de partage semblent faibles face au Dieu argent, que le Québec soit souverain ou non.
Jean Loignon, professeur d’histoire-géographie, pour « L’œil de Réforme »