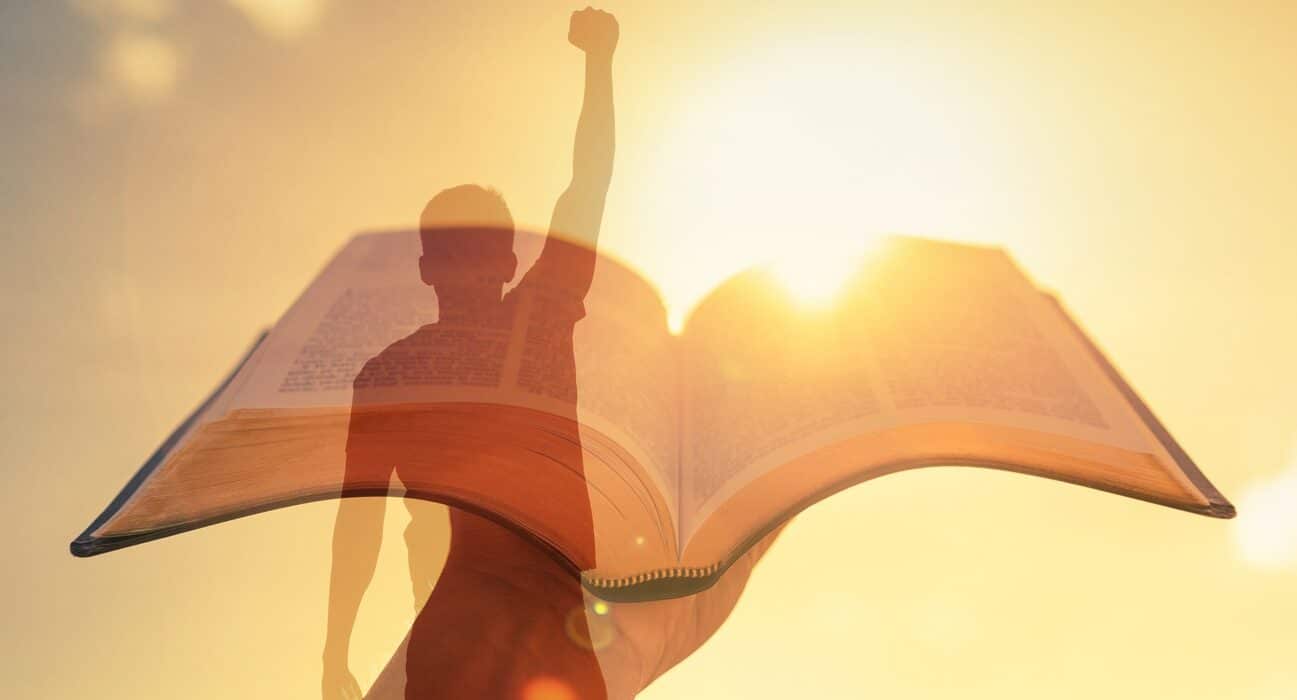Allant de 10 à 41 %, les surtaxes promises par Donald Trump depuis plusieurs mois vont finalement être appliquées. Le président américain a signé jeudi 31 juillet le décret actant l’entrée en vigueur de l’augmentation des droits de douane qui s’applique à de nombreux pays dans le monde, rapporte l’AFP, citée par Le Monde. Plusieurs fois repoussée, elle devait se faire ce vendredi 1er août, mais a été repoussée au 7 août prochain, donnant ainsi un délai de près d’une semaine aux pays concernés pour que les douanes puissent se mettre à la page.
Nombre d’entre eux sont parvenus à des accords permettant de réduire l’augmentation, grâce à des compromis trouvés au cours des négociations avec l’administration de Donald Trump. Cependant, certains n’ont pas abouti à un consensus et vont se voir imposer des droits conséquents. À noter que, depuis la mise en place des tarifs douaniers plafonnés début avril à 10 % pour toutes les nations, les États-Unis ont connu une hausse spectaculaire de leurs recettes en matière de douane, faisant rentrer pas moins de 27 milliards de dollars dans ses caisses, selon RFI.
Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud… ces pays qui ont trouvé un accord
Ils sont moins d’une dizaine de pays, en plus de l’Union européenne (UE), à avoir trouvé un accord avec les États-Unis avant la date butoir du 1er août. On retrouve ainsi la Chine, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Vietnam, le Royaume-Uni, le Japon, les Philippines et l’UE sur cette liste. Tous n’ont pas obtenu des compromis équivalents, et certains ont même mis les bouchées doubles afin de conclure une entente dans les temps, quitte à ce qu’elle s’en trouve même désavantageuse pour eux. L’UE, le Japon et la Corée du Sud sont notamment dans ce cas, ayant conclu un marché à quelques jours seulement de l’échéance.
Côté chinois, un accord de principe avait déjà été trouvé depuis le 11 juin dernier, avec une limitation des taxes douanières appliquées aux produits de la République populaire de Chine à 30 %, pendant que les produits américains sont maintenant taxés à 10 % à leur entrée sur son territoire. Les négociations restent en cours, alors qu’une partie reposait sur l’exportation des terres rares abondantes en Chine et primordiale pour la fabrication de batteries, notamment.
Le 27 juillet dernier, l’UE n’a pas non plus conclu d’accord juridiquement contraignant, mais a trouvé un terrain d’entente et a obtenu un taux de 15 % sur ses produits exportés vers les États-Unis. Le Japon a obtenu le même pourcentage grâce à un accord signé en bonne et due forme. Il en va de même pour le voisin sud-coréen, dont la signature a été effectuée pratiquement au dernier moment le 29 juillet. Le Royaume-Uni avait été pour sa part le premier pays à parvenir à un accord de principe, le 8 mai dernier. Si des détails restent à peaufiner, les tarifs douaniers imposés au Royaume de Sa Majesté restent au minimum, soit à 10 %.
Canada, Brésil, Inde… les pays sans accord
Plus nombreux encore sont ceux avec qui les États-Unis n’ont pas conclu d’accord, et pour des raisons aussi diverses que variées. Pour ne citer que les principaux, on retrouve notamment les voisins que sont le Canada et le Mexique, ainsi que le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud, ou encore la Suisse. Le premier cité était déjà dans le viseur du président américain lorsqu’il a annoncé sa volonté le 30 juillet de reconnaître un État palestinien. Cette dernière nouvelle n’est pas de nature à débloquer la situation alors que les droits de douane appliqués au Canada sont même passés de 25 à 35 % sur les produits ne relevant pas de l’ACEUM, l’accord de libre-échange Canada – États-Unis – Mexique.
Le Mexique s’était d’ailleurs vu menacé de taxes douanières à hauteur de 30 %, qui finalement resteront à 25 % pour une durée minimum de 90 jours, délai supplémentaire convenu entre Donald Trump et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Le Brésil et l’Inde sont pour leur part tous les deux sanctionnés sur les tarifs douaniers pour des raisons politiques. Le premier, menacé d’un taux culminant à 50 %, subit les foudres du locataire de la Maison-Blanche en raison des poursuites judiciaires lancées contre Jair Bolsonaro, ancien président brésilien, et ami de Donald Trump. L’Inde est quant à elle pénalisée par sa proximité avec la Russie, et se voit imposer des tarifs s’élevant à 25 %.