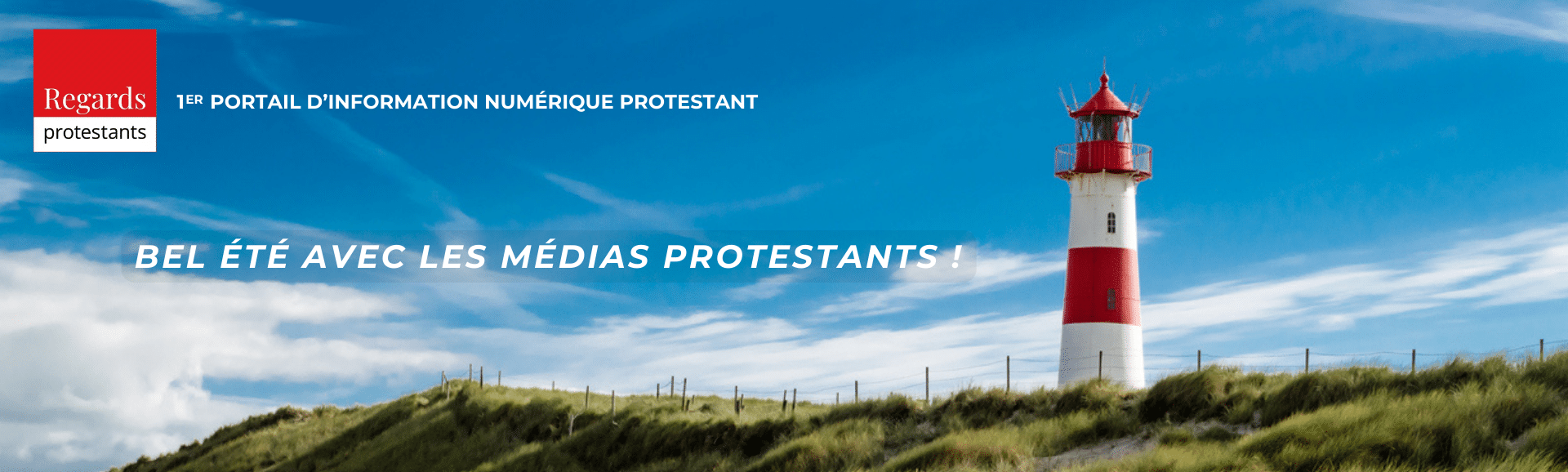Quel que soit la personnalité qui succédera à Angela Merkel à la tête du gouvernement allemand, à l’issue des négociations engagées au lendemain des législatives du 26 septembre, tout porte à croire qu’il mettra ses pas dans ceux de la chancelière sortante, laquelle a marqué de son empreinte, en seize ans d’exercice du pouvoir, la politique de son pays. Si le poste est confié, comme il est probable, à Olaf Scholz, dont le parti, le SPD, l’a emporté de justesse sur la CDU-CSU de Mme Merkel, la continuité sera assurée : Olaf Scholz a exercé pendant plus de trois ans les fonctions de vice-chancelier et de ministre des finances sous l’autorité de la chancelière, il a donc été associé à toutes les décisions du gouvernement sortant et, même si la nouvelle coalition, placée sous la direction des sociaux-démocrates, diffère de la précédente par sa composition, ses grandes orientations ne devraient pas marquer une rupture avec celles de l’équipe conduite par Mme Merkel.
Si le nouveau chancelier devait être Armin Laschet, la proximité serait encore plus forte puisque le chef de file de la CDU-CSU était le candidat de Mme Merkel et qu’il représentait son parti dans la compétition électorale. Cette compétition, il l’a perdue de peu à l’issue d’une campagne malheureuse, mais il peut encore nourrir l’espoir d’accéder à la chancellerie si les discussions menées par les sociaux-démocrates avec les Verts et les libéraux échouent et que ces deux « petits partis », arrivés respectivement en troisième et quatrième position, choisissent de se tourner vers lui. Ministre-président du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie depuis 2017, président fédéral de la CDU depuis janvier 2021, il est un des fidèles partisans de la chancelière sortante, dont il approuve la politique d’orthodoxie budgétaire et dont il a soutenu, en 2015, la décision d’accueillir plusieurs centaines de milliers de migrants. Il s’est présenté aux électeurs comme son héritier naturel.
Les Verts et les libéraux détiennent les clés
Une grande coalition entre le SPD et la CDU-CSU étant exclue, les clés du gouvernement futur, que ce soit avec l’un ou avec l’autre de ces deux « grands partis », sont entre les mains des deux « petits partis ». Avant d’offrir éventuellement leur collaboration aux deux grands, ils tentent d’abord de se mettre d’accord entre eux. Cela ne va pas de soi, leurs positions sur la fiscalité et les dépenses publiques en particulier étant assez éloignées. Les uns et les autres convoitent le ministère des finances pour être en mesure de faire prévaloir leurs idées. S’ils parviennent à un accord, ils seront bien placés pour apporter à la future coalition, quelle qu’elle soit, leur force de renouvellement, fondée en particulier sur la priorité donnée à la question climatique et à la décarbonation de l’économie. Ces choix s’inscrivent, avec des nuances, dans la continuité de l’ère Merkel mais visent à créer une dynamique nouvelle, que ce soit au service du SPD ou, même si c’est moins probable, à celui de la CDU-CSU.
Il est toutefois un domaine où la question d’un infléchissement, voire d’une réorientation, de la politique allemande va se poser. C’est celui du rôle international du pays, en liaison avec celui de l’Europe. Le sujet a été pratiquement absent de la campagne électorale. Mais il a été soulevé par le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, dans un discours prononcé une semaine avant le scrutin, à l’occasion du retour des troupes allemandes d’Afghanistan. « La chute de Kaboul, a-t-il dit, est une tragédie dont nous sommes coresponsables. Ces semaines marquent une césure politique qui doit nous obliger à faire notre autocritique et à redéfinir notre rôle et notre responsabilité dans le monde ». Le débat sur l’engagement de l’Allemagne dans une stratégie de puissance n’est pas encore tranché. « C’est une tâche qui incombera au prochain gouvernement et au prochain Bundestag », conclut M. Steinmeier.
Une « puissance réticente »
Mme Merkel, il est vrai, a amorcé la nécessaire réflexion sur l’implication allemande dans les affaires du monde. Mais elle est demeurée au milieu du gué. Elle a augmenté substantiellement le budget militaire de son pays, accru ses interventions à l’étranger, fait évoluer sa doctrine. Sans aller jusqu’à redéfinir clairement ses règles d’action sur la scène internationale. L’Allemagne est restée, selon la formule du Monde, une « puissance réticente ». « La mue qu’Angela Merkel n’a pas faite, demande le correspondant du quotidien à Berlin, Thomas Wieder, son successeur la fera-t-il ? ». La question est posée, la réponse est incertaine. Ce qui est vrai, c’est que beaucoup souhaitent cette évolution. Le journaliste cite deux essais récents dont le titre est sans ambiguïté. L’un s’intitule « Le successeur de Merkel devra redéfinir le rôle de l’Allemagne dans un monde fait de compétition » (Ulrich Speck pour le German Marshall Fund), l’autre « Après Merkel, pourquoi l’Allemagne doit mettre fin à son inertie en matière de défense et de sécurité » (Jana Puglierin, pour l’European Council on Foreign Relations).
L’affirmation de l’Allemagne comme un acteur majeur des relations internationales est indissociable de celle de l’Europe comme une puissance face aux Etats-Unis, la Russie ou la Chine. L’une ne va pas sans l’autre pour les Etats du Vieux Continent s’ils veulent peser sur les affaires du monde. Les principaux partis allemands, à l’exception de l’extrême droite et de l’extrême gauche, l’un et l’autre en recul, sont résolument pro-européens. « L’Europe est notre avenir », a déclaré Olaf Scholz. « Sans l’Europe, a-t-il souligné, nous ne jouerions aucun rôle dans le monde ». Les dirigeants de la CDU-CSU, des Verts et des libéraux partagent cette conviction. « La politique étrangère allemande doit toujours être une politique européenne », a dit Annalena Baerbock, la cheffe de fil des Verts, qui a regretté que l’Allemagne n’ait pas répondu aux propositions d’Emmanuel Macron sur la modernisation de l’Union européenne. Il existe incontestablement un consensus entre les partis qui aspirent au pouvoir sur l’importance de la construction européenne. Mais au-delà des déclarations de principe y a-t-il accord entre eux sur une Europe forte, dotée d’une « autonomie stratégique » et porteuse d’une « souveraineté européenne » ? Cela reste à prouver.