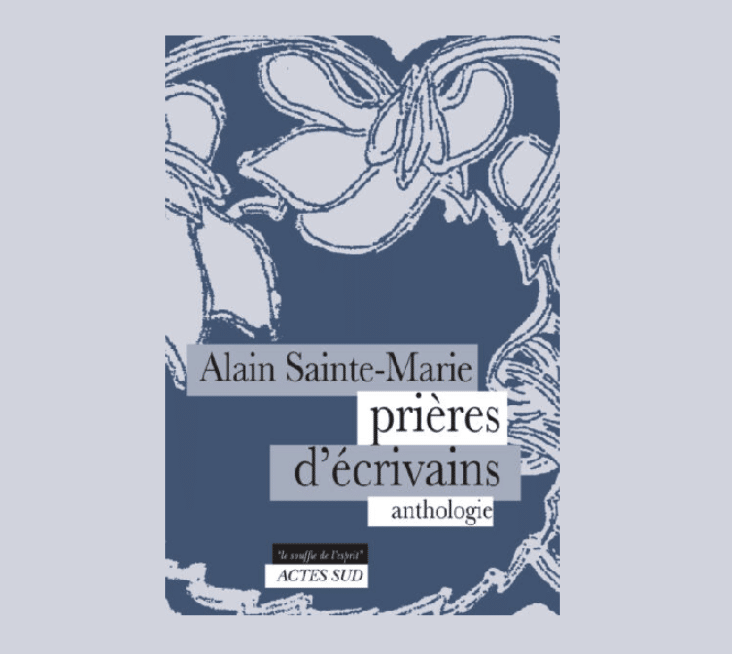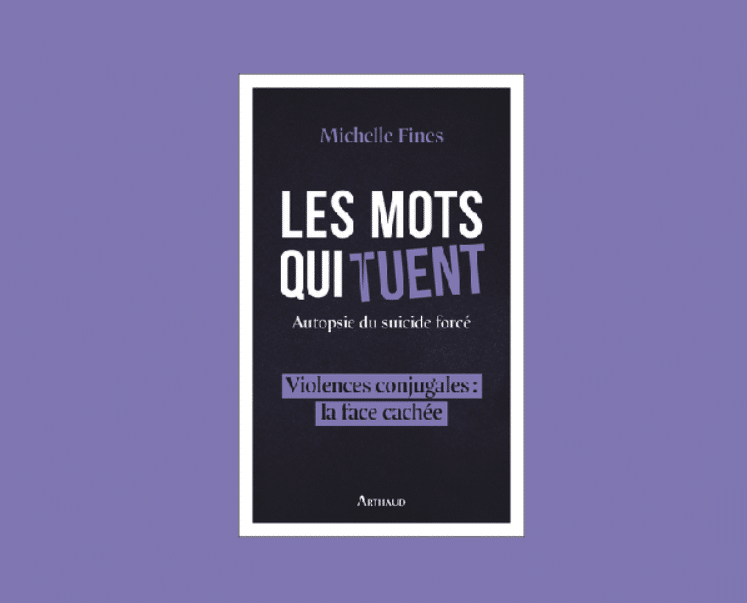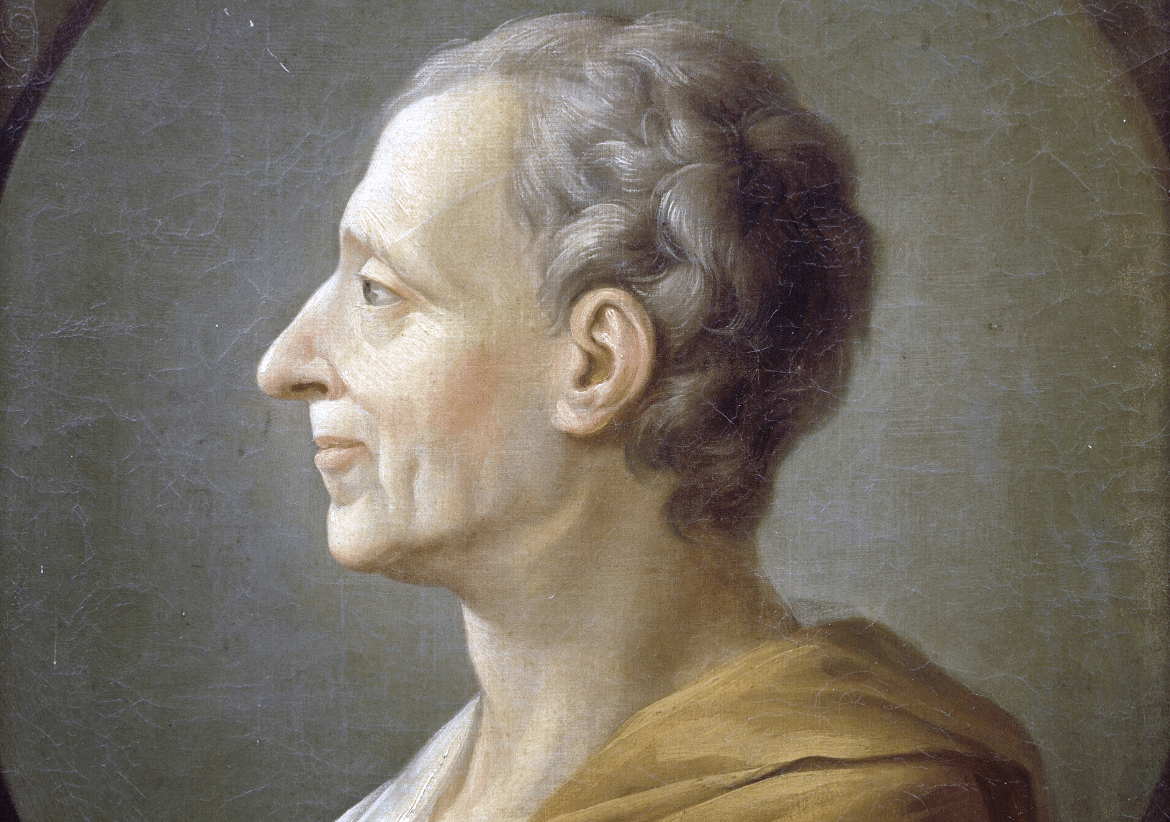Comment ne pas être interloqué par la confusion apparente entre ce qui relève de la politique et ce qui a pris des allures de célébration religieuse ? L’hommage public rendu à Charlie Kirk par les plus hautes autorités gouvernementales américaines dimanche dernier n’a cessé de balancer entre démonstration de force du mouvement MAGA et hommage christique en forme de confession de foi évangélique particulièrement orientée.
Le discours donné à cette occasion par Donald Trump en était une illustration exemplaire. Le propagandiste assassiné le 10 septembre dernier était, selon lui, un véritable martyr de la cause républicaine et « le meilleur évangéliste pour la liberté américaine ». De manière inattendue de la part de l’infatué président, celui-ci est allé jusqu’à reconnaître que le défunt était probablement meilleur chrétien que lui-même puisqu’il pardonnait à ses ennemis, ce qu’il se gardait bien de faire de son côté. Le vice-président J.D. Vance n’a pas été en reste en qualifiant Charlie Kirk de « héros pour les États-Unis et martyr de la foi chrétienne ». D’autres ont salué son sacrifice quasi christique dans la reconquête en cours de la terre promise.
Mais ce qui a été salué par un grand nombre des orateurs présents, c’est le réveil attendu de la foi chrétienne que la croisade menée par le défunt aurait enfin permis. Le réveil… Ce concept est tout sauf anodin pour le protestantisme. Il a qualifié plusieurs mouvements de revitalisation religieuse évangélique qui ont aussi contribué à accentuer les fractures internes au protestantisme. N’est-ce pas ce que nous sommes en train de revivre, avec ce retour aussi fracassant qu’inattendu du religieux, en l’espèce chrétien, dans la sphère du politique ? Et, en tant que protestants européens, sommes-nous vraiment de ce combat ?
Valentine Zuber, historienne, professeure à l’Université, pour « L’œil de Réforme »