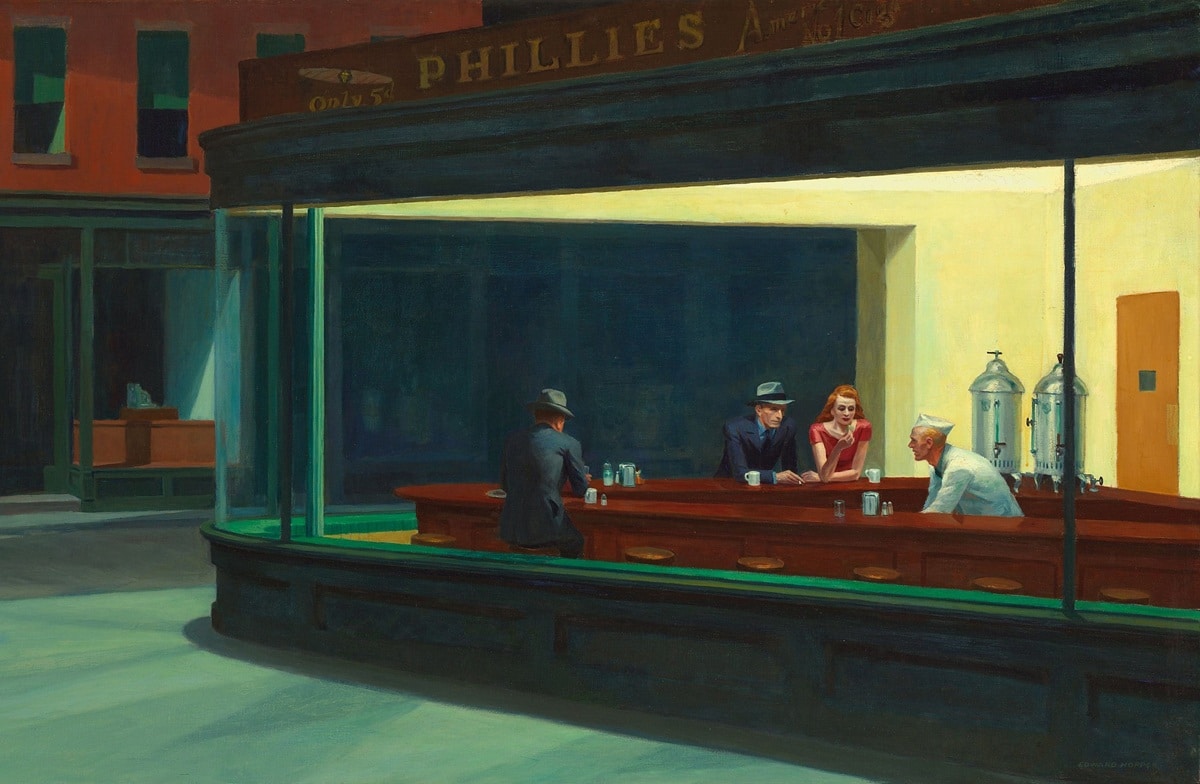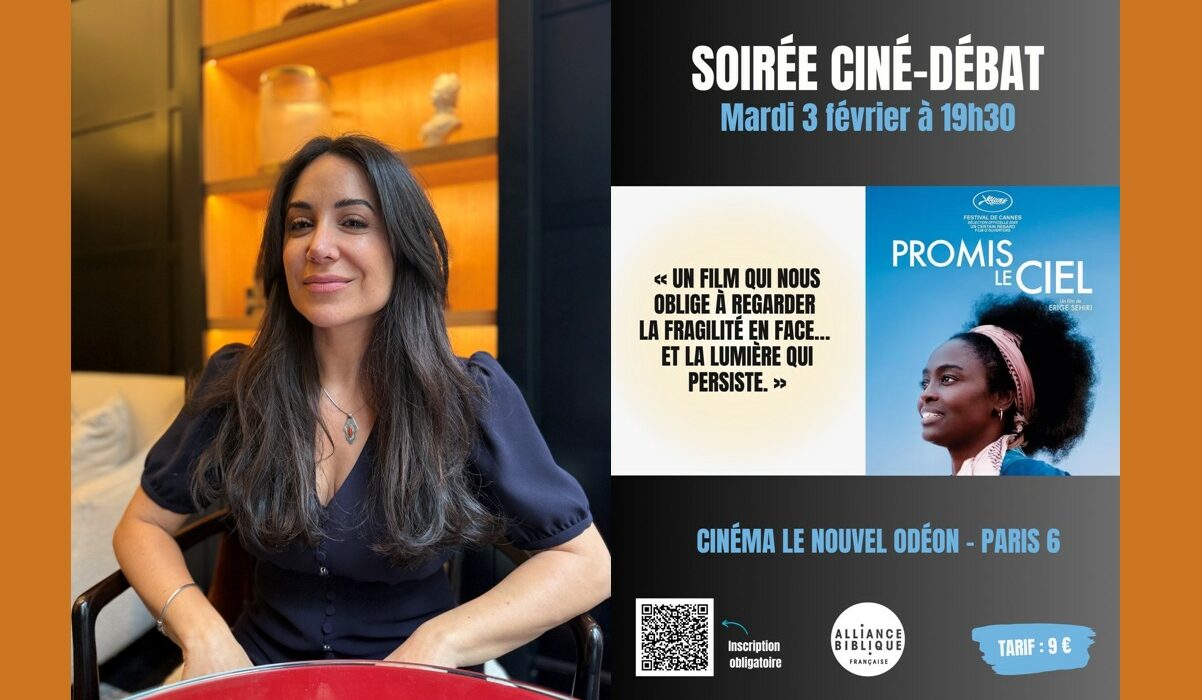« Partout on confond paix et sécurité ». La formule n’est pas de moi, mais de Dietrich Bonhoeffer. Il la prononce lors d’une allocution à la conférence œcuménique de Fanö en 1934. À ce moment, en Allemagne, l’église confessante a commencé à prendre ses distances avec le gouvernement nazi (chronologiquement, on se situe, fin août 1934, entre la déclaration de Barmen et celle de Dahlem). L’espoir de Bonhoeffer, à l’époque, est qu’une interpellation de l’ensemble des Églises, de tous pays, pour appeler à la paix, pourrait avoir le poids qu’aucune église nationale isolée n’aurait jamais. Il était, hélas, exagérément optimiste.
Il était néanmoins lucide : « l’heure presse, le monde est hérissé de baïonnettes ; effrayante, la méfiance se lit dans tous les regards » et « qui sait si nous nous retrouverons l’an prochain »[1], ajoute-t-il.
Au reste, si je ne partage pas le relatif optimisme de Bonhoeffer, je pense qu’il a parfaitement mis le doigt sur les impasses dans lesquelles nos pays, aujourd’hui encore, s’égarent, et sur la spécificité, dans ce domaine, du point de vue chrétien.
Le chemin de la paix n’est pas celui de la sécurité
Il explicite, en effet, son propos, en disant qu’en aucun cas la recherche de la sécurité n’apportera la paix. « La paix doit être audacieuse ; elle est l’unique grand risque à prendre, et ne pourra jamais être assurée. La paix est le contraire d’une garantie. Exiger des assurances signifie se méfier, et se méfier engendre la guerre ». Voilà le cœur de son argument. On se rend compte, aujourd’hui, qu’aucun état ni aucune société civile ne sont prêts à prendre de tels risques. Et encore moins le risque de combats qui sont « gagnés même lorsque le chemin mène à la croix », comme il l’écrit.
Mais il y a quelque chose de profond dans son discours. Aujourd’hui, on n’envisage rien d’autre (aussi bien au niveau international, qu’en termes de politique intérieure) qu’un équilibre des forces. On tente de parvenir à des cessez-le-feu, on tient les manifestants en respect, on se méfie des oppositions. Et peut-être, dans le meilleur des cas, que cela permettra d’éviter un embrasement généralisé.
Mais cela ne produira pas la paix. Disons que la paix dont parle le Christ et que les chrétiens sont appelés à vivre et à professer, c’est autre chose.
La paix et le risque
J’aime cette idée d’associer la paix au risque, car c’est souvent l’objection que l’on rencontre quand on veut être artisan de paix : c’est beaucoup trop risqué.
Et l’enjeu est là : accepter le risque, ou bien rechercher la sécurité.
Or les politiques publiques, aujourd’hui, s’enferment, de plus en plus, dans des bétonnages juridiques, dans une surenchère sécuritaire, dans la poursuite illusoire du risque minimum. Et elles renforcent, ce faisant, les comportements agressifs.
Je ne pense pas que les acteurs politiques et encore moins leurs électeurs soient disposés à entendre, actuellement, cet appel au risque. Mais être chrétien peut (devrait) mettre en mesure de prendre le risque de la main tendue. C’est là le chemin de la paix annoncée par le Christ (et c’est bien au nom du Christ que Bonhoeffer appelait à la paix) qui n’est, en rien, celui de la sécurité.
Et je pense que nos sociétés ont un besoin urgent de la respiration que pourrait leur donner un groupe de gens disposés à sortir des vertiges sécuritaires de tous ordres.
La fascination devant les outrances des autocrates
Un tel programme d’action est sans doute complexe à mettre en œuvre, aujourd’hui, tant la fascination devant les outrances des autocrates, leur capacité à ignorer toutes les règles, leur recours décomplexé au mensonge et au rapport de force, occupent le devant de la scène. Cela fait, assurément, de bons titres pour les médias. Cela encourage, également, les penchants de tout un chacun pour le passage en force et pour la construction de forteresses qui découragent des assaillants éventuels.
De fait, le niveau international, où se situait Bonhoeffer, me semble hors de portée, au moins à court terme. Au niveau microsocial, en revanche, nous avons une marge d’action importante, en lien avec d’autres acteurs prêts à prendre les risques de la paix. Entre les deux, il y a le niveau national où nous pouvons, au moins, nous positionner comme des acteurs qui refusent l’enfermement dans le dialogue de sourds et les parodies de négociation.
Les chances d’aboutir à quelque chose sont difficiles à estimer… mais, pour le coup, c’est là le risque qu’il faut être prêt à prendre !
[1] Le texte de cette allocution est reproduit, en français, Bonhoeffer, Textes choisis, Labor et Fides et Le Centurion, 1970, pp. 186-189.