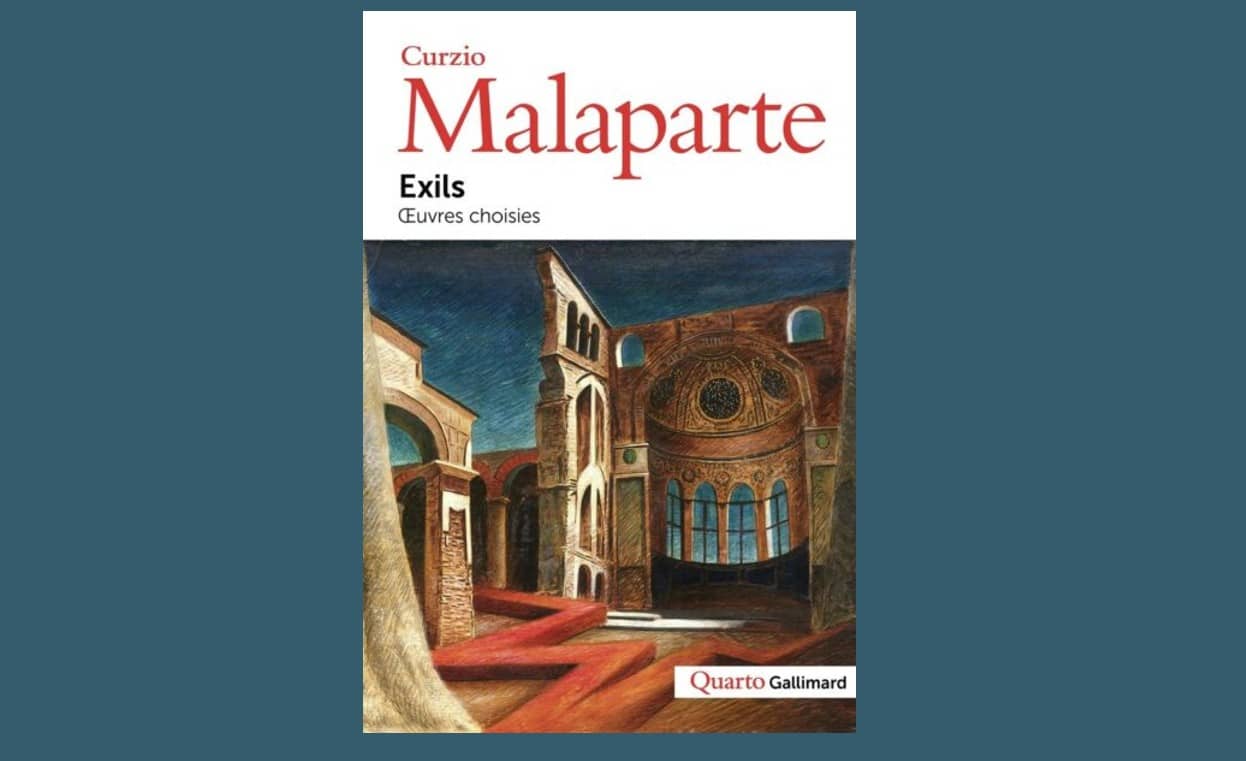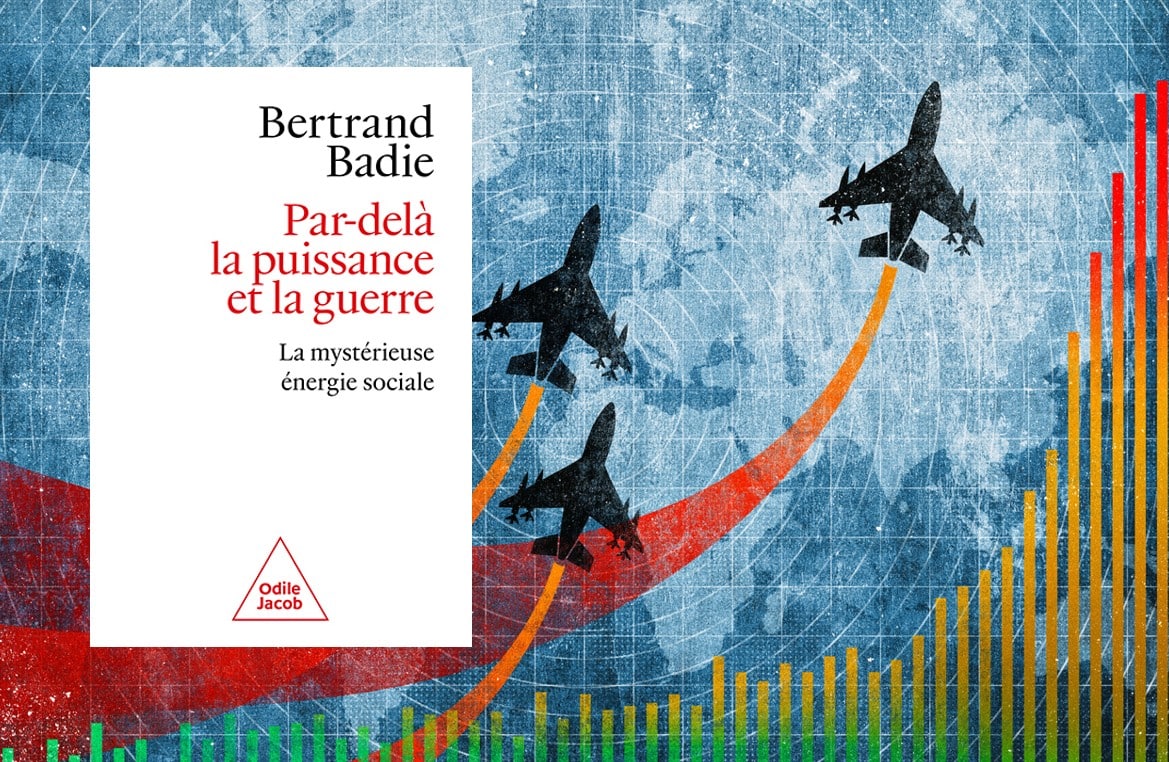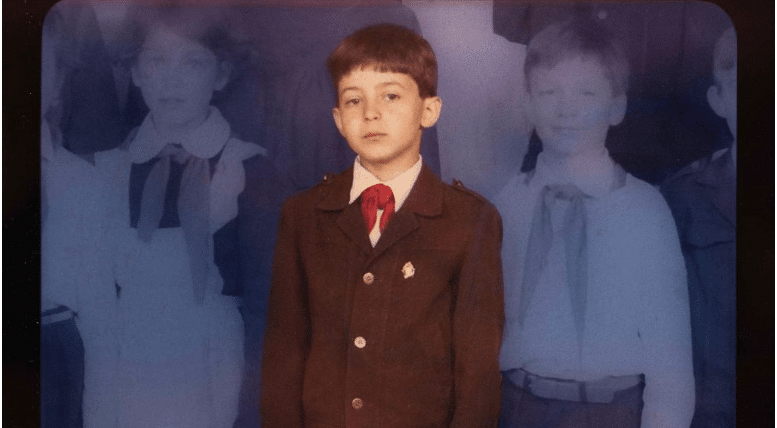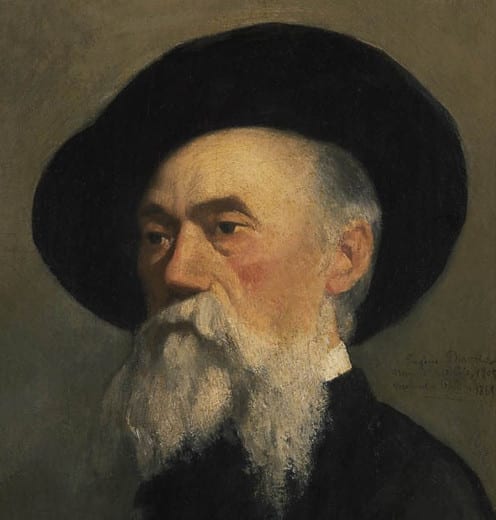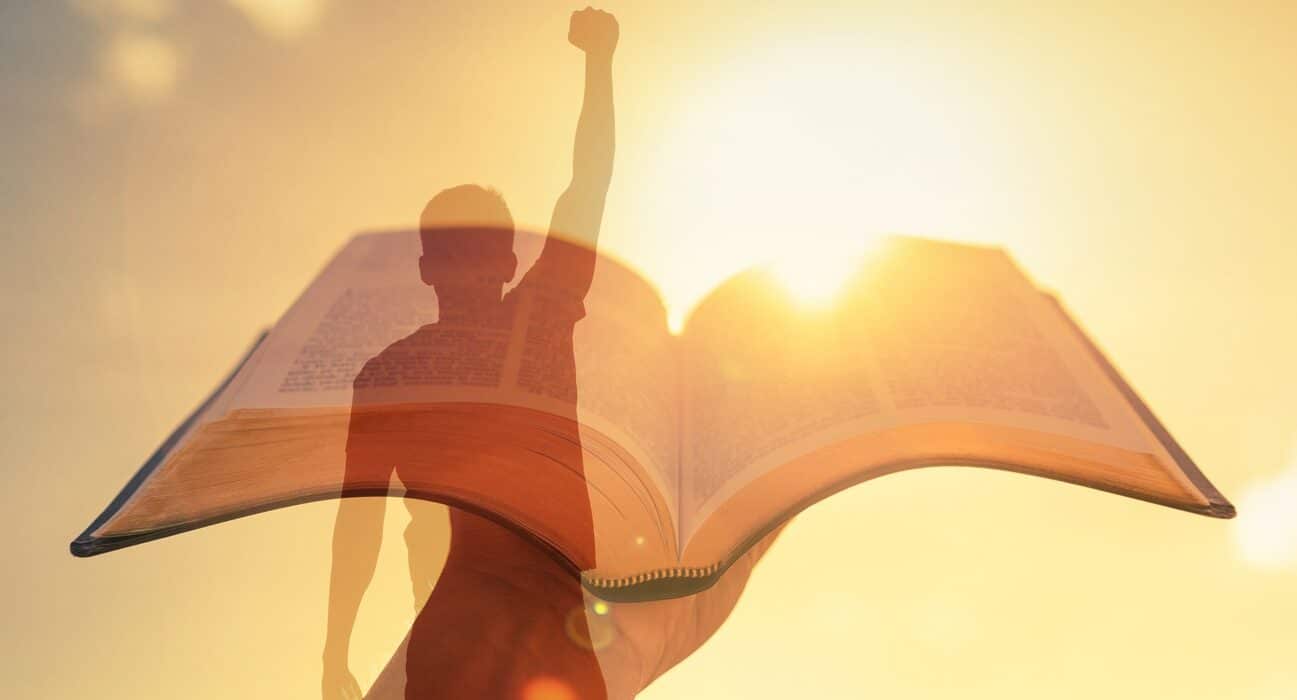Une pause, c’est la suspension d’une activité. Dans un match, c’est la mi-temps. Lors d’un spectacle ou un concert, c’est l’entracte. Pendant des marches, on parle de faire une halte. Il y a la pause-café, et la pause de midi, pendant le travail. Un congé sabbatique est une période de pause dans une carrière professionnelle. Au moment de Noël en 1914, une trêve a eu lieu pendant les combats entre les belligérants. À Pâques 2025, une trêve de quelques heures (fragile) a pu avoir lieu dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Un cessez-le-feu est entré en vigueur entre Israël et l’Iran le 24 juin, mais il reste bien fragile. Un traité de paix a été signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin, mais les combats sur le terrain continuent.
Après avoir tout créé, Dieu a fait une pause, en se reposant le septième jour. C’est aussi pour cela qu’il a institué le sabbat, un jour de repos, pour les humains. Dans la Bible, 39 psaumes contiennent des pauses (sela, en hébreu), marquant ainsi un arrêt, une respiration entre deux couplets, souvent chantés. « Arrêtez, et reconnaissez que je suis Dieu », dit le Psaume 46 v.11.
Rêvons un peu : sommes-nous par exemple capables de faire une pause dans l’utilisation des écrans, dans le stress quotidien, une pause pour une retraite spirituelle ou pour… du repos, tout simplement ? Et rêvons un peu plus loin : non seulement d’une pause, d’une trêve dans les guerres ou conflits en Ukraine, à Gaza, en Cisjordanie, au Kivu, au Soudan, en Birmanie, mais d’un arrêt définitif des combats, avec signature – et application – de traités d’une paix juste et durable. Et si la prière – et l’action – des chrétiens pouvaient y contribuer ?
Christophe Hahling, pasteur, pour « L’œil de Réforme »