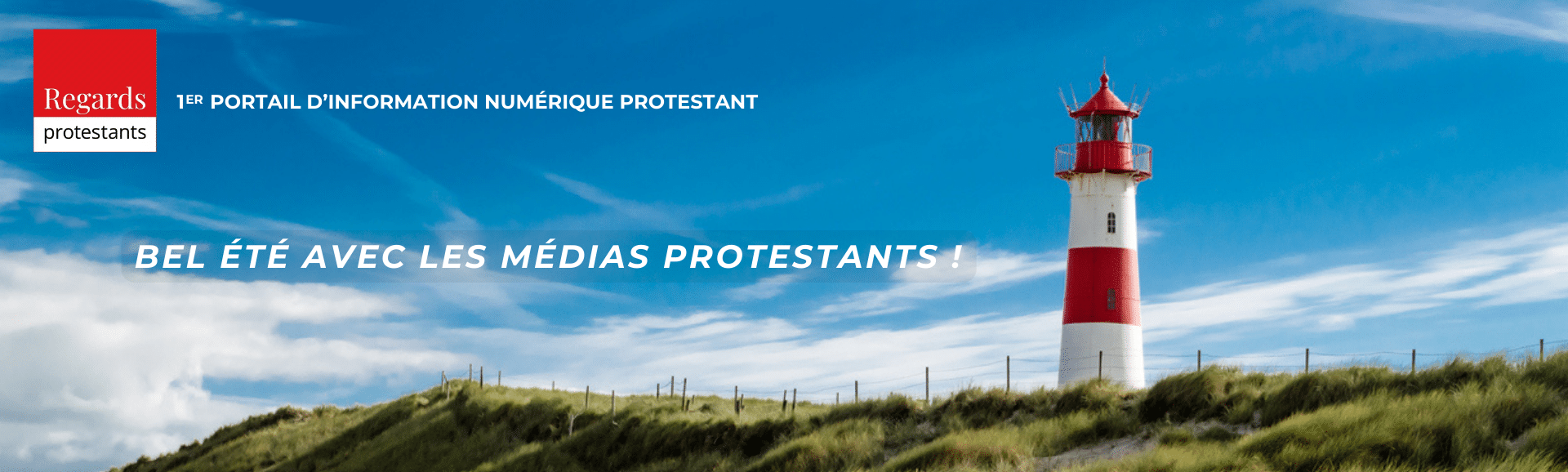J’ai lu, ces derniers jours, l’ouvrage de Patrick Radden Keefe : L’Empire de la douleur, traduit chez Belfond, qui retrace les origines de la crise des opiacées (ou opioïdes) aux Etats-Unis. Rappelons quelques faits : l’usage des dérivés de l’opium y a connu, ces dernières années, une forte augmentation avec, entre autres, un nombre de morts par overdose qui atteint des sommets. Les dernier recensement du CDC (Center for Disease Control) fait état de 107.000 morts par overdose en 2021. A population égale, c’est comme s’il y avait 22.000 morts par an en France (on navigue, aujourd’hui, autour de 200).
Cette crise est multifactorielle, mais elle a été incontestablement amplifiée par la mise sur le marché de médicaments antidouleur (dérivés de l’opium), et par un marketing agressif tentant de persuader les divers prescripteurs que ces médicaments n’engendraient pas de dépendance. Le livre de Patrick Radden Keefe s’intéresse à l’entreprise familiale qui a mis sur le marché l’OxyContin, sans doute le déclencheur majeur de cette crise. De nombreux procès ont émaillé cette histoire et l’aventure judiciaire n’est pas terminée.
L’entreprise en question a argué que les personnes qui devenaient dépendantes avaient déjà des penchants pour la toxicomanie. Des études précises ont montré que c’était largement faux. Certains états des Etats-Unis ont été préservés du marketing le plus agressif par une législation un peu plus restrictive de la prescription de ces médicaments. Les chiffres de personnes devenues dépendantes dans ces états sont très, très en-dessous de la moyenne nationale.
Se protéger du monde
Les ressorts qui ont rendu tant de personnes dépendantes sont avant tout chimiques : cela relève de phénomènes de manque assez classiques. On se sent mal quand les médicaments terminent leur action ; on reprend donc la pilule en question. Puis, au fil du temps, il faut augmenter les doses pour parvenir au même effet (y compris pour les effets antalgiques) et on rentre dans un engrenage.
La célèbre photographe, Nan Goldin est devenue dépendante à l’OxyContin suite à une douleur au poignet qui a justifié, au départ, la prescription. Elle a dû, au bout de trois ans, suivre une cure de désintoxication pour retrouver une vie normale. Or elle analyse très bien une autre forme de dépendance, qui accompagne la dépendance chimique : c’est l’ensemble des douleurs (et pas seulement physiques) dont le médicament vous débarrasse. « L’OxyContin ne soulageait pas seulement sa douleur au poignet ; il semblait aussi servir d’isolant chimique contre l’angoisse et la détresse. C’était comme une couche de protection entre le monde de vous » (p. 468).
Je vois très bien l’expérience dont elle parle. Il y a plusieurs années, on m’a fait avaler une prémédication en vue d’une opération chirurgicale. Au bout de quelques minutes, je me suis rendu compte que j’étais devenu totalement indifférent à ce qui m’entourait. J’entendais un petit enfant pleurer, dans la chambre d’à côté. En temps normal, cela aurait suscité chez moi compassion ou irritation. Rien de tel n’est survenu. Cela glissait sur moi.
Les opiacées (légales et illégales) sont ainsi devenues une manière de supporter les aléas de la vie. La crise du COVID a, par exemple, donné un coup d’accélérateur magistral à leur consommation. La pauvreté endémique qui sévit dans des zones entières des Etats-Unis a, par ailleurs, été un terreau de premier plan pour cet usage.
Mais le côté grinçant du livre est que l’on découvre que les propriétaires richissimes de l’entreprise qui a commercialisé l’OxyContin avaient leur propre manière de se protéger du monde. Leur fortune colossale leur servait de matelas pour dépenser des frais d’avocats vertigineux, pour se mettre à l’abri des poursuites personnelles, pour fuir leurs responsabilité et pour, semble-t-il, garder une bonne conscience intacte.
Patrick Radden Keefe fait, au passage, une remarque qui complète ce tableau. La famille en question a expédié une grande partie de ses ressources dans des paradis fiscaux, alors même qu’en parallèle elle avait une activité de mécénat considérable. « Ils avaient évité de payer des centaines de millions de dollars d’impôts. Ce n’était pas illégal, et on ne pouvait pas accuser le clan d’avoir manqué de générosité envers les pays où ses membres résidaient. Simplement, ils préféraient distribuer leurs immenses dons à leur guise plutôt que de laisser l’Etat s’en charger » (p. 435). Voilà une autre manière de se prémunir contre les projets d’autres que soi.
La vulnérabilité de l’incarnation
Tout cela nous raconte des événements absolument typiques de notre société où les appareillages techniques et les moyens financiers sont censés nous mettre à l’abri des côtés désagréables de l’existence.
Or, en méditant sur les Béatitudes, cet été et cet automne, je me suis rendu compte qu’elles nous appelaient à l’attitude exactement inverse : aller à la rencontre des autres en courant le risque de la vulnérabilité.
Jésus venant, homme parmi les hommes, dépouillé de sa gloire céleste, a endossé jusqu’à l’extrême cette vulnérabilité. Les évangiles de la naissance nous attendrissent, sans doute, mais ils marquent, également, le début des risques énormes que le Christ a accepté de courir. Il s’est confronté à la misère humaine et il a subi le rejet, la condamnation et la mort. Est-ce là une destinée enviable ? Oui si l’on en croit la description du bonheur par les Béatitudes. Et oui, Jésus a vécu libre, il a multiplié les rencontres bouleversantes, il a vécu des moments intenses, il ne s’est jamais résigné.
Ou se protéger des autres, ou s’ouvrir aux autres ; ou se protéger du monde, ou affronter les contradictions du monde : voilà l’alternative que Noël place devant nous. On peut choisir d’être Hérode, retranché dans son palais. On peut aussi se mettre en route, comme les mages, parce que l’on a vu l’étoile qui donne sens à notre vie.