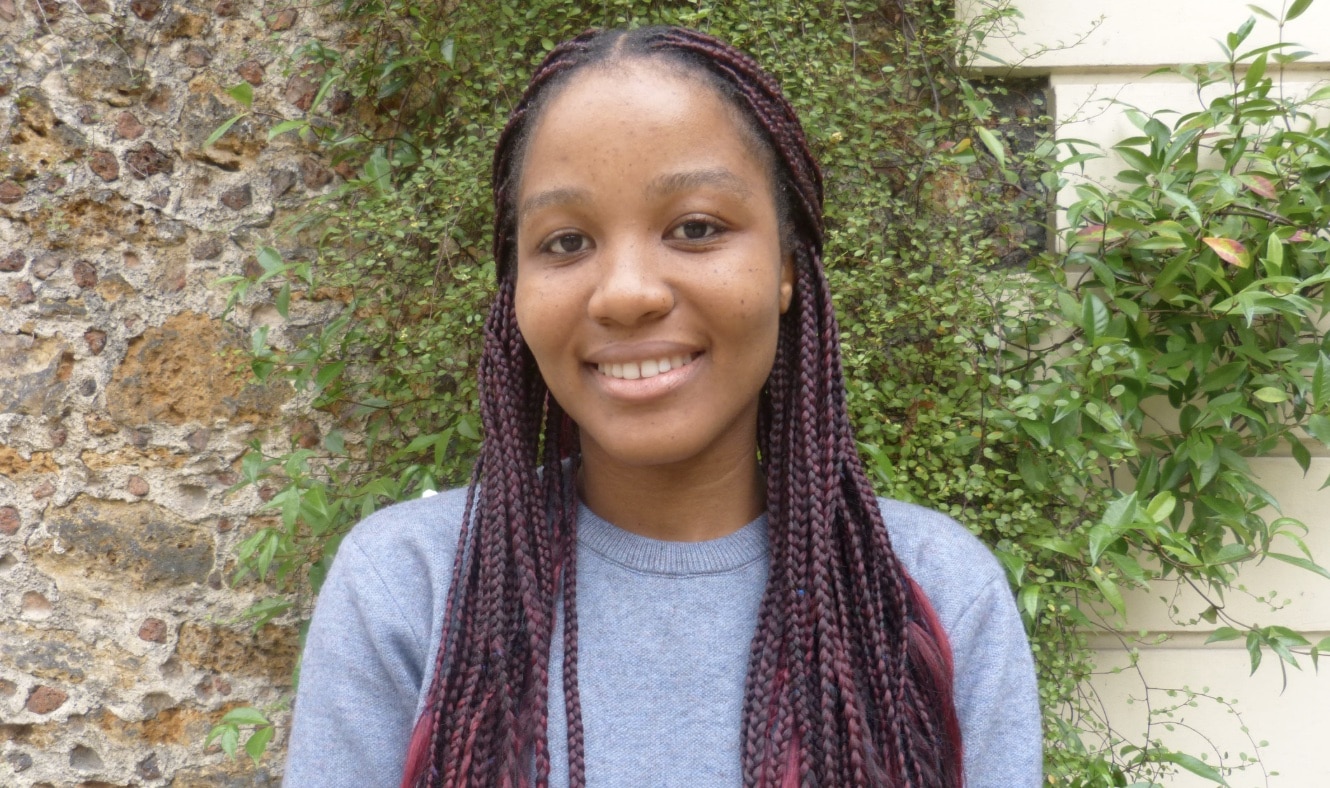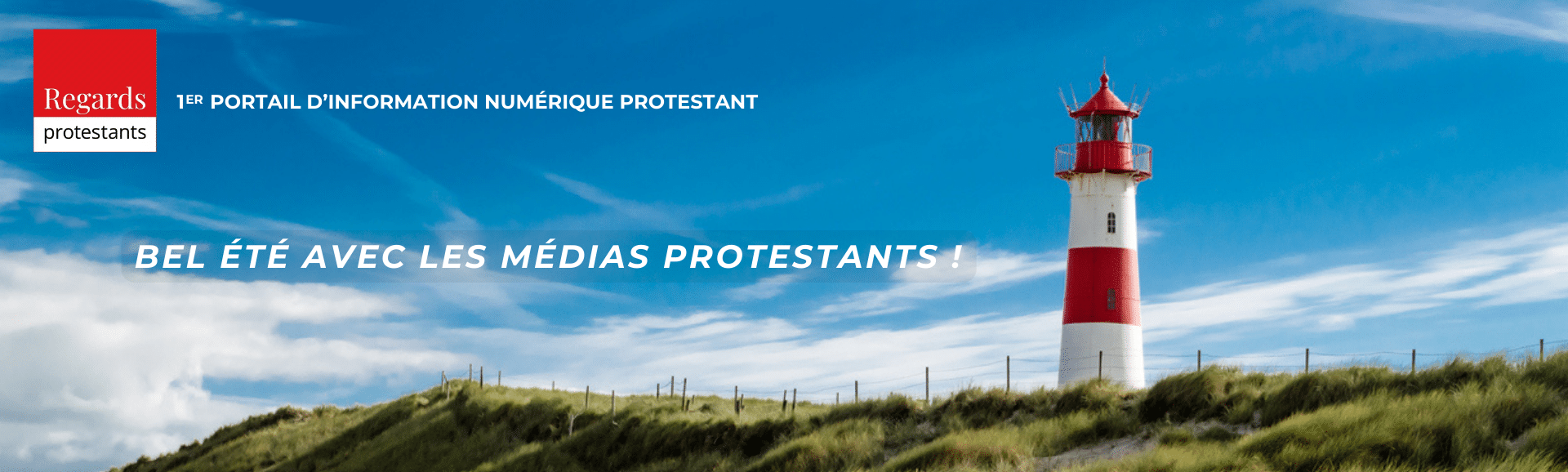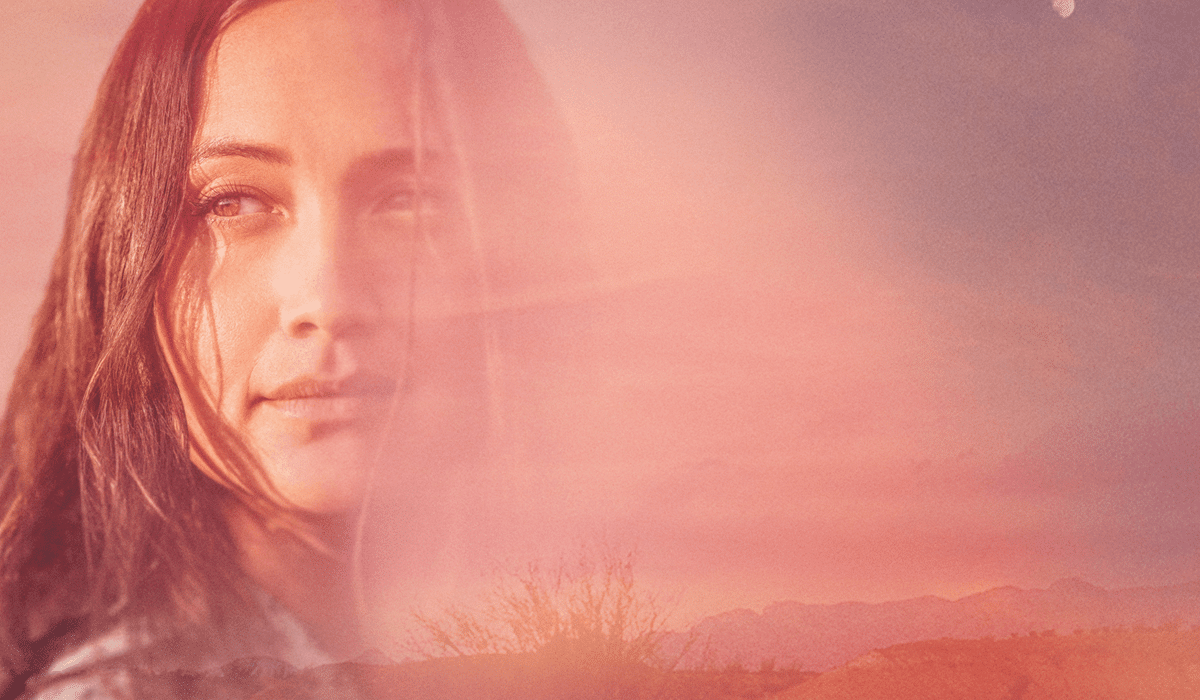Voilà plusieurs jours que la Nouvelle-Calédonie revient à la Une de l’actualité nationale, et une fois de plus, l’archipel est associé à la violence, aux barrages, aux morts injustes et à l’envoi de forces supplémentaires depuis la métropole pour rétablir l’ordre républicain. Pourtant, à regarder ce qui s’est passé depuis le dernier référendum de 2021, bien peu des trois principes républicains de liberté, d’égalité et de fraternité ont été mis en œuvre. Comment en est-on arrivé là ? Nous ne pouvons trop remonter dans le temps, mais rembobinons de quelques décennies.
En juin 1988, retenons l’image d’une main tendue entre Jacques Lafleur, représentant le camp politique « loyaliste », c’est-à-dire pour le maintien du Territoire au sein de la République française, et Jean-Marie Tjibaou, leader charismatique du camp indépendantiste sous les auspices et l’arbitrage d’un État qui, à l’époque, eut l’intelligence de viser la neutralité, après avoir dépêché sur place une « mission du dialogue ». Fin de plusieurs années d’affrontements meurtriers depuis 1984 pudiquement appelés « les événements », jusqu’à la prise d’otages et l’assaut tragique de la grotte d’Ouvéa en avril-mai 1988. Un an plus tard, le 4 mai 1989, Jean-Marie Tjibaou et son bras droit Yeiwene Yeiwene ont payé de leur vie leur engagement pour la paix, mal compris par une minorité, on le sait. On sait moins que les Églises chrétiennes ont patiemment et avec pudeur, joué un rôle non négligeable dans la réconciliation, par d’émouvantes coutumes de pardon, des […]