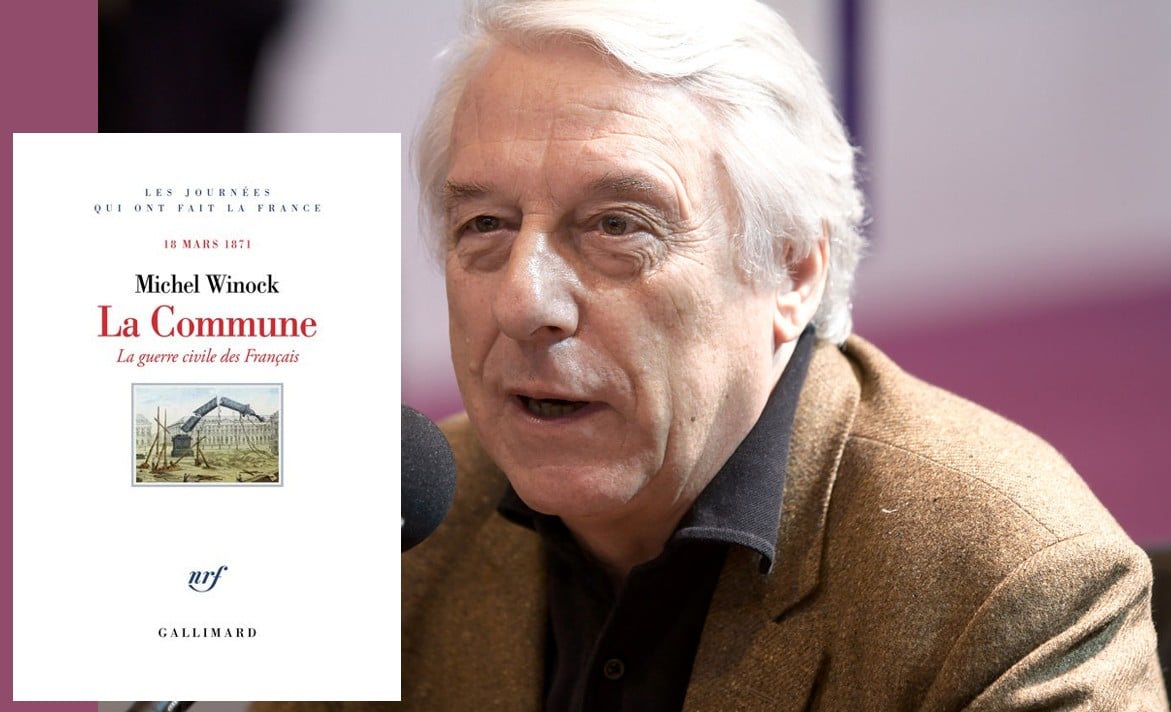Les étreintes, à la croisée d’une boule de gui, ne sauraient suffire à briser l’inquiétude que charrie l’avènement d’un Nouvel An. Bien entendu, chacun cultive en soi la confiance et regarde se lever le jour avec espérance. Mais la guerre, là-bas, nous interdit l’insouciance. Aussi les grincheux, tartuffes de bazar, murmurent-ils : « Où va la France ? » Et l’on sent poindre en eux le désir impérieux d’une poigne de fer.
Eh oui, que voulez-vous, ce jeune Macron n’a pas l’art et la manière… ! Il donne l’impression de présider comme on navigue à vue, sans savoir où, comment, vers quel but il veut guider la nation.
Que l’on y songe : en suivant cette pente, il faudrait que tout, c’est-à-dire la vie publique mais aussi le destin des individus, procède non pas d’une négociation collective, mais de la volonté d’un homme – un jour, peut-être, d’une femme. Il y a là de quoi donner le vertige, mais nous y sommes tellement habitués que nous avons l’air d’ignorer la folie que cela comporte.
L’historien Pascal Ory nous invite à la lucidité
« L’essentiel de la crise actuelle provient de notre culture autoritaire, estime l’Académicien Français, qui publia cet automne « Ce cher et vieux pays » (Gallimard, collection Tracts 49 p. 3,50 €). » Depuis le printemps dernier, le président de la République ne dispose plus d’une majorité au Parlement. Nous pourrions considérer ce blocage comme une chance, une opportunité. Tout au contraire : nous assistons au jeu très français de la confrontation et de la bipolarité – cultivées par les institutions de 1958, aggravées en 1962 – pour ou contre Jupiter. Cette conception du pouvoir, on le sait, prend sa source dans notre vieille tradition monarchique. A l’exception de la Troisième et la Quatrième République – lesquelles ont péri dans la tragédie en 40 et le drame en 1958 – notre pays a privilégié les régimes construits sur un pouvoir personnel. Nous sommes donc prisonniers – des prisonniers satisfaits de l’être – de cette culture politique qui ignore le sens des mots « coalition » et compromis », si évident dans la totalité des pays voisins. »
La France, de toutes les nations démocratiques, est celle qui dispose des institutions les plus personnalisées et les plus centralisatrices. Inutile, à ce propos, d’opposer pays catholiques et pays protestants : l’Espagne ou l’Italie, sur ce terrain, ne se comportent pas autrement que l’Allemagne, accordant de grandes marges de manœuvre à leurs parlements et à leurs régions.
Les réformes, chez nous, proviennent du sommet de l’Etat, paraissent concédées plutôt que générées. « En situation de crise, tout, dans notre système politique, remonte vers le chef de l’Etat, constate Pascal Ory. Quand il est question de redonner la parole au peuple, que ce soit par le référendum classique ou par des innovations telles que les « Conventions citoyennes » ou de « Conseil National de la Refondation », c’est le chef de l’Etat qui prend les initiatives et qui dirige les opérations. Les commentateurs s’émerveillent ou ironisent devant de telles inventions en oubliant qu’en Suisse, cela fait cent cinquante ans que cela existe. Puis tout s’embourbe en rase campagne, et la vie politique reprend comme si de rien n’était. Et cela ne nous émeut guère. »
Il demeure un fait difficile à contester : notre pays transfère une part de sa souveraineté, depuis trente ans, en faveur d’un système supranational appelé Union Européenne. Cette évolution l’oblige à des adaptations. Mais, convaincus que les Français ne les accepteraient pas, les responsables politiques avancent masqués, maladroits ou honteux. Le seul qui ait concilié un langage de vérité, conciliant la clarté la force entraînante de l’enthousiasme vient de mourir à l’âge de 98 ans. « Jacques Delors était un martien, glisse avec humour Pascal Ory. Favorable à un système social-démocrate (autrement dit un régime où l’accord entre des partis politiques différents l’emporte sur l’hégémonie d’un seul, où la prise de décision fait l’objet de compromis entre un gouvernement, des représentants du patronat et des syndicats) partisan d’une Europe dynamique, il a osé ne pas se présenter à l’élection présidentielle, alors même que nos responsables politiques en rêvent jour et nuit. C’est le contre-exemple absolu. »
L’exemple de la Suisse
Pour sortir de la crise, la France devra-t-elle renoncer à ce qu’elle est ? Souverainistes et partisans de la mondialisation ne sont pas loin de partager ce diagnostic, ceux-là pour le déplorer, ceux-ci pour s’en réjouir. Pascal Ory nous encourage à regarder du côté des Alpes : « Nous devrions cesser de donner des leçons de démocratie à la terre entière et regarder ce qui se passe en Suisse. Là-bas, le pouvoir exécutif est partagé entre sept personnes, représentants les quatre principaux partis du Parlement Confédéral, et les citoyens s’expriment régulièrement sur les sujets les plus variés, faisant vivre la fameuse « démocratie participative ». Et si les Suisses ont pas mal de paille dans l’œil, nous nous refusons à reconnaître les poutres qui nous rendent aveugles à nos particularismes et qui font que nous alignons les phénomènes atypiques et contre-cycliques (mai 58, mai 68, Mitterrand, Macron, les Gilets Jaunes, etc.) »
Nul doute que cette analyse touchera le cœur et l’esprit des protestants de France. Et de Navarre, bien entendu… Bonne année 2024 à tous !