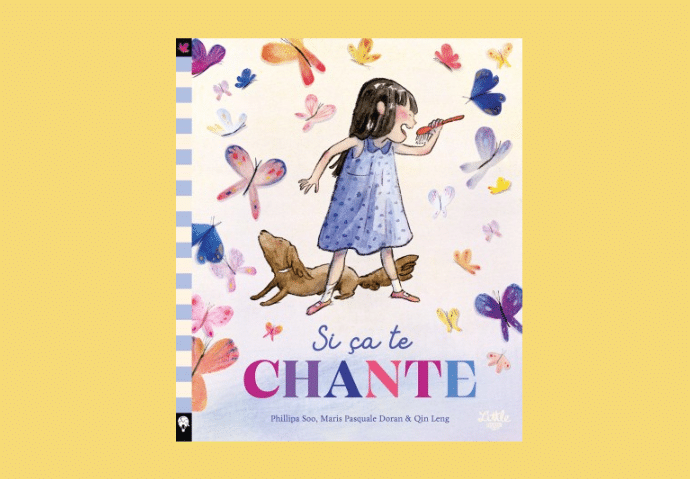Ce phénomène ne peut se ramener à l’erreur politique de tel ou tel leader : il est trop général pour n’être que le fruit de telle ou telle stratégique hasardeuse.
J’ai plusieurs fois abordé cette question dans les pages de ce blog (utilisez le moteur de recherche en haut à droite pour vous y reporter). J’y reviens, cette semaine, à l’occasion d’un éditorial du journal Le Monde mentionnant un article scientifique dont la lecture m’a beaucoup fait réfléchir : « Health as an independent predictor of the 2017 French presidential voting behaviour: a cross-sectional analysis » (article en accès libre, publié en 2019). « La santé comme facteur déterminant du vote à l’élection présidentielle française de 2017 ; une analyse transversale ».
Je résume la thèse de l’article en une phrase : les départements où les personnes sont en mauvaise santé sont ceux où le vote pour Marine Le Pen a été le plus élevé. Naturellement, on sait qu’il y a un lien entre santé et niveau de vie, donc les auteurs ont cherché si, à niveau de vie égal, la santé continuait à jouer un rôle déterminant : c’est le cas.
« Aller mal » : cause et symptôme d’une marginalisation sociale
Il faut donner quelques précisions : les auteurs ont travaillé sur le premier tour (de 2017, et non pas de 2022), en préférant observer ce qu’il en était de l’adhésion décidée à un candidat plutôt que du choix par défaut entre un des deux finalistes.
Il leur était, par ailleurs, impossible (pour des raisons de secret statistique) de raisonner individu par individu. Ils ont donc croisé des statistiques départementales, soit du niveau de revenu, soit de l’état de santé, soit du vote au premier tour.
En utilisant ce qu’on appelle une analyse multivariée, c’est à dire en essayant de voir si une variable a une influence « toutes les autres variables étant égales par ailleurs », il s’avère que le taux de maladies respiratoires et le taux de diabète de type 2 sont des prédicteurs aussi robustes et aussi importants que les indicateurs de niveau de vie quant au vote d’extrême droite. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas d’un déterminisme attaché à une personne, mais de l’existence d’un milieu où beaucoup de gens sont en mauvaise santé. Ces deux maladies conjuguent des facteurs héréditaires ou environnementaux (pollution atmosphérique) et des facteurs de mode de vie (tabagisme, obésité) qui sont des facteurs aggravants.
Les auteurs ont eu l’idée de cette recherche suite à des articles qui avaient relevé le lien entre vote pour le Brexit et mauvaise santé, au Royaume-Uni, et d’autres qui avaient fait le même lien pour le vote Trump aux Etats-Unis. S’agissant du Brexit on pouvait penser que le lien était direct : les partisans du « leave » avaient fait campagne en prétendant que sortir de l’union européenne permettrait de refinancer le système de santé national. Mais on ne peut supposer rien de tel à propos du vote pour Donald Trump qui avait fait de l’Obamacare une de ses principales cibles. Donald Trump soutenait ouvertement la privatisation de l’assurance santé et donc l’accroissement des inégalités dans ce domaine. Ce n’est donc pas dans l’espoir d’améliorer leur santé que les électeurs britanniques et américains ont prêté l’oreille à des arguments populistes.
Il faut élargir la perspective et considérer « qu’aller mal » est un tout. On le sait depuis longtemps, en sociologie, la faible intégration sociale a des conséquences directes sur la santé : plus on est seul et moins on est considéré, plus on va mal dans son corps.
Partons donc de ce constat : ceux qui votent pour des candidats populistes vivent dans des milieux où les personnes souffrent plus qu’ailleurs de maladies invalidantes. Ils soutiennent, ensuite, par leurs votes, les candidats qui font écho à leur colère, à défaut d’avoir l’espoir rationnel d’aller mieux.
Peu d’intérêt pour les politiques de santé publique
A l’inverse de ce que certains pensaient par rapport au vote pour le Brexit, ces couches sociales ont peu d’intérêt pour les politiques de santé publique. Elles se détournent des politiques environnementales, en principe bonnes pour la santé de tout le monde. Tout le monde ira mal si ces politiques ne sont pas mises en œuvre, mais eux vont déjà mal. Être en bonne santé n’est plus un horizon crédible pour eux. Ils n’ont pas envie de faire des efforts pour quelque chose qui ne leur rendra pas ce qu’ils ont perdu.
Je me suis souvenu, à ce propos, d’un article (« Sortie de route ») paru dans La Revue Dessinée, fin 2018 (dans le numéro 22) à propos de la limitation à 80km/h sur les routes. Il faut se souvenir que les mouvements hostiles à cette mesure, pendant l’été 2018, ont fait le lit du mouvement des gilets jaunes de l’automne suivant. Les enquêteurs de la revue étaient allés dans l’Yonne, écouter un certain nombre d’opposants à cette mesure. Leur enquête est assez équilibrée, soulignant, par exemple, que les multiples camions qui traversent la région augmentent le danger des routes sans que les riverains puissent faire grand chose pour les dévier. Mais les entretiens les plus frappants concernent des personnes pour lesquelles le danger routier n’est pas un objectif prioritaire. Ils rencontrent, par exemple, un homme lourdement handicapé après avoir provoqué lui-même un accident mortel (par suite d’une vitesse excessive). Il raconte que son père et son frère ont eu également des accidents de voiture grave en roulant trop vite. Mais le plaisir de la vitesse prime sur le risque encouru.
Comme on l’imagine, le front national local soutient cette fronde anti-limitation de vitesse. Mais, au-delà de la stratégie des partis populistes, les auteurs de l’article se posent une question : « pourquoi certains français se mettent-ils davantage en danger que d’autres sur la route ? ».
En fait, les conduites à risque sont (hélas) bien répertoriées en sciences sociales : elles concernent des hommes, seuls et ayant peu de reconnaissance sociale, bref ayant peu d’intérêt à se maintenir à flot dans un devenir social qui ne leur fait pas de place enviable. Il faut ajouter, dans le cas des personnes habitant dans les zones péri-urbaines, un éloignement au travail qui rend dépendant de la voiture et qui pousse à vouloir réduire les temps de déplacement en allant vite.
En fait, si je retourne à l’article scientifique dont j’ai parlé au début, on remarque que les catégories sociales qui s’abstiennent de voter ou qui votent blanc, sont assez proches de celles qui ont voté, en 2017, pour Marine Le Pen au premier tour, mais qu’elles vont plutôt mieux physiquement. C’est bien le signe que quelque chose de particulier se joue au travers des corps souffrants : un rapport à soi, aux autres, au monde, traversé par la douleur.
La construction progressive d’une attitude nihiliste
Par divers côtés on voit, ainsi, que les couches sociales qui se tournent vers le vote populiste vont mal et ne pensent, d’ailleurs, pas aller tellement mieux si leur champion est élu. Il est frappant de voir, par exemple, que les catégories populaires qui ont voté pour Donald Trump ne lui ont pas du tout tenu rigueur du fait que leur sort ne s’est pas amélioré pendant sa présidence. Au contraire, dans nombre de zones pauvres, les overdoses, liées à des prises de médicaments dangereux, sont devenues, pendant cette présidence, un véritable fléau.
Ce qui compte, pour eux, est d’entendre l’écho de leurs cris, de leur protestation et de leur souffrance. Au total, c’est une stratégie nihiliste, une course à l’abîme où les menaces de mort fleurissent, ou l’on n’attend plus rien d’un débat ouvert, et où on cherche surtout à se prémunir de la menace que représentent les « autres ». Sigmund Freud aurait parlé d’une pulsion de mort qui se donne libre cours.
Viva la muerte
J’ai repensé, alors, à l’expression répandue au moment de la guerre civile, en Espagne : « viva la muerte », « vive la mort ». Si j’en crois Wikipedia (il faudrait vérifier), l’histoire de cette expression est suggestive. Elle est devenue le cri de ralliement des franquistes. Elle a été forgée par un général, lui-même gravement blessé lors d’un conflit précédent.
L’épisode où cette formule survient est une séance publique à l’université de Salamanque. Le recteur de l’université, un homme, d’habitude, plutôt modéré, se défend de la main mise croissante des franquistes qui voudraient faire rentrer l’université dans le rang. Et il finit par critiquer ouvertement la tournure, à ses yeux, indigne et « incivile » que prend la guerre. Lors de sa dernière (on va comprendre pourquoi) intervention en public, il tient, en présence du général en question, le discours suivant : « Le général Millán-Astray est un invalide [comme le sont hélas beaucoup trop d’Espagnols aujourd’hui]. Tout comme l’était Cervantès. […] Un invalide sans la grandeur spirituelle de Cervantès [qui] éprouve du soulagement en voyant augmenter autour de lui le nombre des mutilés. Le général Millán-Astray voudrait créer une nouvelle Espagne – une création négative sans doute – qui serait à son image. C’est pourquoi il la veut mutilée, ainsi qu’il le donne inconsciemment à entendre ».
L’attaque est frontale et la séance devient houleuse. Le général vocifère, crie : « mort aux intellectuels », puis le fameux « vive la mort » qui ne fait, hélas, que confirmer ce que dit le recteur dans son discours. Et ce qui aurait pu n’être qu’un trait d’humeur, prononcé au moment d’une échauffourée verbale, deviendra un véritable cri de ralliement …
Cette fascination pour la mort impressionne et elle refait surface, aujourd’hui, dans une multitude de contextes. On voit clairement que nous sommes complètement en train de dérailler. Mais c’est aussi ce que l’ensemble du fonctionnement économique a fait de ces couches sociales qui les éloigne, aujourd’hui, du désir de vie.