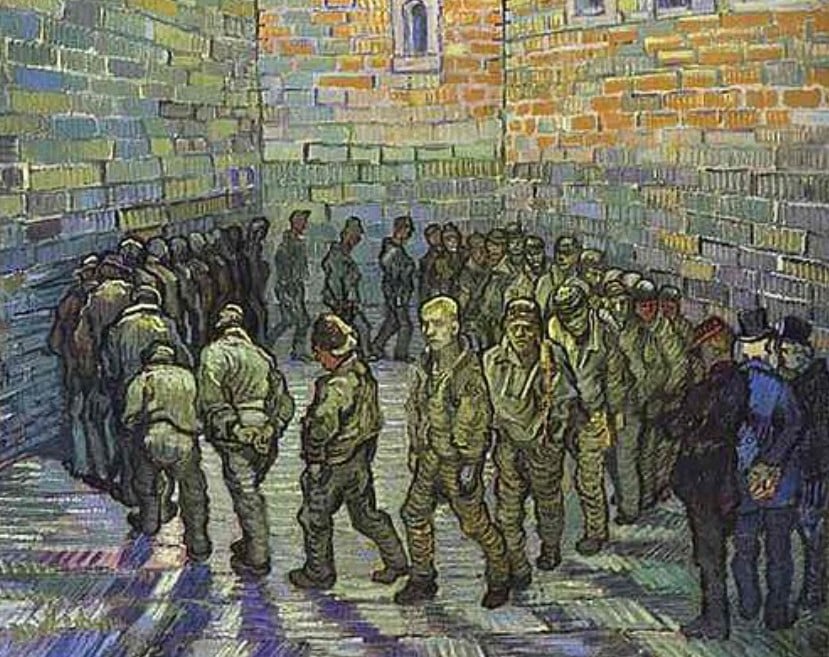Tous les mercredi, à 14H30, nous nous retrouvions dans une salle à l’extrémité d’un bâtiment hébergeant les détenus. La salle était entièrement vide, à l’exception d’une table de jardin en plastique, sur laquelle nous posions les thermos remplis de café et de thé à la menthe. Chaque détenu devait apporter sa propre chaise, certain avec une deuxième, pour mes collègues et moi.
Lors d’une de nos séance, j’avais proposé comme thème : « que feriez-vous si vous aviez à dépenser dix millions d’euros pour un projet public, en tenant compte du fait que l’argent ne pourrait pas aller à votre famille ni vos amis ? »
Le premier de ces messieurs, une petite trentaine d’année, expliqua qu’il avait récemment passé cinq heures aux urgences pour se faire recoudre la plaie qu’il s’était faite lors d’un match de foot (à moins que ce ne fut au cours d’un règlement de compte, pour une sombre affaire de vente de cannabis) : « J’ai bien vu le boulot des infirmières, c’est dingue, elles n’arrêtent pas. Moi je leur donne une grosse prime ». Son voisin, à peine plus âgé, poursuivi sur la lancée : « moi aussi, j’ai vu le boulot des institutrices pour mes enfants. C’est à elle que je donnerai la prime ». Je connaissais bien ce monsieur, qui était incarcéré pour une affaire de violences conjugales.
Après quelques considérations sur la politique gouvernementale, un troisième proposa son idée : « les enfants, c’est sacré. La nourriture dans les cantines est dégueulasse. Moi, je ferai des repas bio, équilibrés, des produits de qualité. D’ailleurs, je vais partir en maison centrale, je demanderai une formation de cuisinier pour la sortie ». Condamné à vingt ans de détention pour meurtre, ce jeune homme de vingt-deux ans n’avait reçu aucun visite de la part de sa famille depuis le début de son incarcération.
« Il n’y a pas que les enfants », protesta un homme de cinquante ans, « moi mes parents, ils n’ont rien comme retraite, ce ne sont pas les seules. Tous dans ma cité, ils sont dans leur trou. Faudrait construire plus de maisons de retraites, avec des activités dedans. Et puis installer une crèche dans la maison, comme ça, les vieux pourront lire des histoires aux enfants. Avec mes filles et mes petits-enfants, on fait ça pour mes parents et ceux du quartier ». « Tout à fait d’accord », appuya un garçon de vingt ans, incarcéré pour avoir frappé le conducteur d’un bus, qui l’avait vu monter en fraudant. « Dans mon immeuble, il y a une vieille dame au dixième étage. Elle ne peut plus remonter les escaliers. Mes frère et moi on se relaye avec les autres voisins pour lui faire ses courses. Moi, je ferais construire de ascenseurs accessibles aux handicapés dans toutes les barres d’immeuble ». Il s’ensuivit un débat animé, sur le thème : « moi, de mon temps c’était mieux », sans que le groupe ne puisse parvenir à une conclusion.
Enhardi par la tournure des événements, un jeune homme de vingt-cinq ans, les traits bouffis et la voix ralentie par les médicaments, se risqua à marmonner : « Je ferai plus de place dans les hôpitaux psychiatriques, et je ferai des services d’accueil pour les sans-abris ». C’était la troisième incarcération en quatre ans pour ce jeune homme, la troisième fois que je le retrouvais dans les mêmes couloirs de la même prison, dans la même salle. Coupé de sa famille « restée au bled », incapable de se rendre à ses rendez-vous de consultation lorsqu’il était libre, il arrêtait de prendre son traitement au bout de quelques semaines. Puis, errant et mendiant dans les rues, il finissait toujours par se laisser entrainer dans une bagarre d’ivrogne, et revenait immanquablement à la case prison.
Le débat s’orientât sur l’aide aux démunis, la protection sociale, le chômage, la nécessité de distribuer des aides sociales plus généreuses. C’est alors qu’un jeune homme de vingt-quatre ans, qui n’avait pas ouvert la bouche jusque-là, se lança dans une diatribe : « c’est un piège ! ne l’écoutez pas ! » dit-il en me désignant du menton, « refusez cet argent ! C’est encore un moyen de vous asservir. C’est pour créer de la dépendance financière et vous rendre esclave de l’argent du gouvernement. Il faut refuser tout ça, et construire par nous-même ce dont on a besoin ». Il n’y avait aucune provocation de la part de ce jeune, que je suivais depuis trois ans. Aucune méchanceté, aucun désir de nuire, simplement une conviction chevillée au corps. Il avait été arrêté avec deux camarades, car ils avaient voulu rejoindre Daesh en Syrie, convaincus qu’ils allaient participer à la création d’un pays juste et égalitaire, sous les auspices de la charia. Il me tenait ce même discours économico-politique depuis le premier jour de notre rencontre, et je ne pouvais m’empêcher de penser que, quarante ans plus tôt, il aurait peut-être rejoint les rangs d’Action Directe.
Un surveillant entra à ce moment, venant nous rappeler que l’heure allouée était écoulée, et qu’il fallait retourner en cellule pour les uns, à l’unité de soins pour les autres. Deux participants se ruèrent sur les morceaux de sucre pour les remporter en cellule, un troisième vint me demander de lui programmer un rendez-vous dès que possible « car ça ne va pas du tout, ma copine ne vient plus depuis six mois », un quatrième demanda à ma collègue de lui écrire une lettre pour son avocat, le jeune homme de vingt-cinq ans me demanda si je pouvais lui trouver un foyer d’hébergement pour préparer sa sortie. Après avoir passé une heure à discuter attablés à la terrasse du café du coin, la vie en détention reprenait ses droits.
Guillaume, psychiatre.